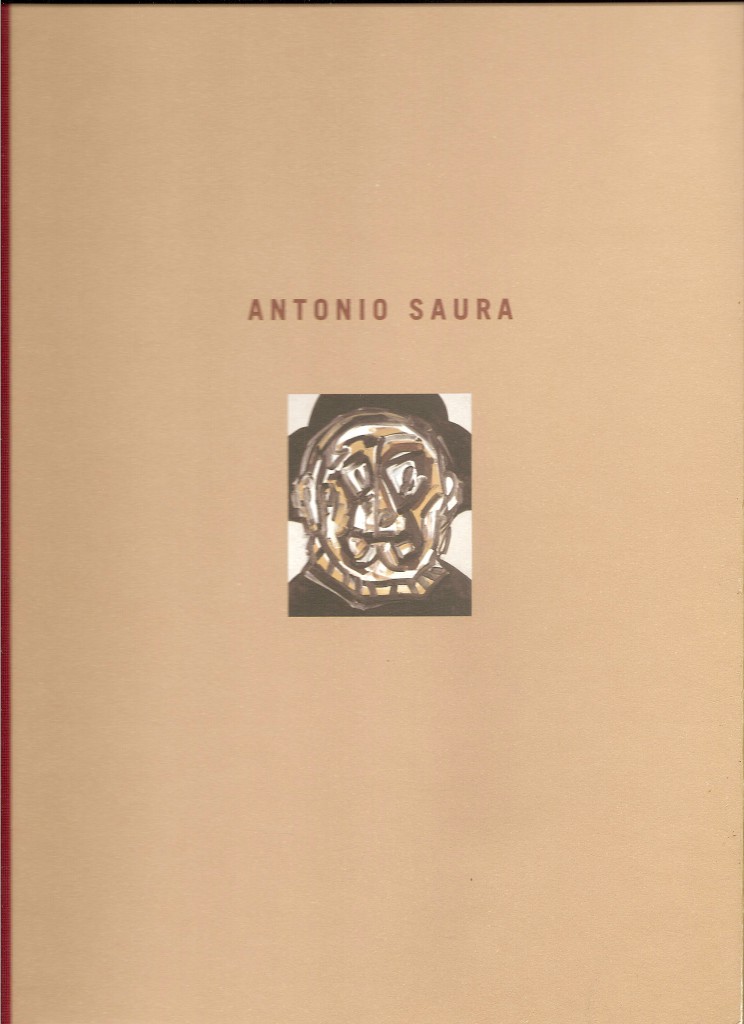
En 1950, Antonio Saura a tout juste vingt ans quand il retrace, dans le catalogue de sa première exposition à Saragosse, la généalogie de sa peinture. Dès sa jeunesse, en effet, il lui paraissait indispensable de dresser un bilan, de faire le point sur son œuvre. Curiosité précoce, étonnante maturité, insolente affirmation de soi : ces trois traits d’une personne décidée, d’une personnalité agissante ne se démentiront pas. Il confesse alors que sa « première peinture franchement surréaliste date de 1947 ». Très jeune donc, il se découvre surréaliste, tout seul, sans l’aide de quiconque. Et il s’affirme comme tel, dans une quasi clandestinité, sans bénéficier de l’appui du groupe surréaliste de Paris. Il s’approprie vite l’imaginaire de Lautréamont, ou mieux encore le message fondateur de l’écriture automatique : « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre », comme on peut en juger avec ces deux vers : « Los vendedores ambulantes no ofrecerán ya trozos de mujer / porque su venta estará prohibida »[1], ou encore avec la phrase énigmatique diffusée par haut-parleur dans la salle des automates du « Museo de Cristal » : « la calavera está herida y tiene sangre »[2]. En 1951, le jeune peintre n’hésite pas à déambuler dans la ville pour distribuer aux passants une carte de visite portant la mention : « antonio saura / surrealista ».
L’ÉCRITURE AUTOMATIQUE DE SAURA
Il ne fait aucun doute que Saura a tiré la leçon de l’automatisme surréaliste. Il est révolu le temps du dessinateur assis ou de l’artiste guindé aux articulations grippées. C’est debout et grâce à la souplesse du poignet que le peintre transmet sans trop les contrarier l’image cérébrale et l’énergie corporelle. Cette fluidité graphique et explosive du poignet, revendiquée par Saura, n’est pas éloignée de la pratique surréaliste de l’écriture automatique. Vu la vitesse et l’écoulement de l’écriture, André Breton et Philippe Soupault se voyaient plus comme deux appareils enregistreurs associés l’un à l’autre que comme les sujets conscients ou les auteurs patentés des Champs magnétiques. On sait que les deux protagonistes se décrivaient aussi comme deux pagures ou bernard-l’ermite logeant dans une coquille vide et s’abandonnant à l’écoute de la voix surréaliste. Saura leur a emboîté le pas, lui qui a comparé son geste de peintre au calmar géant répandant son encre noire. Le crustacé squatteur ainsi que le mollusque éjaculateur s’enveloppant d’une encre de Chine symbolisent les modalités opératoires de l’automatisme mais ils indiquent aussi les risques encourus par les tenants de l’expérimentation surréaliste.
En s’identifiant au calmar, le peintre Saura en appelle directement à l’écriture automatique. Car le mot calmar (du latin calamarius « contenant le roseau pour écrire ») a d’abord désigné (jusqu’au XVIIIe siècle) une sorte d’écritoire portative avant d’être appliqué métaphoriquement au mollusque céphalopode dont la coquille cornée interne est appelée plume. Avec sa gestuelle-calmar, le peintre Antonio Saura s’inscrit comme le digne héritier de l’écriture automatique et particulièrement de l’incipit des Champs magnétiques : « Prisonniers des gouttes d’eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels ».
LE FRONTISPICE DU LÉVIATHAN
Examinons le frontispice du Léviathan, l’ouvrage de Thomas Hobbes publié en 1651. Le corps politique y est représenté par un corps colossal grouillant de sujets, surmonté d’une tête couronnée. Cette image impressionnante du Léviathan, de l’animal fabuleux de la Bible, de l’État, du « monstre froid » dira Nietzsche, cette image du pouvoir politique tenant dans une main le glaive et dans l’autre le sceptre semble résoudre le problème de la formation et de la conservation d’une cité, d’une communauté. En effet, l’assemblage de la tête et des membres, du souverain et des sujets, présente à la fois l’aspect terrifiant d’un monarque surpuissant et l’apparence apaisante d’un corps politique uni. Cependant, selon Hobbes, le corps politique n’a rien de naturel. C’est un pur artifice provenant d’un pacte social accordant au souverain un pouvoir absolu.
Tenons-nous en à l’expression « corps politique ». L’idée unitaire et organique de corps suppose qu’il y a un minimum de solidarité et de lien dans un corps politique. Partant de là, le moment est venu d’aborder de front la peinture de Saura en posant une série de questions : les foules peintes à diverses reprises par Saura tendent-elles à figurer un corps politique ? Si c’est le cas, quelle théorie du souverain, autrement dit de la tête, du portrait, développe-t-il par ailleurs ? Ou encore, comment Saura articule-t-il la tête et le grand nombre ? Et dans cette optique, les innombrables crucifixions de Saura ne deviennent-elles pas l’emblème du corps disloqué du grand nombre, notre corps politique contemporain ?
Saura n’a pas été surréaliste pour rien. Il sait bien que le moi est une foule. Avant de revenir plus loin sur la notion de collagisme formel, passionnel et temporel propre au groupe surréaliste, il faut comprendre qu’Antonio Saura est un pluraliste de l’obsession, alors qu’un Joaquín Torres-García par exemple était un moniste de la construction. Saura ne fait pas mystère de son pluralisme quand il déclare : « il existe autant de peintres en un seul homme que de spectateurs susceptibles de contempler le même tableau »[3]. En somme, le pluralisme du peintre est la réponse la plus adéquate à la diversité de la foule des visiteurs. Si la foule est dans le peintre et que le public contemple le tableau, on ne s’étonnera pas que le tableau porte sur la multitude. Un autoportrait de la multitude et une multitude d’autoportraits. Comme on ne s’étonnera pas de la pluralité des tableaux dépeignant le grand nombre.
Se frottant à la question de « l’art espagnol », Saura reconnaît que « l’art espagnol » existe mais à condition de le rattacher à des individualités fortes et intempestives s’étant illustrées dans la « pensée plastique ». Saura qui fait partie de ce lot d’exception a justement mis en œuvre une « pensée plastique » des foules mais aussi du corps politique, comme nous tenterons de le montrer.
Il y a au moins trois motifs ou raisons de peindre les foules. D’abord, le motif plastique est tout trouvé avec la communion d’un pèlerinage, l’effervescence d’une manifestation, l’autohypnose d’un rassemblement. Car le public se donne toujours lui-même en spectacle. Est garanti l’effet d’ensemble quand il se réverbère en chaque monade. Ensuite, le peintre occupe une toile comme un peuple envahit un territoire. D’où une propension à agrandir le format, à multiplier les interventions sur le terrain, à constituer des séries. Enfin, et c’est là notre principal point d’attaque, le surgissement des foules peut être rattaché au problème de la figuration du corps politique.

LES FOULES DE SAURA
Passons brièvement en revue quelques foules de Saura :
1° Cabezón. Ce dessin de 1950 propose une panoplie de têtes sphériques pleines, fendues ou évidées. Certaines de ces têtes, qu’on devine féminines, ont l’aspect d’une tulipe fermée.
2° On peut comparer deux Foules de 1959. Le premier tableau présente une collection de têtes monstrueuses, pleine page et en gros plan. Dans le second, un amas indescriptible de têtes (et peut-être de troncs, mais cela paraît invérifiable) occupe le bas de la feuille, dégageant ainsi un vaste horizon ; un vide implacable, ou un ciel solennel, surplombe un enchevêtrement de « faces » humaines ; diverses strates en profondeur ou dépôt de surface ? vaste charnier ou foule en délire ? cela paraît indécidable.
3° Avec La Grande foule de 1963, on est à la fois dans le très grand format et dans le trop-plein. On comprend aisément que cette marée de faces humaines déformées, dont subsistent néanmoins les cavités des yeux ou l’ouverture de la bouche, n’est qu’un échantillon, un simple prélèvement d’un ensemble plus considérable. Disons-le une fois pour toutes, Saura n’applique pas au visage un traitement expressionniste ; il ne caricature pas l’homme, il ne le « singe » pas, il le rend « singe » ; il l’animalise puisque l’espèce humaine descend du singe. Saura est hanté par les questions anthropologique et politique. Deux siècles après Jean-Jacques Rousseau, il constate que la figure humaine, complètement brouillée, est devenue méconnaissable : « semblable à la statue de Glaucos que le temps, la mer et les orages avaient tellement défigurée, qu’elle ressemblait moins à un Dieu qu’à une Bête féroce, l’âme humaine altérée au sein de la société par mille causes sans cesse renaissantes, par les changements arrivés à la constitution des corps, et par le choc continuel des passions, a, pour ainsi dire, changé d’apparence, au point d’être presque méconnaissable »[4]. Saura ne fait pas dans le semblant. Il dépeint l’âme humaine, il radiographie les gueules d’une multitude en chair et en os. De tous ces noyés échoués sur le rivage et impossibles à identifier, on peut dire qu’ils sont méconnaissables. Et pourtant, ils sont reconnaissables. Chacun d’eux détient une part d’humanité.
4° Yeux pétillants et bouches bées, la Foule de 1968, sur un papier petit format, paraît presque gaie. Le climat festif de Mai 1968 en France y est peut-être pour quelque chose. Cependant, là n’est pas l’essentiel. Nous sommes dans un bouillon de culture cellulaire, végétal, animal. Lentilles d’eau ou, qui sait ?, grenouilles perchées sur nénuphars.
5° À propos de la Foule de 1982, il devient impératif de signaler le Note Book de Saura où sont consignées des pages lumineuses sur les foules. En voici des bribes : « múltiples aproximaciones de rostros sin cuerpo », « el clamor de las masas humanas », « estructuras movibles y continuas salpicadas de un brillar de pupilas de fiera », « la nube que avanza de un aquelarre de rostros de carbón y tierra dorada », « un lento avance, inflexible y sonambulesco, de miradas ya sin brasa », « un desfile estruendoso de larvas hundidas en claridades y transparencias de arco iris », « un final delirante hecho de nenúfares y entrelazados », « rostros vegetales flotando en espacios vibrantes », « miriadas de miradas formándose azarosamente entre la maleza », « Goya, Munch y Ensor son, quizás, los pintores que mejor han percibido el pavoroso y fantástico rumor de las masas », « módulos plásticos aleatorios », « la impresión ofrecida tras el trabajo ocupador es la de un conjunto sin límites ». La Foule de 1982 ressortit à une population de nénuphars envahissant un plan d’eau. On remarquera qu’en peignant ses rassemblements d’êtres humains, Saura ne manque pas de puiser dans l’imaginaire cosmique ou végétal de sa période surréaliste.
6° Avec Iceberg-Multitude et Karl-Johann Strasse II, deux toiles monumentales de 1997, le corps échoué de la multitude nous prend à témoin. Faces grimaçantes, gueules cassées, visages ravagés, masques mortuaires, traits hilares, toutes ces têtes impayables ne jurent pas du tout ensemble. Soit elles se regardent dans une glace, soit elles nous regardent. Une monade, détachée des autres monades, peut paraître monstrueuse. En fait, chacune d’elles est comme un tampon, une signature, un paraphe d’humanité, où d’ailleurs les âges, les sexes, les conditions sont indiscernables. Les vivants et les morts, les générations et les siècles sont ici confondus (nous verrons l’importance de ce point dans la question du corps politique). Et seul le geste automatique du pinceau tente de repérer la forme matricielle qui court à travers les monades ou relie les nénuphars.
LES DEUX CORPS DU ROI
Dans Les Deux Corps du Roi publié en 1957, Ernst Kantorowicz mène une enquête érudite sur une source de l’État moderne, la doctrine médiévale de la royauté bicorporelle. Dignitas non moritur, la dignité ne meurt pas : tel est le principe animant l’étrange métaphore des deux Corps qui structure la monarchie. Tout comme le Christ, le roi est un être géminé, humain et divin. De même qu’il y a les deux corps du Seigneur, il y a les deux corps du Roi. L’idée de gémellité royale pourrait d’ailleurs venir du concile de Tolède de 638. En tout cas, quand le roi meurt, la royauté ne meurt pas. Si le corps personnel du roi est naturel et mortel, son sur-corps est immortel. La royauté ne meurt jamais. Le corps mystique du roi fonde un corps politique perpétuel. Placé dans l’entre-deux du passé et du futur, il est impossible que l’État vacille dans le présent historique.
Revenons à Thomas Hobbes. Sans préalable théologique ni métaphysique, il échafaude, dans une logique mécaniste et nominaliste, une société civile contractuelle et artificielle. Selon le contemporain de Velasquez et de Charles Ier, le roi anglais décapité, on aurait en fait le choix entre la sédition et la paix civile, entre la multitude et le peuple, entre l’hydre à cent têtes de la guerre civile et le Léviathan, ce corps politique à une tête, ce monstre colossal, cette puissance publique animée par le monarque ou la loi et garantissant aux citoyens l’état de droit.
En résumé, tandis qu’au Moyen Âge des juristes et des théologiens s’appuient sur la fiction du double corps du Roi pour régénérer ou perpétuer la société, à l’âge classique, un philosophe tel que Hobbes explique que faute d’un Léviathan, d’un corps politique construit et animé à sa tête, les hommes en sont réduits à l’état incontrôlable de multitudes en furie.
Qu’est devenu au XXe siècle l’État de droit pensé par Hobbes et Hegel ? Comment Antonio Saura appréhendait-il la monarchie espagnole et la période de la guerre civile ? Faut-il passer sous silence l’explosion démographique planétaire (deux milliards et demi d’hommes en 1950, six milliards en l’an 2000) ?
Il semble bien que les Foules de Saura relèvent d’une double thématique, politique et démographique. Soulignons deux faits : 1° les Foules sont composées de têtes dépourvues de corps. 2° Les faces grimaçantes ne sont pas dispersées mais agrégées ou accolées, comme si elles provenaient d’un immense corps politique dont on ne pourrait même plus fixer les limites ni cerner les contours.
Tandis que le corps du Roi se prolonge dans le corps collectif de ses sujets et le corps mystique de la royauté, tandis que le Léviathan représente un État vertical, colossal où tous les regards se tournent vers la face sublime du monarque et de la Loi, les Foules compactes de Saura, éteintes ou ardentes, hilares ou grimaçantes, laissent voir un Léviathan échoué sur une toile ou sur des feuilles de papier.
Manifestement les Foules ne s’entredéchirent pas, ne s’entredévorent pas. Nous ne sommes ni dans l’état de nature selon Hobbes, ni sur un champ de bataille. Rien à voir avec les têtes sanglantes alignées dans Massacres d’une proscription de la République Romaine d’Antoine Caron, ni avec les corps à corps des Massacres dessinés par André Masson. Nous sommes dans la paix civile et planétaire, dans la puissance politique et démographique. Qu’est-ce qui émane de cette foule de gueules, de cette multitude de regards sidérants, de ce nombre indéterminé d’âmes mortes ou vivantes ? du ricanement ou du silence ? de la germination ou de l’autisme ? une histoire ou un destin ? Saura n’apporte pas plus de réponse que nous ne pouvons préciser aujourd’hui les contours de la démocratie et les limites de la démographie. Car nous éprouvons un réel désarroi face à la figuration du corps politique et à la représentation du grand nombre d’hommes sur terre.
La « pensée plastique » s’applique pleinement aux Foules. Saura peint les Foules plastiquement et élabore une idée du grand nombre. Sur le papier ou la toile s’étale une puissance débordante, dont le peintre nous invite à penser la limite.
COLLAGISME ET SOCIÉTÉ ACÉPHALE
Le surréalisme est un collagisme. Les surréalistes recollent des tronçons de phrase ou d’image (collage matériel). Ils s’associent en s’incorporant des vivants et des morts (collage passionnel). Ils guettent les coïncidences, magnétisent des durées automatiques (collage temporel). Le groupe surréaliste, association collagiste, est composé d’une multiplicité de têtes dépourvues de corps. Dans le poème Fata Morgana, André Breton a une vision d’une foule de têtes privées de corps et posées à même le sol :
« Entre le chaume et la couche de terreau
Il y a place pour mille et une cloches de verre
Sous lesquelles revivent sans fin les têtes qui m’enchantent »
On voit bien quelle est la réplique de ces têtes désirantes et parlantes vivant sous cloche, ce sont les Foules de Saura, où des têtes monadiques prolifèrent dans un milieu indéterminé, où de drôles de visages privés de corps s’associent organiquement, orgiastiquement et plastiquement.
Mais à l’association surréaliste d’hommes et de femmes « cent têtes », il faut opposer le corps sans tête de la communauté acéphale. Pour un Georges Bataille, qui se sent proche de Sade, Kierkegaard et Nietzsche, l’homme s’embrase, se consume au contact de la terre ; avec ses tripes, son cœur et ses quatre membres, il tente d’échapper « à sa tête comme le condamné à la prison ». Dépouillée de sa cérébralité, l’existence humaine peut frayer avec la mort, sans en être effrayée. L’idée de société acéphale, de corps politique sans tête, naît en avril 1936 à Tossa de Mar, où Bataille séjourne chez son ami André Masson, qui dessinera justement le corps emblématique de l’homme acéphale.
Après la représentation de Numance de Cervantes au théâtre Antoine en avril-mai 1937, Bataille refusera la comparaison des journaux entre Numantins assiégés et Républicains de la guerre d’Espagne[5]. En effet, la société secrète Acéphale, au rebours de toute théorie révolutionnaire ou démocratique, trouve en fait son modèle dans la tragédie et le mythe de la communauté sans chef des Numantins.
Le corps surréaliste, à l’image de certains photomontages, regroupe diverses têtes diversement associées. La communauté acéphale, pour sa part, réunit plusieurs corps sans qu’émerge une seule tête. Nous touchons là aux véritables préoccupations anthropologiques des frères ennemis André Breton et Georges Bataille.

LE PORTRAIT DU GRAND NOMBRE
La figuration du corps politique n’a cessé de hanter théologiens, philosophes et poètes. D’après la doctrine médiévale des deux corps, le corps mortel du roi s’appuie sur le corps perpétuel de la royauté. Selon Hobbes, le corps colossal du Léviathan s’effondrerait s’il n’était surmonté d’une tête souveraine. Au XXe siècle, le surréalisme, en réponse au fait divers de l’homme ou de la femme coupée en morceaux, tente de remembrer le corps, comme dans le cadavre exquis. Plus précisément, le groupe surréaliste invente le collage passionnel et temporel. Il institue alors une association polycéphale, un corps de têtes tranchées ou guillotinées. Quant à la société secrète Acéphale de Bataille, elle essaie d’instaurer un corps érotique sans tête, un corps politique ou religieux sans chef.
Il faut aborder les Foules de Saura à la lumière de cette reconstruction politique et anthropologique. Il est indéniable que pour le peintre de Cuenca la figuration du grand nombre passe par des séries illimitées de portraits. C’est comme s’il empruntait au surréalisme le collage de têtes parlantes, désirantes ou glissantes. Néanmoins c’est comme si avec cette conjonction de regards avides ou même éteints, avec cette pente irrésistible du grand nombre, se redéployait la force nue d’une communauté humaine, égalant par son ampleur la puissance du Léviathan et par sa vigueur le corps dressé de l’homme acéphale dessiné par Masson.
Quatre observations rapides à propos de Saura : 1° tout portrait semble souverain (monarque d’Espagne, star du cinéma, icône empruntée à l’histoire de la peinture). 2° tout portrait semble féminin (les portraits de dames dominent). 3° même les crucifixions ressemblent à des portraits (comme si le visage ou la face avait absorbé le reste du corps). 4° bien que singulier, tout portrait contient une multiplicité de regards ou de points de vue.
Comment figurer le corps politique quand tous les citoyens sont souverains ? Comment évoquer la participation des individus aux divers publics universels ? Antonio Saura aborde à sa manière le questionnement démocratique et démographique.

NULLA DIES SINE LINEA
Le pamphlet Contre Guernica ainsi que Nulla dies sine linea, expression plastique de l’actualité journalistique, témoignent de l’intérêt de Saura pour la réflexion morale et politique. En s’interrogeant sur le long et sinueux périple qui voit le tableau Guernica, expédié par avion de New York, atterrir en grande pompe à Madrid, Saura renoue avec l’anticonformisme surréaliste rejetant la poésie de circonstance et l’art engagé. Surtout, il met le doigt sur l’esprit de commémoration qui se répand alors dans les démocraties post-modernes : « Je hais la mémoire de la mémorable mémoire de Guernica ». En effet, transformer Guernica en icône de la fraternité universelle (« Guernica : ambassadeur de concorde », « Guernica : consolation des démocraties »), n’est-ce pas utiliser un tableau comme « gomme à effacer » les créations de l’art et de l’histoire ? Au fond, Saura est presque persuadé que le tableau Guernica de Picasso n’a pas grand chose à voir avec l’événement Guernica.
En 1994, jour après jour, Saura découpe un article dans la presse et l’illustre d’un dessin. Son automatisme graphique, son humour noir et ses idées claires font merveille car ils vont droit au but. Comment schématiser en quelques traits un article de journal sans paraphraser l’événement ni tomber dans la confusion ? Saura s’emploie à résoudre le problème en puisant justement dans son imaginaire de peintre, qui pour l’essentiel est une peinture imaginaire. Saura ne montre pas, il force notre imagination. Ses dessins, ses tableaux qui souvent nous regardent, aiguillonnent notre imagination mais aussi notre pensée.
Les Foules ne manquent pas au menu des journaux de 1994. Dès lors ce thème sera amplement traité au cours de cette série annuelle et ininterrompue de dessins. De plus, la concordance est nette entre l’épuisement des jours et la saturation des foules. Le 21 mai 1994, le journal Libération rend compte de l’émission de télé « Beauty Foules », un brillant montage documentaire jouant avec le flux des foules. Cette « folle farandole de foules », cette « chorégraphie de particules », véritable méli-mélo de masses humaines (manifestations, rassemblements, défilés, processions, mariages princiers, carnavals, embouteillages, etc.) et de multitudes animales (troupeaux, termitières, bancs de poissons, etc.) ne pouvait trouver meilleure illustration que dans une de ces Foules pleine page, auxquelles Saura nous a depuis longtemps habitués.
Perçoit-on la Foule dans les photographies de foule ? Cela n’est pas sûr. Car les photographes auront tendance à théâtraliser la foule ou à fondre les individus dans la masse. Saura, au contraire, brosse le portrait du grand nombre en cadrant les bobines, les gueules, les visages. À cet égard la photo d’une foule islamique, centrée sur les têtes, découpée dans Télérama du 12 janvier, est comme l’esquisse d’un tableau de Saura. Mais quel est justement le rendu de cette photo exclusivement masculine (si l’on excepte, au centre de l’image, surgissant telle une apparition, le visage enveloppé dans un tchador immaculé, ce qui nous amène à nous demander si la photo n’a pas été remaniée) ? Nous constatons évidemment que Saura ne dessine pas d’après photo. Il essaie de capter l’essence de la foule, de figurer le corps politique. Et nous vérifions une fois de plus qu’en peignant d’un trait rapide des faces inertes ou grinçantes, il ne s’arrête pas à des distinctions de sexe, d’âge, de race ou de religion.
Saura a découpé dans El País du 17 et du 29 janvier 1994 deux articles avec photo relatifs à une manifestation, à Paris, pour l’enseignement public et une autre, à Madrid, appuyant la grève générale. On cherchera en vain dans les dessins qui s’y rapportent une trace de banderole ou un éclairage politique. Ce qui intéresse l’artiste, c’est la présence inquiétante ou radieuse de chaque visage, la coagulation des gueules, l’essence du grand nombre. Remarquons que si les deux dessins sont interchangeables, chacun d’eux néanmoins reste l’expression singulière d’une Foule singulière.
Le peintre de Cuenca ne scrute pas seulement la foule visible rassemblée mais aussi le public invisible du grand nombre. El País du 13 juin 1994 donne les tableaux de résultats, pays par pays, aux élections européennes. La réplique de Saura est immédiate : il dessine deux tableaux de foule. Mais curieusement les deux tableaux ne sont pas orientées de la même façon, comme si les deux foules se tournaient le dos.
Autre approche, la vidéosurveillance qui permet d’observer à distance les agissements des individus ou les déplacements des grappes humaines. À la photo de Libération du 28 février 1994 montrant un homme assis devant plusieurs écrans, Saura réplique par un mur d’écrans, exhibant chacun un visage en gros plan. Ces écrans à gros yeux ne sont qu’une des variantes des bulles monadiques peuplant les Foules du peintre.
LA MÉMOIRE DU NOMBRE
Un article de Télérama du 4 mars 1994 évoque la question de la préservation des 100 000 objets (chaussures ou vêtements des déportés, mobilier des SS, etc.) que possède le musée d’Auschwitz. Une photo d’un amoncellement de chaussures vient illustrer le propos. Le parti pris de Saura, semble-t-il, est de redonner vie à cette accumulation, en animant et individualisant quelques chaussures, qui prennent alors une apparence animale ou humaine.
Dans son essai de figuration du corps politique, Saura ne pouvait éluder la question démographique du grand nombre, ni la question historique du surnombre des archives. Face au raz-de-marée des visages, des événements et des microdurées médiatisées, Saura a répliqué en intervenant jour après jour. En traquant le corps politique, il a réussi à exécuter le schème le plus exact, l’image la plus identifiable du grand nombre.
Un article du Monde rapporte qu’Élias Canetti est mort le 14 août 1994 à Zurich, à l’âge de 89 ans. Saura consacre à Canetti un dessin sobre et énigmatique : tombeau sur tumulus ? forme blanche émergente, comme le chien de Goya ? En tout cas, il y a un lien solide entre Antonio Saura, peintre des Foules et citoyen de Cuenca, et Élias Canetti, auteur du roman Auto-da-fé, de Masse et puissance, des Voix de Marrakech, et dont les ancêtres Juifs espagnols résidaient non loin de Cuenca, à Cañete. Le nom de Canetti dérive bien sûr de Cañete.
Saura est un visionnaire du corps politique, des Foules, du grand nombre. En 1951, il affiche son Programio : « pintar el cementerio des las almas fósiles », « pintar la llegada del tiempo ». En 1954, André Breton, dira de Saura, en lui dédicaçant un livre, qu’il est le « pintor de los presagios ». Au début des années soixante, Saura fera flèche de tout bois, en réalisant des collages[6]. Ces sortes de bande dessinée, ces montages d’images maculées de violentes interventions graphiques nous mettent déjà sur la voie du Léviathan ou du corps politique. On peut en juger par ces deux titres : Mes superpouvoirs déclencheront une catastrophe, Lanzaré un nuevo ser capaz de conquistar el mundo.
Nous nous permettrons de rapprocher deux noms qui sonnent pareillement en français : Seurat, le pointilliste et Saura, le recenseur du grand nombre. Seurat, par le fourmillement de points colorés, allège le réel et rend subtil le visible. Saura, avec une stricte économie de moyens, s’attaque aux questions les plus abruptes et les moins visibles, comme celle de la figuration du corps politique ou de la pérennité de l’espèce humaine. De chaque tableau, surgit le monogramme d’une pensée plastique. C’est pourquoi le portrait démultiplié et toujours recommencé du grand nombre nourrit l’imagination et déconcerte la raison.
Georges Sebbag
Notes
[1]Voir « Gritos luminosos », poème inédit de 1948 publié dans le catalogue El Jardín de las Cinco Lunas, Antonio Saura surrealista, [1948-1956] , Museo de Teruel, 1994. Avec ce catalogue, conçu et rédigé par le commissaire de l’exposition Emmanuel Guigon, il n’est plus possible de faire l’impasse sur Saura surréaliste.
[2] Voir « El Museo de Cristal », beau texte inédit de 1953 publié dans le catalogue El Jardín de las Cinco Lunas, Museo de Teruel, 1994. Saura nous fait visiter son Musée de Cristal en visionnaire. On perçoit alors la dimension architecturale de sa peinture surréaliste.
[3] Antonio Saura, Discours de Cuenca, L’Échoppe, 1997, p. 9.
[4] Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, préface.
[5] Voir dans le catalogue El surrealismo y la guerra civil española (comisario, Emmanuel Guigon), Museo de Teruel, 1998, mes deux articles : « Breton, Bataille y la guerra de España » et « Numancia y la guerra de España ».
[6] Voir l’excellent ouvrage d’Emmanuel Guigon, Historia del collage en España, Museo de Teruel, 1995.
Références
« Le portrait du grand nombre » est inédit en français ; il est traduit en espagnol et en anglais in catalogue Antonio Saura, Caja Duero, Salamanca. 2002.