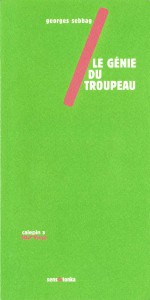I Tout paraît compromis
Tout paraît compromis
Les mots rendent à peu près le même son mais ils ne délivrent plus le même sens. Le corps politique s’amincit et s’allonge, jusqu’à ne plus former qu’un chapelet d’individus. Il y a surtout un immense vacarme entrelardé de morceaux dissonants. Une ambiance du tonnerre qui secouerait encore la planète si par hasard elle était vidée de tous ses habitants.
La boussole de l’opinion
On a beau pousser la chansonnette et déchaîner les décibels, le moral des troupes est tombé assez bas. C’est que l’aiguille de l’opinion s’affole en permanence. Au point que certains se demandent si les populations ne se dérobent pas à l’enquête ou si les indicateurs utilisés sont pertinents. On invoque aussi d’autres explications. Il serait dans la nature de l’opinion d’être versatile et d’opérer de brusques revirements. Ou alors ce serait les médias, eux-mêmes cyclothymiques, qui entraîneraient et déboussoleraient le grand public. Ou encore on est convaincu que la divulgation à l’opinion de sa propre opinion provoque en son sein des réactions en chaîne. À quoi rime ce portrait, appliqué à la multitude, d’un personnage fantasque émettant épisodiquement des opinions contradictoires ?
Le caprice et l’indécision
Assurément il ne peut plus s’agir d’une cité, d’un État ou d’une nation adossés à une histoire, d’un corps politique modelant sa personnalité au gré des circonstances, d’un sujet collectif se projetant dans le futur. En fait, l’incroyable spectacle d’une opinion publique valsant avec ses préférences et virevoltant avec ses jugements, dissimule mal l’écroulement de la construction politique, la disparition du corps social. Car le malaise qui ronge l’opinion, un méli-mélo de caprice et d’indécision, la rend franchement ingouvernable. D’un côté, l’arbitraire du caprice devient l’apanage d’une individualité anarchiste exacerbée, chacun se faisant un plaisir de répandre son génie et d’exhiber ses lubies. D’un autre côté, les choix collectifs sont éludés, la volonté générale est paralysée. En effet, il est entendu que toutes les valeurs se valent, il est admis que toutes les coutumes ont une égale dignité. Il paraît alors incongru de fixer des normes, d’arrêter des règles, de s’attacher à un symbole ou de s’y arracher.
Le cheval de course génial
Robert Musil a considéré comme un tournant dans les mentalités l’apparition dans une gazette du mot « génial » appliqué à un cheval de course. En décembre 1924, les surréalistes ont collé des papillons sur lesquels on pouvait lire : « Le Surréalisme est-il le communisme du génie ? », Le Surréalisme est à la portée de tous les inconscients ». André Breton et ses amis brandiront même brandi comme un étendard la sentence d’Isidore Ducasse : « La poésie doit être faite par tous. Non par un. » Ils ont ainsi frayé la voie à une démocratisation du génie. À quoi vient s’ajouter l’aventure de l’Art brut. Le peintre Jean Dubuffet a détecté, à l’écart des circuits de l’art et de la culture, des dessins, des peintures, des broderies, des assemblages, bref diverses œuvres originales ayant pour auteurs des gens ordinaires, souvent catalogués comme illettrés ou stigmatisés comme fous. Selon Dubuffet, sans l’asphyxiante culture, nous sommes tous spontanément des inventeurs ou des créateurs.
« C’est super génial ! »
Au premier abord, une même conclusion s’impose : si un cheval de course est génial, n’importe quelle créature humaine l’est a fortiori ; si l’écriture automatique introduit au génie, la poésie est à la portée de tous ; si le désœuvrement de l’asile est propice à la création, chacun pourrait s’adonner à son génie durant ses loisirs. Mais dans les faits, il va de soi que pour le chroniqueur hippique, le poète surréaliste et le découvreur de l’Art brut, le génie reste une exception, il ne court pas les rues. Pourtant aujourd’hui nous ne l’entendons pas de cette oreille. Est-ce la passion démocratique qui nous fait croire que tous les égaux sont des maîtres, tous les citoyens des aristocrates ? Est-ce l’illusion pédagogique qui aspire à bannir les illettrés et à forger des surdoués ? Est-ce la publicité rampante qui par tirage au sort assure aux gagnants le quart d’heure de célébrité cher à Andy Warhol ? En tout cas, nous sommes des champions de la surenchère. Nous allons tous à l’hippodrome, décidés à introniser l’homme du commun, à honorer l’individu sans qualités. Et là, séance tenante, nous acclamons l’un quelconque d’entre nous, qui aura consenti à fouler la piste, et dont nous aurons reconnu l’étourdissant génie.
L’artiste insociable
Mais une fois admis que les individus sont des artistes géniaux, se pose aussitôt le problème de leur cohabitation. Comment des êtres d’exception vivent-ils ensemble ? Peuvent-ils même se supporter ? D’ailleurs, a-t-on affaire à des originaux cloîtrés dans leur autisme ou à des rigolos guettés par la crise de nerfs ? S’impose alors l’idée du nécessaire renversement des termes de la question. Ne serait-ce pas plutôt l’hémorragie de sociabilité qui a mis sur le tapis la fable du génie universel ? Depuis que le lien social s’est défait et que le sens commun s’est évaporé, ne nous sommes-nous pas lancés dans la fuite en avant du génie ? Nous nous sommes imaginés insociables parce qu’excentriques, plutôt que de reconnaître notre refus de l’exercice politique et notre sortie du bain social.
Le congénère préféré au concitoyen
Désertant le plan intermédiaire du contrat social et des croyances collectives, nous nous voyons comme des individus hors du commun, issus néanmoins de la même semence. Instruits par Darwin et la génétique, nous avons fait amende honorable : l’espèce humaine n’est plus le couronnement de la création. Quel contraste ! Comme individu, nous affichons une singularité absolue, une ascendance quasi divine. Comme simple rejeton d’une espèce donnée, nous partageons avec nos congénères un corps sain et malade, une nature aimante et souffrante, une même chair mortelle. Tantôt nous nous élevons au sommet de l’individualité, tantôt nous nous enfonçons dans le marais de l’espèce. Au moment où nous essayons de rallier deux points diamétralement opposés, le génie de l’individu et la vitalité de l’espèce, nous faisons allégrement l’impasse sur les structures élémentaires de la société.
Un sur combien ?
À combien Démocrite évaluait-il la population mondiale de son temps ? Witold Gombrowicz, en 1962, dans son Journal, se pose la question puis dresse le tableau suivant :
« Démocrite, 400 000.
Saint François d’Assise, 50 000 000.
Kosciuszko, 500 000 000.
Brahms, 1 000 000 000.
Gombrowicz, 2 500 000 000. »
Rappelons que, dès Ferdydurke, l’écrivain polonais, a décrit les relations entre les Mûrs et les Verts et rendu plus lumineuse l’idée d’« interhumanité ». Ici, il franchit un nouveau pas en affirmant que l’horizon humain de l’individu n’est autre que celui de la quantité humaine de son époque : « Je dis que jamais encore l’homme n’a abordé le problème de sa quantité. Il ne s’est pas encore suffisamment pénétré de cette notion quantitative. Je suis un homme – certes. Mais un parmi bien d’autres. Combien ? Si je suis un parmi deux milliards, ce n’est pas la même chose que si j’étais un parmi deux cent mille. » Nous pouvons enfin nous dégager de l’étreinte des philosophes de l’intersubjectivité, des existentialistes ou des apôtres de l’Autre. Car aux yeux de Gombrowicz, et à mes yeux, l’Autre est différent de moi car il représente une quantité de population. Non seulement le chiffre de l’humanité est une donnée éminente, mais ce chiffre varie dans l’histoire, et peut même varier considérablement pour les individus d’une même génération.
Les individus du grand nombre
Ainsi, le 1 sur n de Georges Sebbag en 1950 (1 sur deux milliards et demi d’habitants) est vraiment différent du 1 sur n de l’an 2000 (1 sur six milliards de congénères). Je remarque au passage que seuls des congénères ont pu se multiplier aussi vite. En effet, les deux milliards et demi de sédentaires ou nomades de 1950 n’ont pas pu décemment avoir pour projet de proliférer dans les limites intangibles de la planète. Et pourtant l’explosion démographique s’est bel et bien produite. J’inclinerai à penser que des congénères se sont substitués à des habitants, et des publics à des peuples. Aujourd’hui nous en sommes à un peu plus de six milliards de congénères géniaux, d’individus du grand nombre.
Qui ? Combien ?
Toujours dans son Journal, Gombrowicz note à quel point la quantité humaine est malmenée. D’abord, un exemple où les ordres de grandeur sont bafoués. Deux cents morts (bombardement de Casa Rosada à Buenos Aires) et trois cents morts (affrontements militaires à Cordoba) deviennent respectivement, dans la bouche d’Argentins pourtant avertis, quinze mille morts et vingt-cinq mille morts. Ensuite, un exemple d’évitement du nombre. Là, Gombrowicz constate que dans L’Homme révolté le moraliste Albert Camus sort « l’homme de la masse humaine », « ce qui équivaut à sortir le poisson hors de l’eau ». Car méconnaître la quantité, c’est s’empêcher de penser la valeur de la valeur ou la mesure de la valeur : « Au long de tout l’ouvrage de Camus, je ne trouve nulle part cette vérité pourtant si simple : que le péché est inversement proportionnel à la quantité de gens qui le commettent. » Enfin, Gombrowicz, après avoir atterri à Piriapolis en Uruguay, examine un problème de quantité humaine à base de flux de passagers et de kilomètres parcourus : « 210 kilomètres, 50 passagers. Les 210 kilomètres, nous les avons expédiés en 25 minutes, mais les 50 passagers en ont pris 180, c’est-à-dire trois heures (fouille des valises, vérification des papiers), d’où je conclus que le nombre de passagers posait un problème plus long à résoudre de 155 minutes que le nombre de kilomètres. »
La démocratie submergée par la démographie
La démographie gouverne la démocratie, et non l’inverse. Ce n’est pas pour rien que les penseurs politiques, jusqu’à Jean-Jacques Rousseau, ont estimé que le régime démocratique ne pouvait convenir qu’aux petites cités, aux communautés réduites, aux États minuscules. Comme si la démocratie, exigeante en vertu, ne pouvait pas dépasser le stade expérimental. Néanmoins, l’esprit démocratique s’est popularisé et la passion de l’égalité a fini par s’imposer à une vaste échelle. Jetons un voile sur les guerres, les terreurs, les tragédies qui ont accompagné l’histoire de la démocratie, et rappelons que les faits historiques ne sont pas inéluctables mais contingents. Aujourd’hui, la démocratie, qui est dans sa phase de croisière, affronte doublement le nombre : 1° sur un plan formel et désormais classique, il lui faut continuer à comptabiliser les voix du suffrage universel. 2° sur un plan réel et entièrement nouveau, il lui faut capter les publics, enregistrer les flux de populations ou de véhicules, endiguer la multitude en chair et en os du grand nombre.
L’élision de l’élite
Il n’y a plus à présent de personnes distinguées, ni de gens au pouvoir. D’ailleurs pourquoi s’embarrasserait-on d’un dirigeant quand les objets s’automatisent et les individus s’autorégulent ? Des automobilistes autodisciplinés, des consommateurs à l’affût, des parents aux petits soins pour leur progéniture, des citoyens atones, des usagers blasés, n’ont nul besoin d’être encadrés. Dans une démocratie apolitique et publicitaire, les élus n’exercent pas le pouvoir mais un métier comme un autre. La technocratie est l’image vivante de l’élision de l’élite. Elle n’use pas de volonté propre, d’imagination personnelle. Le technocrate s’adresse à un usager standard, à un individu anonyme, autrement dit à lui-même. Toutes filières confondues, l’élite actuelle réclame de hauts salaires, en échange de ses services. Elle veut qu’on la paye à son juste prix. Comme les prolétaires de jadis, elle se bat pour l’amélioration de ses conditions de travail et pour le maintien de son pouvoir d’achat. Elle est peut-être la seule héritière de la classe ouvrière.
Le photographe du pape
Un photographe officiel suit Jean-Paul II depuis son élection à la papauté en 1978. Il a en particulier officié lors des nombreux voyages du souverain pontife à l’étranger. Interrogé en 2002 sur le nombre de photos qu’il a pu prendre de son illustre modèle, le photographe a répondu sans hésiter : « des millions ! des millions ! »
Antonio Saura, portraitiste du grand nombre
Usant d’une gestuelle-calmar, d’un graphisme automatique et vif, le peintre espagnol Antonio Saura n’a cessé de peindre tout au long de son œuvre les multitudes humaines. Dans son Note Book de 1982 sont consignées des pages lumineuses sur les foules. En voici des bribes : « approximations multiples de visages sans corps », « clameur des masses humaines », « structures mobiles et continues constellées d’éclats de pupille de fauve », « nuage en marche d’un sabbat de visages de charbon et de terre dorée », « lente progression, inflexible et somnambulique, de regards déjà éteints », « défilé bruyant de larves noyées dans des clartés et des transparences d’arc-en-ciel », « final délirant fait de nénuphars et d’enlacements », « visages végétaux flottant en de vibrants espaces », « myriades de regards se formant au hasard au milieu de l’embrouillamini », « Goya, Munch et Ensor sont peut-être les peintres qui ont le mieux perçu la redoutable et fantastique rumeur des masses », « modules plastiques aléatoires », « l’impression donnée par ce travail est celle d’un ensemble illimité ». En fait, deux points méritent d’être soulignés : 1° les Foules de Saura sont composées de têtes dépourvues de corps. 2° Les faces grimaçantes ne sont pas dispersées mais agrégées ou accolées, comme si elles provenaient d’un immense corps politique dont on ne pourrait même plus fixer les limites ni cerner les contours. Qu’est-ce qui émane de cette foule de gueules, de cette multitude de regards sidérants, de ce nombre indéterminé d’âmes mortes ou vivantes ? Le sentiment de trouble propre aux individus du grand nombre, une perplexité face à l’étendue du corps démographique.
Bref survol du corps politique
Trois corps politiques se sont succédé depuis le Moyen Âge : 1° la royauté bicorporelle, 2° l’État moderne ou Léviathan, 3° le cadavre exquis de la démographie du grand nombre. Jadis, le corps du Roi se prolongeait dans le corps collectif de ses sujets et le corps mystique de la royauté. Il n’y a pas si longtemps le Léviathan représentait un État vertical, colossal où tous les regards se tournaient vers la face sublime du monarque et de la loi. Aujourd’hui, les individus du grand nombre, qui ont pour unique horizon la quantité humaine, se demandent s’ils appartiennent à un ensemble vide ou à un ensemble infini.
Georges Sebbag
Références
« Tout paraît compromis », chapitre I, Le Génie du troupeau, Sens et Tonka, 2003.