
« Loup y es-tu ? » est un jeu de cache-cache pour enfants, dont la scénographie nourrit toute la dramaturgie. On y voit et surtout on y entend des bambins égaillés dans le périmètre du jeu entonner une chanson à l’adresse du loup, qui est posté dans un coin :
Promenons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas
Il n’nous mangera pas.
Intervient alors le moment crucial où les promeneurs interpellent directement le loup :
Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ?
Le loup, qui est supposé enfiler ses habits, réplique immanquablement :
Je mets ma chemise, ou bien, Je mets mes chaussettes, ou bien, Je mets ma culotte.
En fait, le loup a le choix, et c’est là le suspense du jeu, entre bondir dès sa première réplique vestimentaire et s’écrier : Me voilà ! Me voilà ! ou alors faire durer le plaisir, en énonçant une deuxième, une troisième réplique vestimentaire, voire même jusqu’à une septième réplique, pour s’exclamer enfin : Me voilà ! Me voilà ! et s’élancer à la poursuite des promeneurs, le gagnant du jeu étant le dernier joueur à avoir échappé à la vigilance du loup.
Mais de « Loup y es-tu ? », le jeu de cache-cache destiné aux enfants, au bal masqué – la cérémonie ou le divertissement réservé aux adultes –, il n’y a qu’un pas qu’il est aisé de franchir puisqu’il s’agit toujours de se cacher ou de se masquer, de se parer et de s’observer. De plus, la présence du loup est un motif supplémentaire venant justifier le rapprochement entre le jeu et la cérémonie quand on sait, en tout cas dans la langue française, que le mot « loup » désigne précisément le masque de cuir noir porté par les invités du bal masqué. En effet, ce loup noir, en affectant le masque d’un loup et en se découpant sur le visage, dissimule d’autant mieux l’identité du participant au bal masqué qu’il fait briller ses prunelles. On ne manquera pas d’ajouter que dans le jeu d’enfants le loup est supposé revêtir des habits portés par la gent humaine, tandis que dans le bal masqué l’invité est supposé emprunter au loup l’indistinction d’une face animale.
Remontons dans le temps. En 1918, à Paris, l’écrivain André de Lorde, surnommé le « Prince de la Terreur », et dont les nombreuses pièces alimentent le théâtre du Grand Guignol, publie Cauchemars, un recueil de nouvelles illustrées par Gus Bofa. Les titres des nouvelles, comme « L’Horrible Expérience », « Le Bal Rouge », « Mystérieux Attentat », « L’Agonisante », « Morphinomane », « Au Pays des Supplices » ou « L’Enfant Mort », sont révélateurs du genre effrayant, frissonnant, angoissant. Arrêtons-nous au « Bal Rouge », qui est l’histoire d’une illusion d’optique et d’une méprise tragique. La comtesse de Lerne, donnant un brillant bal masqué, croit reconnaître, parmi les invités, son mari qui l’avait quittée depuis des années. Or le personnage costumé objet de sa méprise n’est autre que le chef de la bande des Masques. La comtesse mourra étranglée.
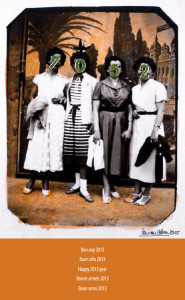
Le lundi 13 janvier 1919, André Breton poste à Paris une lettre-collage-pliage adressée à son ami Jacques Vaché, encore mobilisé du côté de la Belgique. André Breton, qui a apposé ses initiales dans un des replis du document, a réussi à fourrer dans une simple enveloppe un dispositif à malices de quarante-cinq centimètres d’envergure[1]. Il attend en fait de Jacques Vaché dont il ignore la mort survenue le lundi précédent après une forte ingestion d’opium dans un hôtel de Nantes, qu’il perçoive à travers un pêle-mêle de coupures imprimées, d’images tronquées, d’étiquettes sélectionnées, de papiers pliés, de lignes recopiées, le bruit de fond des durées et des événements en cours. Cette lettre-collage qui annonce Littérature, La Révolution surréaliste et l’Anthologie de l’humour noir, en dit long aussi sur le destinataire, sur l’inventeur de l’umour sans h, en particulier à travers un dessin de Gus Bofa représentant un monte-en-l’air surgi d’une nuit d’encre, drapé dans une cape, dissimulé sous un loup noir. On devine que Breton a découpé le dessin de Gus Bofa illustrant « Le Bal Rouge » et montrant un personnage masqué dans le genre de Fantômas mais en plus inquiétant encore.
Penchons-nous sur ce dessin de Gus Bofa découpé très exactement dans la page 13 de Cauchemars. On s’aperçoit que Breton y a adjoint deux autres découpures. D’une part, le collagiste ayant promené ses ciseaux sur du papier blanc portant la mention imprimée « crême 204 » ainsi que l’inscription au crayon « 40 c le mètre » (ce qui semblerait indiquer que ce papier blanc a servi à envelopper un article de mercerie), a décidé de coller ce papier découpé sur le bas de l’illustration de Gus Bofa de façon à occulter la plus grande partie de la légende et de n’en retenir que le premier mot : « Le masque [reprit son immobilité] ». Puis, sur le papier blanc en question, il a inscrit de sa propre main, à l’encre bleue, cette légende fatale : « C’était vous, Jacques ! », identifiant à jamais l’homme au loup noir du « Bal Rouge » à son ami Jacques Vaché. D’autre part, comme si le dessin de Gus Bofa n’était pas assez explicite, comme si le syntagme « Le masque » mis en évidence n’en disait pas assez, le collagiste a inséré, à la verticale du dessin, une nouvelle découpure imprimée: « DOUBLE FACE », dont le graphisme et le traitement en miroir des deux termes renforcent la teneur du message. Pour résumer, Breton a réussi à encadrer le dessin déjà très expressif de Gus Bofa avec une légende horizontale « C’était vous, Jacques ! » et avec une légende verticale « DOUBLE FACE », identifiant ainsi Jacques Vaché à un invité de bal masqué arborant un loup noir, mais aussi à un personnage proposant jour après jour un nouveau visage sous son nouveau déguisement. Il n’est pas d’ailleurs exclu que Breton, en écrivant : « C’était vous, Jacques ! », en parlant donc de Jacques Vaché au passé, ait pressenti la mort de son ami nantais.

Toute la carrière surréaliste – pour utiliser une expression un peu pompeuse – d’André Breton se déroulera sous le signe du collage, comme il l’avait d’ailleurs annoncé dès juillet 1918 dans son poème « Pour Lafcadio » où, sans compter le clin d’œil à André Gide, sont effectués divers emprunts à Arthur Rimbaud et à ses amis Louis Aragon, Théodore Fraenkel et Jacques Vaché :
Mieux vaut laisser dire
qu’André Breton receveur de Contributions Indirectes
s’adonne au collage
en attendant la retraite
La pratique collagiste de Breton et de ses associés ou amis surréalistes se déploiera sur trois terrains : 1. celui de la matière, une conjonction d’images faisant surgir un nouvel objet ; 2. celui du groupe, un frottage d’individus faisant naître une passion ; 3. celui du temps, tel hasard objectif signalant l’existence d’une durée aimantée.

Carmen Calvo collagiste
Ne faut-il pas déclarer d’emblée que Carmen Calvo est, elle aussi, une collagiste de choc surréaliste ? Née un peu plus de cinquante ans après André Breton, notre actuelle collectrice d’Impôts Indirects a eu tout le loisir d’inventorier et de réinventer le legs surréaliste. Comme nous l’avons suggéré d’entrée de jeu, elle s’est engagée dans un énorme jeu de cache-cache avec le loup. Mais son jeu à elle de « Loup y es-tu ? » a ceci de singulier que tout le monde y joue, les filles et les garçons, les petits et les grands. Il a aussi ceci de particulier qu’il semble édicter une nouvelle règle du jeu : que tous les joueurs ou presque revêtent l’apparence du loup. Ou plus précisément qu’ils portent sur le visage un loup de cuir ou de velours noir. Ou alors qu’ils se travestissent ou se maquillent de mille et une façons avec un masque de théâtre ou de carnaval, avec une cagoule de braqueur ou de terroriste, avec un voile de tulle, avec un masque antiseptique couvrant le nez et la bouche, avec un bandeau de colin-maillard ou de fusillé, ou enfin avec un masque facial ou masque dit de beauté, consistant en une couche de crème appliquée sur le visage et dont Carmen Calvo a le secret, tant cette pâte est violemment et diversement colorée, sans oublier bien sûr l’apposition à la hauteur des yeux d’une étiquette ou d’une bande rectangulaire servant à préserver ou à effacer l’identité de la personne.
Ainsi le visage, totalement ou partiellement, a-t-il vocation à être masqué, ravalé, tronqué et dépouillé de la plupart de ses attraits. Que signifient ces opérations d’occultation ou de ravalement, ces greffes chirurgicales, ces procédés d’effacement, ces interventions intempestives sur la sacro-sainte face humaine ? Il n’est pas interdit de penser que Carmen Calvo réitère en tant qu’artiste l’attitude du jeune philosophe Descartes notant sur la première page de son carnet intime : « De même que les comédiens, lorsqu’on les appelle, pour qu’on ne voie pas leur timidité sur leur front, mettent un masque ; de même moi, au moment de monter sur la scène du monde, où je n’ai été jusqu’ici que spectateur, je m’avance masqué (larvatus prodeo). » Le jeune Descartes, à travers cet aveu, semble avoir pressenti la force scandaleuse de sa philosophie naissante et éprouvé de ce fait le besoin de porter un masque protecteur.
Mais le masque, au-delà de la protection sociale ou hygiénique qu’ils assure, au-delà de l’image ou du personnage qu’il magnifie au théâtre, dans les fêtes ou dans la liturgie, le masque donc n’a cessé de proclamer le règne invincible de l’illusion et des apparences. Or tel est le programme assigné depuis toujours à l’art et même à la littérature. Un exemple : Oscar Wilde et son neveu Arthur Cravan, Marcel Schwob et sa nièce Claude Cahun, ces quatre écrivains, esthètes, excentriques et foncièrement artistes ont exalté, sans aller jusqu’à offenser leur propre pudeur, ce en quoi ils rejoignaient Descartes ainsi que Nietzsche, la multiplicité que chacun d’eux portait en soi-même. Ce théâtre philosophique du multiple, Arthur Cravan l’a incarné superbement quand il s’est écrié dans son poème « Hie ! »[2] :
Mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur ;
Vieillard, enfant, escroc, voyou, ange et noceur ; millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau ;
Lâche, héros, nègre, singe, Don Juan, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel,
Faune et flore :
Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux !
En jouant à « Loup y es-tu ? », Carmen Calvo s’est engouffrée elle aussi dans la voie royale du théâtre du multiple. Une voie qu’ont empruntée dès le départ les jeunes dada-surréalistes. En ce qui concerne Aragon, rappelons que dans son premier roman, Anicet ou le Panorama, le héros Anicet assiste à une étrange cérémonie d’un club des masques, au cours de laquelle sept masques, tous adorateurs de la belle Mirabelle, la femme moderne par excellence, lui remettent un cadeau rare ou extravagant. Sous ces masques se cachent en fait Jean Cocteau, André Breton, Charlie Chaplin, Marinetti, un savant à la Paul Valéry, Picasso et Max Jacob. En ce qui concerne le collagiste André Breton, rappelons la phrase qui clôt « L’Année des chapeaux rouges[3] » publié dans Littérature de mai 1922, faisant du poète surréaliste l’alter ego de Jacques Vaché du « Bal Rouge » ou encore l’égal du Fantômas de Souvestre et Allain porté à l’écran par Louis Feuillade : « Aussi bien les murs de Paris avaient été couverts d’affiches représentant un homme masqué d’un loup blanc et qui tenait dans la main gauche la clé des champs : cet homme, c’était moi. » Ajoutons qu’en 1943 René Magritte, reprenant à la fois la couverture du premier volume de Fantômas et l’affiche du film de Feuillade, peindra dans Le Retour de Flamme, la silhouette caractéristique de Fantômas en smoking et chapeau haut de forme dominant les toits de Paris. C’est dans un ciel de flammes que le loup noir nonchalant y fixe insolemment l’objectif, tenant une rose dans la main droite.
« C’était vous, Jacques ! », écrit et s’écrie André Breton dans sa lettre-collage à Jacques Vaché, l’identifiant ainsi au chef de la bande des Masques. Évoquant par la suite l’image placardée d’un Fantômas au loup blanc, le même André Breton déclarera à la cantonade : « cet homme, c’était moi. » Qu’en est-il de Carmen Calvo ? Comme nous l’avons déjà indiqué, la collagiste de Valencia fait participer beaucoup de monde à son jeu de « Loup y es-tu ? ». C’est pourquoi il ne lui est pas nécessaire, à l’instar de ses prédécesseurs, de révéler ses liens exclusifs à une bande de truands, à un club d’esthètes ou à un cercle de comploteurs. Dans ses collages, la mascarade des masques est étendue à tous les âges et à toutes les conditions. À certains égards, les collages les plus spectaculaires, où la cagoule, le bandeau, le voile, le crêpe, le ruban, le maquillage, ou tel autre procédé de recouvrement ou d’effacement, affectent la tête ou la visage, en entier ou en partie, sont ceux qui concernent les familles, les groupes ou les assemblées, tant l’imposition d’un masque répétitif ou avec variations finit par révéler l’existence d’un même air de famille et d’une identité collective
Le jeu de « Loup y es-tu ? » de Carmen Calvo prend assurément sa source dans les masques dadas et les collages surréalistes. Il a néanmoins ses propres règles et suit son propre cours. Les dada-surréalistes portaient un masque. Pourtant, quand cela leur chantait, ils savaient l’ôter. S’ils s’étaient mis à comploter, c’était dans l’intention un jour de se déclarer au grand jour. Ils ont à cet égard renouvelé l’art du photomontage en encadrant, dans le premier numéro de La Révolution surréaliste, la photo de l’anarchiste Germaine Berton de vingt-huit photos d’identité, et dans le dernier numéro de la revue, en entourant le tableau de Magritte, Je ne vois pas la [femme nue] cachée dans la forêt, de seize photomatons de surréalistes les yeux fermés. Carmen Calvo, pour sa part, intervient dans un contexte où le masque est largement à l’honneur. Rappelons d’abord que les jeunes sont à la merci des adultes qui leur fabriquent une gueule[4] . Disons ensuite que les adultes, de plus en plus enclins à chérir l’immaturité, endossent les habits des jeunes dont ils ont fabriqué la gueule. Notons enfin que l’individu, dans une quête apparemment narcissique, est tenté par des métamorphoses qui n’épargnent ni le corps, ni le sexe, ni évidemment le visage.

C’est dans cette mascarade volontaire et outrancière, qui se répand sur tous les âges et semble même se moquer des outrages de l’âge, que Carmen Calvo puise ses collages et en vient à excéder la pratique de ses devanciers surréalistes. Ces derniers, rappelons-le, recollent les morceaux du corps démembré sans songer à porter atteinte à l’intégrité du visage. Trois exemples à ce propos : 1. le jeu du cadavre exquis est une variation sur le remembrement des trois parties du corps (la tête, le buste et les membres inférieurs) ; 2. sur la photo de couverture du Bulletin international du surréalisme de septembre 1936, si un amas de roses occulte la tête de la femme qui se tient à Trafalgar Square parmi les pigeons, il ne lui abîme pas le portrait, loin de là ! ; 3. René Magritte qui corrige à maintes reprises le visage, en lui flanquant une pomme, comme le nez au milieu de la figure, ou bien encore, à l’instar de son tableau Le Viol, en condensant sur le visage les seins, le nombril et le sexe d’une femme, dévoile le visage en le voilant et voile le visage en le dévoilant. Il en va autrement du collagisme de Carmen Calvo qui s’interrogeant sur les portraits individuels et collectifs de la mascarade contemporaine tombe réellement sur un os en découvrant la difficulté qu’il y a à dévisager et à reconnaître quelqu’un.
De Carmen Calvo, examinons les collages Virgilio et Oh là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !. Il s’agit au départ de deux portraits photographiques masculins plutôt avenants. Or, ils sont soumis, pour le premier, à une pluie d’yeux se logeant partout y compris dans les orbites du personnage, et pour le second, à une avalanche de nouilles adhérant au buste, au profil gauche et à la chevelure, épargnant juste la face droite, l’œil gauche et le nœud de cravate. Une pluie d’yeux, plus ou moins dense, fait aussi son apparition dans la photo d’un boxeur (Sé que he despertado y que todavía duermo) comme dans celle d’une sortie de cérémonie de mariage (Testigos), dans le dessin d’une jeune fille pendue par les pieds (Son especulaciones casuales e inútiles) ou dans celui d’une fillette esquissant un pas de danse (Para darle relieve a mis sueños). À propos de nouilles, on peut citer aussi les sortes de macaronis cousus sur la photo d’un élégant jeune homme, disposés en pointillés sur son costume et en rangs serrés sur toute la tête à l’exception des yeux et du bas du visage (El alimento de la sombra). Mais à quoi riment ces pluies d’yeux ou de nouilles, ou encore ces nuées d’éclats de verre ou de morceaux d’étoffe, répandues sur les visages et les corps et qui occupent parfois tout le cadre ? Certes, elles contribuent, tel un lancer de confettis, à saluer la sarabande du défilé des masques. En fait, elles appartiennent aux nombreux procédés de diversion ou d’obstruction utilisés par Carmen Calvo dans son étude du visage.
Quand percent à même le visage, sur le corps ou dans le décor, des yeux, des nouilles, des éclats de verre, etc., nous ne sommes pas loin d’une infection virale, d’une maladie de la peau ou des plaques rouges d’une réaction allergique. Ces éruptions de boutons sont d’ailleurs contagieuses dans l’œuvre de Carmen Calvo. On en retrouve l’équivalent dans plusieurs montages de dessins dont les visages, les corps, ou même les vêtements sont entièrement couverts de taches, paraissant ainsi pommelés, mouchetés ou piquetés. Toutes ces maladies de peau qui s’invitent au bal masqué semblent vouloir jeter un froid sur le déroulement des festivités. D’un côté, Carmen Calvo en rajoute dans l’art de se déguiser et ne se cache pas de jouer à « Loup y es-tu ? ». Mais d’un autre côté la collagiste tempère nos ardeurs en greffant sur la face des incongruités anodines et troublantes, en cerclant ou en aveuglant le regard, en soumettant le visage à tant d’agacements, qu’on en vient à se demander si sa plasticité, sa vitalité, sa spiritualité, sa sensibilité n’ont pas purement et simplement disparu.
On connaît la fameuse pensée de Pascal affirmant que « l’esprit du plus grand homme n’est pas si indépendant qu’il ne soit sujet à être troublé par le moindre tintamarre qui se fait autour de lui ». Il suffit donc du grincement d’une girouette ou d’une poulie, ou moins encore, du bourdonnement d’une mouche pour enrayer les pensées du plus sage. Que fait la collagiste Carmen Calvo ? Même si elle protège l’anonymat du visage en déployant tout l’attirail des masques, elle s’emploie aussi, à l’aide de ficelles, de cordons et de menus objets suspendus au ras du visage, à laisser entendre le bourdonnement d’un agent extérieur, d’un intrus insignifiant mais qui ne laisse pas d’inquiéter.

Carmen Calvo collectionneuse
Carmen Calvo s’adonne au collage photographique mais aussi à divers travaux de récupération et de confrontation d’objets. Sur un caoutchouc de grand format, elle accroche, elle coud ou elle épingle toute une panoplie d’objets ou de débris d’objets. L’un quelconque de ces intrus, s’il avait été inséré dans le champ magnétique du visage, n’aurait pas manqué de le dérégler. Mais la collectionneuse, qui fait ici abstraction du visage, a décidé de réunir ces objets hétéroclites et fragmentaires afin de les jauger en les mesurant les aux autres, quitte parfois à en isoler un seul toujours sur le même fond noir du caoutchouc. Ces assemblages, pourrait-on dire, sont l’autre face, mais la face positive, des collages photographiques au visage masqué. Car autant le visage s’étiole, s’évanouit, se dissout dans les collages de « Loup y es-tu ? », autant tout le menu fretin des objets mis en concurrence dans ces assemblages acquiert une nouvelle santé. Une semelle orthopédique, une règle plate graduée, un fer à cheval, une valise, un cadran de montre, une spatule, un pinceau, un entonnoir, un cintre, une chaussure à talon, une cordelette, une ardoise, un pansement, une forme pour chaussure, un numéro émaillé, une fleur, une ceinture, une ampoule pharmaceutique, un fragment de bébé en celluloïd, une croix rose, une buste de mannequin entièrement piqueté d’épingles multicolores, une photo encadrée, un œil, etc., tous ces articles d’origines diverses – puisant entre autres dans la passementerie, l’horlogerie ou la maroquinerie – , tous ces rebuts, qui ne dédaignent ni le neuf ni la patine, resplendissent sans rougir de leur sélection sur ce tableau d’honneur. Carmen Calvo ne fait ni dans la magie ni dans le chichi. Peu importe que la liste d’objets retenue soit étoffée ou limitée, son art de l’assemblage reste simple et discret.
À côté des assemblages sur caoutchouc noir, il existe de nombreux assemblages sur fond doré ou à feuille d’or témoignant que Carmen Calvo est tentée par une recherche beaucoup plus formelle. Les éléments ne semblent plus alors destinés à être répertoriés et identifiés en tant que tels mais à être reliés les uns aux autres, comme s’ils formaient par leur conjonction une entité à part entière ou une figure originale. D’ailleurs, dans ces assemblages à caractère constructif, il est souvent difficile de se prononcer sur la nature ou la provenance des éléments utilisés. Il arrive aussi que la collectionneuse Carmen Calvo s’aventure sur le terrain de la répétition en alignant des jambes de poupée ou les signes d’une pseudo écriture. Il ne faut pas oublier que très tôt elle avait abordé la question de la série avec Paisaje, Serie recopilación y reconstrucción puis Serie Escrituras.
Qu’est-ce qu’un assemblage apporte et que n’apporte pas un collage photographique ? Nous avons vu que le jeu de « Loup y es-tu ? », chargé en principe de préserver l’incognito du porteur de masque signalait en réalité une défaillance de l’identité personnelle, un coup mortel porté à la plasticité du visage. Ce qui nous fait comprendre, entre autres choses, que les portraits photographiques de Carmen Calvo n’ont rien de narcissique. En revanche, le fait d’avoir intitulé en 1994 un assemblage d’une centaine d’objets Autoretrato prouve que l’artiste espagnole accorde à l’objet, ou mieux à une pluralité d’objets, un certificat de subjectivité. De même, pour un collage de photos montrant de nombreux objets in situ, Carmen Calvo n’hésite pas à utiliser la même formule interrogative à valeur affirmative à deux reprises, en 1997 et en 1998 : Que hay en todo esto sino yo ? Pour elle, l’affaire est entendue, les objets, et même les fragments d’objet, possèdent cette parcelle de subjectivité qu’on réserve habituellement à l’expression personnelle d’une parole ou d’un visage.
Une des caractéristiques des assemblages comme des collages de Carmen Calvo tient dans la manière récurrente de présenter l’objet, en le suspendant à un fil, une ficelle, un ruban ou une cordelette. Concentrons-nous sur la fonction de suspension de tous ces fils, en laissant de côté leur fonction d’attache au support ainsi que leur fonction de cache des yeux ou du visage. Citons quelques cas remarquables comme Los ojos de los pobres, Alegría es uno de sus adornos más vulgares, Habla de exóticas cosechas, He aquí como ocurrió, El gran teatro del mundo, Le châtiment de Tartuffe, Todos los rostros del pasado, et tout particulièrement Délires, où en l’occurrence l’objet suspendu est un moineau dont un ruban bleu enserre le bec et les yeux et qui est partiellement emmailloté. On peut supposer que, devant un moineau pendu à une ficelle, et de surcroît enrubanné, les questions et les réponses délirantes ne manqueront pas de fuser. Tel est d’ailleurs le thème de Cosmos, le dernier roman de Witold Gombrowicz, au départ duquel il y a d’un côté un moineau pendu à une branche par un fil de fer et d’un autre côté l’association que fait le narrateur entre la bouche difforme de Catherette et les lèvres virginales de Léna. À l’arrivée de ce « roman policier », le narrateur découvrira Lucien, le mari de Léna, pendu à un arbre ; il approchera sa main du cadavre et lui introduira un doigt dans la bouche.
Pour Gombrowicz, dans Cosmos, on ne peut pas mettre les pieds dans la nature ni rester dans sa chambre sans être assailli par divers signes, aussi insignifiants les uns que les autres mais qui nous apparaissent comme autant de pointillés ou de flèches menant quelque part. Il s’agit en somme d’une sorte de théorie générale du délire d’interprétation, dont la théorie paranoïa-critique de Dalí serait la théorie restreinte. En fait, les collections d’objets de Carmen Calvo, parfois réduites à un seul élément, nous font pénétrer dans ce cosmos gombrowiczien de signes tangibles mettant au défi la raison de les lier et d’en esquisser un prolongement. Il nous faut préciser alors si pour Carmen Calvo l’objet est une chose ou un signe. Rappelons que la nature d’une chose est d’être identique à elle-même et de ne renvoyer qu’à elle-même, tandis que l’essence d’un signe est d’être une chose qui renvoie à autre chose. Carmen Calvo est trop naturaliste pour ne pas envisager ses objets trouvés ou construits comme des choses, mais elle est trop imaginative pour ne pas les regarder comme des signes relatifs à une émotion, une passion ou une histoire.
C’est pourquoi les collections d’objets de Carmen Calvo rivalisent d’une part avec les vitrines d’un musée d’archéologie ou d’un muséum d’histoire naturelle et d’autre part avec un relevé d’indices qu’aurait établi un enquêteur dans une affaire criminelle ou un amant dans une histoire passionnelle. D’ailleurs les titres énigmatiques des œuvres, empruntés parfois à Arthur Rimbaud ou à Marcel Duchamp, semblent vouloir témoigner que les objets exposés correspondent aux principales pièces versées au dossier d’une affaire de la plus haute importance et qu’un examen scrupuleux des objets en question nous permettrait peut-être de connaître le fin mot de toute cette histoire. Au fond, les objets ou les fragments d’objets retenus par Carmen Calvo sont : 1. des objets matériels et tangibles, autrement dit, des choses ; 2. des signets et autres rubans marquant les pages du livre de la vie ; 3. des indices d’une affaire énigmatique à résoudre ou des images de la sphère privée ou publique ; 4. les pièces de la vaste collection d’objets que l’artiste a essaimés dans toute son œuvre. Mais rappelons-le, en tant que collagiste, l’artiste de Valencia met en scène l’effacement du visage, et en tant que collectionneuse, elle met en évidence la force d’attraction d’un objet ou d’une série d’objets.
La collectionneuse d’objets Carmen Calvo cède-t-elle à une compulsion fétichiste ? A-t-elle contracté avec le sadomasochisme pour recourir aussi souvent aux liens, aux attaches, aux pendaisons ou aux masques ? Est-elle à ce point émerveillée ou tourmentée par l’enfance pour désarticuler autant de poupées et croquer autant de dessins d’enfants ? Ou pour le dire autrement, Carmen Calvo donne-t-elle dans la psychologie et court-elle après son autobiographie ?
Carmen Calvo architecte d’intérieur
Carmen Calvo a beau jouer à « Loup y es-tu ? » et à collectionner des objets comme autant de fétiches ou de jouets, elle ne se contente pas de rejouer sa biographie enfantine ou adulte. Elle prendrait plutôt ses distances avec son enfance. Mieux encore, elle s’instituerait pédagogue, un peu à la manière de Jean-Jacques Rousseau dans Émile ou de l’éducation. En ce qui concerne l’éducation préconisée par Rousseau, il ne faut pas s’y tromper, elle n’est pas naturelle et spontanée mais artificielle et calculée. En effet, le percepteur d’Émile parvient à ses fins en s’aidant de toutes sortes de stratagèmes et de mises en scène. Là où Carmen Calvo joue et nous fait jouer à « Loup y es-tu ? », le précepteur d’Émile préconise en la matière une leçon toute théâtrale : « Tous les enfants ont peur des masques. Je commence par montrer à Émile un masque d’une figure agréable ; ensuite quelqu’un s’applique devant lui ce masque : je me mets à rire, tout le monde rit, et l’enfant rit comme les autres. Peu à peu je l’accoutume à des masques moins agréables, et enfin à des figures hideuses. Si j’ai bien ménagé ma gradation, loin de s’effrayer au dernier masque, il en rira comme du premier. Après cela je ne crains plus qu’on l’effraye avec des masques. » Ce passage du livre premier d’Émile ou de l’éducation est intéressant à double titre, pour Jean-Jacques Rousseau et pour Carmen Calvo. En ce qui concerne Rousseau, on peut se demander s’il ne faut pas substituer à la proposition universelle de départ : « Tous les enfants ont peur des masques », qui est sujette à caution, cette proposition particulière : « Certains enfants ont peur de certaines figures humaines », qui a une toute autre portée anthropologique et morale ; car le problème n’est pas de se prémunir contre les masques, qui d’ailleurs ne courent pas les rues, mais de se préserver de certaines figures hideuses, physiques ou morales, de l’espèce humaine ; la mascarade imaginée par Rousseau est un rite pédagogique d’entrée en société. En ce qui concerne Calvo, chez qui tous les adultes, tous les enfants et même certains animaux portent des masques, la cérémonie ou le jeu de « Loup y es-tu ? » a pour fonction de conjurer non la face hideuse de tel ou tel individu mais une défaillance ou une déficience actuelle propre à tout visage humain.
Dans de nombreux dessins et collages sur fond d’écriture, l’artiste de Valencia mêle généreusement tous les âges. Elle ne le fait pas spécialement pour répéter, après Freud, que l’enfant est un pervers polymorphe. Voyons à ce propos le collage Tus labios son tórtolas mudas de 2001. Tapissé de lettres manuscrites ou dactylographiées, de notes d’hôtel, d’illustrations en couleurs, d’un télégramme, mais aussi d’un éventail à fleurs et oiseau, ce collage est recouvert de dessins ressemblant à des ébauches ou plutôt à des sortes de cadavre exquis savamment disloqués. Énumérons les motifs des dessins : une face lunaire bleue, une grenouille à proximité de deux gambettes, un buste d’enfant dont le bras se prolonge en pied, une tête d’homme de profil, une tête de fille coiffée d’un turban bleu, un visage de profil maquillé de rouge, une femme à béret rouge dont le nez est pourvu d’un fort appendice, un gamin portant la main à sa casquette, deux vêtements côte à côte, un visage de bébé, une main d’enfant glissée sous une cagoule oblongue pour borgne ou cyclope, la gueule et deux pattes d’un loup, la silhouette d’une femme corpulente et acéphale, un visage d’enfant bouche ouverte, le buste d’une fatma entièrement voilée dont la tête semble surmontée d’un arum, un personnage masqué par le pull qu’il est en train de retirer, une tête de femme aux yeux bandés, une petite fille en maillot de bain portant un loup rouge, le bas d’un corps pataugeant dans l’onde, une tête féminine de profil. En ajoutant à ces motifs dessinés quatre images en couleurs on ne peut être que frappé par les multiples coiffes et masques et la présence d’enfants. Le dessin du loup convainc une fois de plus que les enfants et les adultes jouent tous ici à cache-cache, mais sans qu’on puisse dire que les uns soient abonnés au « vert paradis des amours enfantines » et les autres soient cantonnés dans le « noir océan de l’immonde cité[5] ». Carmen Calvo découvre que la modernité a inventé, après la mixité des sexes, la mixité des âges, une mixité favorisée par l’échange ou la circulation des masques.

“Y QUE CANTE UNA NANA CUAL NIÑOS MORIBUNDOS” 2005
De même qu’on ne peut pas réduire La Poupée de Bellmer à une perversion sexuelle, on ne peut pas assimiler Una jaula para vivir, ce lieu d’enfermement pour poupées, jouets et mannequins d’enfants conçu par Carmen Calvo, ni Una mirada escenográfica, la spectaculaire série de boîtes dédiées au même âge, à un théâtre de l’enfance. Car ce théâtre vaut aussi pour les autres âges. Quand un enfant porte un loup, un bandeau, une cagoule, voire même une muselière, cela rappelle que souvent les enfants se déguisent et que parfois on enlève un enfant, mais cela incline aussi à penser que l’être humain, quel que soit son âge, peut être et, pourquoi pas, doit être muselé.
Revenons un instant aux dessins et collages sur fond d’écriture de Carmen Calvo, qui s’apparentent sans conteste, pour ce qui est de l’écriture et du collage, aux lettres-collages d’André Breton de l’hiver 1918-1919. En revanche, pour ce qui est du dessin, il faudrait citer l’intervention d’Yves Tanguy complétant à la plume dans des pages de dictionnaire les vignettes d’hommes illustres : Henri III transformé en sirène, Titus tenant en laisse le chien Titien, Alexandre le Grand partant en campagne sac au dos et pipe à la bouche, Eugène Labiche en cul de jatte, ou bien encore Alfred de Vigny assis les pieds allongés et versant deux grosses larmes[6]. Comme Breton, Calvo a mêlé l’écriture et l’image. Comme Tanguy, elle a prolongé des bustes et des figures, sans verser toutefois dans la caricature.
Cependant, Carmen Calvo a adopté un principe qu’elle tend à généraliser dans ses collages, ses assemblages ou ses installations, et qui la distingue de ses ancêtres surréalistes. Ce principe, il faudrait l’appeler « principe architectural », car quatre catégories architecturales l’inspirent : la façade, l’échelle, la matière et le vide. Décorée ou non, la façade présente des ouvertures ou reste aveugle ; c’est comme la peau ou la vitrine d’un bâtiment. L’échelle d’un édifice est appropriée aux fonctions du bâtiment et est tributaire du contexte. La matière pose toujours ses conditions au projet constructif. Enfin le vide est ce qu’il s’agit de sculpter ou de contenir – dans les deux sens du verbe contenir.
Tournons-nous maintenant vers les assemblages sur caoutchouc noir ou feuille d’or. Nous pouvons considérer les objets attachés ou suspendus à ces supports verticaux comme les ouvertures ou les décorations d’une façade, avec tantôt de rares ouvertures et tantôt des frises décoratives vu le foisonnement ordonné des objets étalés et rangés sur la façade.
En revanche, c’est la matière du collage qui se signale dans les collages photographiques. Soit la peinture est appliquée, ou badigeonnée comme sur une vitre, soit une ficelle, un ruban, un objet, suspendu ou collé, se détachent au premier plan. Cette matière souvent colorée mise en avant signale qu’on a affaire à un collage mais à un collage architectural, avec en façade la couleur ou l’objet rapporté et en retrait le corps du bâtiment, qui se ramène en l’occurrence à un portrait photographique.
Quant aux collages de documents manuscrits, dactylographiés ou imprimés, recouverts de dessins, on pourrait croire au premier abord que les documents servent de fond ou de support aux dessins. Un point de vue structural ou architectural nous oriente dans une autre direction. Ces documents seraient autant de fenêtres ou d’ouvertures sur une façade donnant accès à des portraits ou des scènes de la vie intime. De plus, dans ce contexte architectural, des ruptures ou des changements d’échelle interviendraient du fait d’images en couleurs ou de pages de mode qui signaleraient non plus des scènes d’intérieur mais d’extérieur.
Que Carmen Calvo s’impose comme architecte, et avant tout comme architecte d’intérieur, cela se manifeste encore plus dans les installations, les sculptures et les boîtes. Le vide et la matière sont ici sollicités. Les objets des assemblages y sont récupérés, les figures obsédantes des dessins y sont matérialisées, les photographies y sont recyclées.
En 1982, le sculpteur et paysagiste Isamu Noguchi subvertissait la matière en réalisant Magritte’s Stone, une sculpture en acier galvanisé trempé dans le zinc bouillant conférant à sa surface le jeu pointilliste de taches blanches et grises qu’on trouve aux galets des rivières ou aux rochers des torrents. Et comme la découpe de la fine tranche d’acier galvanisé épousait la forme d’un rocher ou d’un énorme galet, on ne pouvait pas s’y tromper, cet objet en acier présenté sur un support en acier avait toutes les apparences d’une sculpture en pierre qui s’avérait pourtant n’être qu’une fine tranche d’acier galvanisé.
Dans ses travaux d’architecture intérieure, Carmen Calvo a joué elle aussi avec les surfaces et les volumes, la matière et la forme, les mots et les images. Elle a su voir que la conjonction de la matière et du vide conférait à l’objet une pleine forme. Elle a caressé les visages dans ses collages photographiques, mimé les parties du corps dans ses dessins. En adoptant des grands formats, elle a affronté la dimension sculpturale ou architecturale. Elle a entrepris une conquête de l’imaginaire en passant insensiblement du bavoir de bébé à la muselière de chien. Et elle a mis les pieds sur terre en mêlant hardiment différents plans, jouant du cache et de la surimpression, exhibant le miroir et brisant la vitre.
Est artiste, qui nous entraîne dans ses rêveries ou bien qui nous fait toucher du doigt une réalité inaperçue. Carmen Calvo est doublement artiste. Avec ses rêves d’enfant, elle nous invite à jouer à « Loup y es-tu ? ». Avec ses intuitions d’adulte, elle perce à jour quantité d’objets de la vie quotidienne, de la spatule au pansement en passant par la poupée. Cette dernière justement, présentée sous toutes ses coutures, chauve ou chevelue, nue ou habillée, privée d’un bras ou désarticulée, en équilibre ou cul par-dessus tête, n’est surtout pas fantasmée. En fait, poupées et mannequins sont devenus les poupons des petits et des grands. Collectivement ou individuellement, nous avons du mal à nous regarder dans la glace. Nous ne savons plus trop à qui ou à quoi nous ressemblons. C’est sans doute pourquoi nous nous penchons sur des poupons au maintien incertain et aux traits indéterminés. Des poupons qui ont quelque ressemblance avec les étranges mannequins peints par Giorgio de Chirico en 1915, ces créatures énigmatiques aux bras coupés et à la face entièrement lisse des tableaux tels que Le Vaticinateur, Le Poète et le Philosophe, Le Duo (connu aussi sous le titre Les Mannequins à la tour rose), ces personnages tronçonnés dévoilant le vide interne du buste ou de la tête dans Les Contrariétés du penseur, La Lumière fatale ou dans les dessins La Mélancolie, Mannequin avec perspective.
Qui nous a volé notre image ? Ou plutôt comment fuir les innombrables images que nous renvoient les écrans de télévision, les caméras de surveillance, les appareils photo numériques ? « Prenez garde à la peinture », disait-on. Prenons garde à la photographie, maintenant. Carmen Calvo nous entraîne dans sa chambre noire, pour rêver du loup en couleur.
Georges Sebbag
Notes
[1] Voir G. Sebbag, L’Imprononçable jour de sa mort, Jacques Vaché janvier 1919, avec en fac-similé la lettre-collage d’André Breton, éditions Jean-Michel Place, Paris, 1989.
[2] Arthur Cravan publie son poème « Hie ! » en juillet 1913 dans le deuxième numéro de la revue Maintenant dont il est l’unique rédacteur.
[3] « L’Année des chapeaux rouges » d’André Breton paraît dans Littérature, nouvelle série, n° 3, du 1er mai 1922. Ce texte sera repris à la fin de Poisson soluble qui, rappelons-le, figurera à la suite du Manifeste du surréalisme d’octobre 1924, à titre d’application ou d’illustration poétique du concept de surréalisme.
[4] Dans Ferdydurke (1937), le romancier polonais Witold Gombrowicz montre comment les adultes ou les Mûrs fabriquent la gueule des jeunes ou des Verts et les cuculisent.
[5] Charles Baudelaire « Moesta et errabunda », Les Fleurs du mal.
[6] Yves Tanguy, « En marge des mots croisés », Documents 34, « Intervention surréaliste », Bruxelles, 1934.
Références
Georges Sebbag, « Loup y es-tu ? », est inédit en français. Il est traduit en espagnol, catalan et anglais in Carmen Calvo, Ivam, Valencia, 2007.