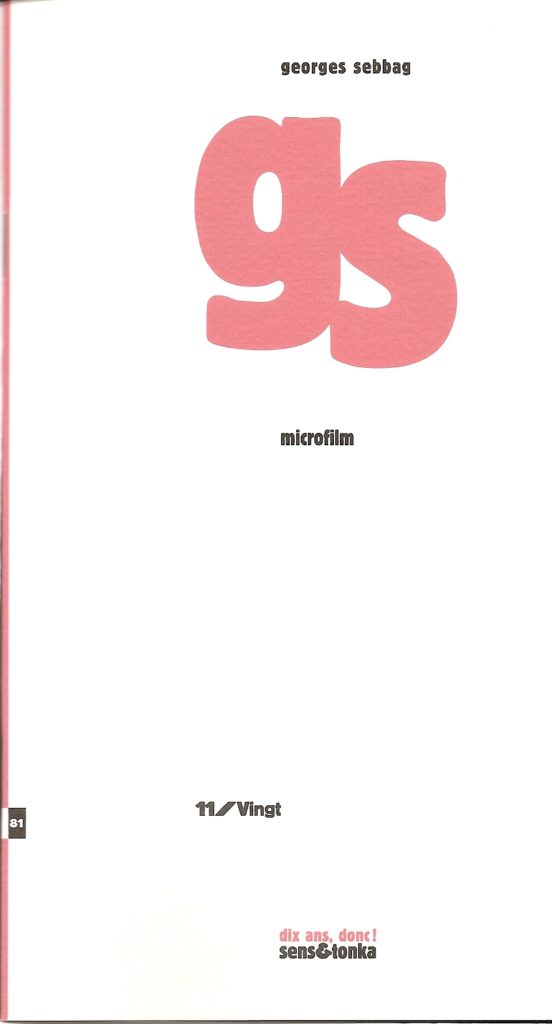
Portez des lentilles
Comme ces héroïnes médusées du cinéma muet, n’hésitez pas avoir les yeux exorbités. Un index soulevant la paupière supérieure, appliquez délicatement sur l’iris la lentille tenue en équilibre sur le bout de l’autre index. À l’inverse, pour éjecter la lentille, tirez d’un coup sec sur le coin de la paupière, comme si vous vous exerciez à avoir les yeux bridés. Le port quotidien de lentilles cornéennes, appelées jadis verres de contact, éveillera en vous des images. Pendant la séance de nettoyage des minuscules coques correctrices, vous songerez au philosophe Spinoza polissant ses lentilles. Mais s’il y a un moment propice à l’évocation, c’est celui, ô combien délicat, de la pose des lentilles. Resurgiront à cet instant deux plans successifs du film Un Chien andalou de Buñuel et Dalí : 1. Un nuage longiligne se profile sur une pleine lune. 2. La lame d’un rasoir à main, irrésistiblement attirée par l’œil grand ouvert d’une jeune fille, fond sur l’œil et le sectionne.
Deux effets des années 1920
Un plan au cinéma n’a pas de valeur en soi. Alors qu’une tonalité dramatique se dégage du plan A suivi du plan B, c’est au contraire un sens comique que peut révéler leca même plan A suivi du plan C. On appelle effet Koulechov ce procédé typique du montage cinématographique. À la même époque où Koulechov s’ingéniait à enchaîner deux images, Bluma Zeigarnik, une psychologue de la théorie de la Forme, faisait une autre découverte liée au temps. Selon la psychologue, qui était une fine observatrice, il n’aura de cesse de les mener jusqu’à leur terme, celui qui a des tâches ponctuelles à remplir. Ne vaut-il pas mieux se délivrer au plus vite d’un pensum, d’un travail ou d’une obligation que de se coltiner le fardeau d’une tâche inachevée ? Mieux vaut s’en débarrasser, et au plus tôt, pour passer à autre chose. Il semble que les effets Koulechov et Zeigarnik conjugués fournissent une indication sur notre rapport au temps. Le cinéaste concasse du temps avant d’en rassembler les morceaux. En multipliant les plans et les séquences et en diversifiant les points de vue, il réussit cette étonnante performance de boucler du temps avec du temps sans fil. Dans la vie quotidienne aussi, il nous faut tailler dans le vif du présent. Nous n’en finissons pas d’exécuter des tâches et de brûler les étapes. Avec tous ces travaux vite faits bien faits, nous sommes prêts à nous attaquer à d’autres projets. Ayant réussi à régler trois plans et une séquence au cours d’une journée, nous croyons avoir enfoncé une borne sur les sables mouvants de l’illimité.
Couleur du Temps
Le 8 novembre 1918, veille de la mort d’Apollinaire, André Breton croise Picasso dans l’appartement du poète. Le 24 novembre 1918, a lieu au Conservatoire Renée Maubel la première représentation de Couleur du Temps, drame crépusculaire en trois actes de Guillaume Apollinaire, où sont présentées comme homicides ou fauteuses de guerre des idées aussi sublimes que la beauté, la science ou la paix. À l’entracte de Couleur du Temps, comme cela sera relaté dans Nadja, alors que Breton s’entretient avec Picasso, un jeune homme, qui n’est autre que Paul Éluard, s’adresse à André Breton, croyant reconnaître en lui un ami soldat disparu. Le curieux est que peu de temps après, indépendamment de cette fausse reconnaissance, Éluard et Breton lieront vraiment connaissance. Sachant la grande fortune des relations à venir entre Éluard et Breton, Breton et Picasso, Picasso et Éluard, comment situer l’incident de l’entracte de Couleur du Temps où Paul Éluard a cru reconnaître un ami « tenu pour mort à la guerre » ? Faut-il voir dans cet incident un non-événement, ou au contraire un bel acte manqué annonciateur d’une longue histoire ? Ou pour le dire autrement, n’y a-t-il pas comme un rapprochement soudain entre certains événements fort éloignés dans le temps?
Couleur du Temps, suite
Le Trésor des jésuites est une pièce écrite par Louis Aragon et André Breton. Elle aurait dû être représentée au Théâtre de l’Apollo le 1er décembre 1928, soit dix ans après Couleur du Temps. Dans cette revue à grand spectacle mêlant le music-hall, le théâtre et le cinéma, les deux surréalistes entendaient faire rejouer l’actrice Musidora, la vamp, la souris d’hôtel au collant noir du film Les Vampires de Louis Feuillade. Deux meneurs de revue, le Temps et l’Éternité, conduisent cette pièce en trois tableaux qui se déroulent chaque fois un 1er décembre, en 1917, en 1928 et en 1939. Le tableau de 1917 se situe dans les tranchées. Celui de 1928 voit affleurer les images mentales propres à la modernité et à l’autobiographie passionnelle des surréalistes marquée par des Catastrophes intimes, sans oublier à la rubrique Faits divers, l’assassinat, le 11 février 1928, du caissier des Missions catholiques de France, qui est intégré à la trame dramatique de la pièce. Le tableau du 1er décembre 1939 réserve une surprise, car il fait état, avec le triomphe de la franc-maçonnerie, d’une guerre perpétuelle entre les nations. Voici des propos révélateurs échangés à la terrasse d’un café : « Que nous réserve 1940 ? 1939 a été désastreux. Vingt et un ans déjà depuis ce qu’on appelait si drôlement la Grande Guerre ! Faut-il regretter les chevaleresques combats des tranchées ou leur préférer les peu glorieuses exterminations immobiles d’aujourd’hui ? Voilà la question. » Avec leurs deux meneurs de jeu, le Temps et l’Éternité, qui voient poindre la guerre à l’horizon, Aragon et Breton, ont bel et bien écrit une suite à Couleur du Temps. Ils semblent avoir repris à leur compte la méditation morose d’Apollinaire, pour qui la guerre et la mort sont en germe dans les idées immobiles, immuables et glacées de Paix, de Science et de Beauté.
La fiancée de King Kong
Quand en août 2004 les médias ont annoncé la mort à l’âge de quatre-vingt-seize ans de l’actrice de cinéma Fay Wray, rendue célèbre par le film King Kong de 1933, ils n’ont pas manqué d’évoquer le plan mythique du gorille dévastateur King Kong réfugié au sommet de l’Empire State Building avec dans la paume d’une main la frêle et belle jeune femme. Pour les médias, il s’agissait moins de retracer la carrière d’une star ayant joué entre autres dans La Symphonie nuptiale d’Erich von Stroheim, que de pointer une durée filmique immortelle. On peut d’ailleurs noter que l’Empire State Building, mis en vedette dans King Kong, avait aussitôt vu grimper sa notoriété et sa valeur commerciale. Mais comment expliquer que King Kong ait fasciné pour longtemps le public de tous les continents ? Il semble que les réalisateurs, Cooper et Schoedsack, forts de leur pratique de documentaristes, aient filmé avec la même minutie ethnographique l’épisode archaïque de l’île mystérieuse que celui du déchaînement de King Kong dans la métropole moderne. Ils ne se sont pas contentés d’une actualisation du mythe de la Belle et la Bête. Pour la dernière partie du film, la plus envoûtante, ils nous ont fait assister à la rencontre fortuite sur le plus haut des gratte-ciel d’une exquise jeune femme et d’un formidable singe. Et en cinéastes scrupuleux respectant la logique de l’action et le ressort de l’émotion, ils ont transformé cette rencontre improbable en un moment réel et nécessaire. En une durée ineffaçable.
Le marché de la croyance
Le cinéma n’est pas le seul à accueillir, ou plutôt à avoir accueilli, dans ses temples du temps, des myriades de fidèles. Les médias audiovisuels informent, éduquent, divertissent en permanence le public planétaire. Ils tendent même à égaler en rayonnement les religions millénaires. Leur puissance est telle qu’ils mettent dans leur poche des institutions comme l’armée ou l’école et qu’ils font la pluie et le beau temps en politique, arts et sports, partout où une mise en images est envisageable. Et comme leurs recettes, dans les deux sens du terme, sont à base d’exhibition, de scandale ou de sensation, ils ont eu vite fait de discréditer la discrétion, la pudeur ou le secret. Ils ont ainsi bouleversé les mœurs. Mais leur coup de génie est d’avoir embauché ou débauché leur clientèle, d’avoir proclamé le génie du troupeau, d’avoir convaincu la foule démocratique que le plus beau métier du monde était celui de journaliste, d’animateur, de footballeur ou de chanteur. Sur le marché mondial des idées, des goûts et des croyances, les médias n’ajustent plus leur offre à la demande du public. Pour l’essentiel, ils restituent au public sa propre demande. En psychanalystes avisés, ils laissent causer l’individu étendu sur le divan. Puis sans trop faire le tri entre fantasme et réalité, ils magnifient et authentifient le propos avec un gros plan bien choisi. Effet Koulechov garanti.
La vie est un songe
Le cinéma, au même titre que le roman, avait cultivé la fiction et traité des passions. La presse écrite, quant à elle, avait jeté son dévolu sur l’actualité, depuis la chronique politique jusqu’à la rubrique des chiens écrasés. Les médias d’aujourd’hui puisent dans ce double héritage. Au cinéma ils empruntent les tours relatifs à la fiction, au jeu ou au divertissement. Ils sont par contre débiteurs de la presse dans leur volonté de restituer une réalité et de coller au présent. Mais comme ils mêlent insidieusement la tâche du journaliste, qui essaie d’établir ou d’analyser certains faits, et celle du cinéaste, qui ne se prive pas de prendre des libertés avec la même réalité, il leur arrive assez souvent de dérailler, de délirer en somme. Ici il faut comprendre que ce n’est pas tant le monde virtuel des images de synthèse qui viendrait brouiller les cartes et ferait perdre au grand public comme aux médias le sens des réalités. Car ces images de jeu vidéo ou ces effets spéciaux courant désespérément après la réalité ne sont que des accommodations pour notre perception et sont d’ailleurs reconnues comme telles. En fait, c’est parce que les médias universels ont pris pour argent comptant la parole des sages d’Orient et des dramaturges d’Occident selon laquelle la vie est un songe, qu’ils s’autorisent à afficher des lubies au rayon des reportages et à ressasser des heures et des mois durant l’unique saillie ou le rare éclair fusant de leur imagination.
L’été de la canicule
En août 2003, 15 000 personnes, pour la plupart très âgées, sont mortes en France des suites d’une canicule exceptionnelle. Curieusement, la canicule qui a sévi sur une bonne partie de l’Europe a concentré ses ravages sur le pays où la médecine est réputée la meilleure au monde. La canicule est une maladie mortelle du quatrième âge. Tel est le diagnostic que les médias, obnubilés par l’idée fixe de l’humanitaire sanitaire, ont aussitôt posé. Ils ont fait chorus avec le gouvernement qui a réprimandé le réseau de veille sanitaire incapable de détecter cette épidémie d’un nouveau genre et de donner l’alerte. Dans le même élan, en entonnant l’antienne syndicale, le remède était trouvé. Il suffisait d’augmenter le nombre des urgentistes dans les hôpitaux et de renforcer les personnels dans les maisons de retraite. On a alors implicitement admis que cette hécatombe n’était pas étrangère à la démobilisation, en pleines vacances d’été, des personnels de santé mais aussi des familles, des services sociaux et autres associations caritatives. La protection de la famille et le secours du voisinage auraient sans doute constitué un bon antidote contre la canicule. Mais les dés n’étaient-ils pas pipés ? Le sort des personnes du quatrième âge n’est-il pas scellé depuis qu’il est pour ainsi dire entre les mains des services médicaux ou des institutions spécialisées ? C’est pourquoi, en cet été de canicule, au lieu de se pencher sur le problème de la fin de vie des personnes âgées ou au lieu d’énoncer cette lapalissade métaphysique « qu’il faut bien mourir à un moment donné », les médias ont dans un beau réflexe brandi la solution de l’urgence sanitaire. Ils ont même propulsé pour l’occasion, en la personne d’un urgentiste des hôpitaux de Paris, un nouvel Hercule chargé de trancher les têtes de l’hydre de la canicule. Un recours à l’urgence qui ressemble à un réflexe d’évitement de la mort prochaine. Le quatrième âge, objet de tant de sollicitude, n’est-il pas aussi regardé, au même titre que le séisme, l’inondation ou la famine, comme une de ces calamités qu’il faudrait aussitôt enrayer ? N’a-t-on pas décrété l’état d’urgence là où, pour les dernières années de leur vie, les personnes désirent non être sauvées en masse mais mourir chacune en paix ? En été, il est vrai, on fait appel aux pompiers. Quant aux médias, ils sonnent le tocsin toute l’année.
Les mots dans la bouche
« Guerre au sida », « Marchons contre le sida », « Croisade contre le sida », ces mots d’ordre ont longtemps fleuri dans les journaux, sur les badges ou dans la rue, s’en prenant au virus du sida comme à un agent ennemi. Il y a comme un mystère dans le choix de ces termes. 1. « Guerre au sida ». Curieusement, ce sont surtout des pacifistes convaincus, des antimilitaristes de choc qui ont scandé ce slogan. 2. « Marchons contre le sida ». À quoi peut ressembler une telle marche collective ? Elle tiendrait autant de la manifestation politique, de la procession religieuse, du marathon sportif que de la parade festive. Pourtant on n’a jamais vu un virus écrasé ou défait au cours de telles démonstrations. 3. « Croisade contre le sida ». Il va sans dire que ce sont des non-croisés qui ont prêché la croisade contre le sida. Des non-croisés qui s’offusquent aujourd’hui qu’on puisse prononcer un jeu de mots aussi douteux que « croisade antiterroriste ». Conclusion provisoire, les mots dans la bouche n’ont aucune importance. Comme le chanteur d’opéra, on peut clamer « Marchons, marchons » et ne pas bouger d’un pouce.
Le non-été de la canicule
L’été 2003 a accouché d’un théorème implacable entonné par les médias : qui dit effet de serre dit réchauffement de la planète, qui dit réchauffement de la planète dit canicule en France. Partant d’un tel énoncé à prétention scientifique, car l’énoncé en question n’est évidemment rigoureux que si l’on renverse la proposition (qui dit canicule dit réchauffement dit effet de serre), partant d’un tel article de foi, les autorités, les simples usagers, les services météo et les médias ont attendu de pied ferme la canicule de l’été 2004. Le gouvernement a concocté un plan anti-canicule essentiellement sanitaire. Les urgentistes ont encore donné de la voix. Les citoyens se sont approvisionnés en climatiseurs et ont pris quelques réservations en Bretagne. Quant aux médias et aux services météo ils ont retenu leur souffle en mai, en juin, puis tout au long du mois de juillet et c’est seulement à la mi-août 2004 qu’ils ont dû se résoudre à constater que pour cet été 2004 la canicule était décidément introuvable. Car, cette fois-ci, contre toute attente, la fraîcheur et les averses l’emportaient sur la sécheresse et les feux de forêts.
La dominante musicale
Les religions n’ont-elles pas été fondées sur un violent contraste entre la splendeur des divinités et la docilité des croyants ? La puissance du capitalisme n’a-t-elle pas reposé sur le ralliement exprès des populations aux prouesses de la technique ? Et maintenant, s’il nous fallait donner un équivalent actuel de la divinité antique ou de la puissance moderne, nous hésiterions sûrement longuement. Car cette divinité s’est insinuée en nous, a gagné notre intimité. Comme dirait Witold Gombrowicz, elle nous a violé par les oreilles. Plus cette puissance enchanteresse nous vampirise et étend son empire, plus nous nous en remettons à elle les yeux fermés et entrons dans son jeu. Elle est impalpable, elle n’a l’air de rien, la sournoise. Elle ne daigne s’exposer à découvert qu’en des circonstances ou impromptus qui ont pour noms chanson, disque, concert, orchestre, bande-son, lamento, jazz, symphonie, cordes, piano, voix de sirène, opéra, batterie, trompettes, tambours, arrangements, bruits divers, bref quand toute une sono chatouille l’oreille et s’y engouffre à gros bouillons. Si futile ou légère soit-elle, la dominante musicale a un programme fort chargé : 1. elle meuble le temps ; 2. elle renvoie le monde à son insignifiance, ou ce qui revient au même, à une débauche de sens ; 3. elle se soumet la technique, plus qu’elle n’y est soumise, contrairement aux pronostics du philosophe Heidegger ; 4. elle tient la dragée haute au rêve, au délire, à l’hallucination et peut-être même à certaines drogues.
La religion du tintamarre
« 350 000 titres à écouter sans limite », peut-on lire sur les écrans d’ordinateurs. Que faire devant un océan numérique d’images et de sons ? Y tenter une trempette, y piquer un plongeon, s’y noyer tout bonnement ? À l’heure du net et du sans fil, l’élément sonore se taille la part belle dans la réception ou la transmission de milliards de messages et d’images. Dans la circulation des flux de marchandises, de personnes ou de capitaux, il faut compter désormais avec le flot sonore. L’économie de marché n’est-elle pas à la fois dopée par ce nouvel artefact et comme sonnée par cet attrape-tout esthétique ? Ne s’est-elle pas métamorphosée, à tout hasard et à toutes fins utiles, en religion du tintamarre ? Apparemment, il ne lui a pas échappé que le public universel éprouvait un besoin étourdi de pâmoison. Dans cette physiologie du corps en transe esquissant un pas de danse, comme on l’observe dans la rave partie, dans ce dérèglement des sens, il n’est pas question d’écouter ou d’entendre une seule seconde le discours de la raison. Deux phénomènes concomitants se sont produits récemment : la musique la plus confusionnelle a submergé les mœurs et l’électricité semble avoir été coupée dans la maison raison. Comme si les tenants du logos s’étaient éclipsés un beau matin ou avaient été disqualifiés à jamais. Alors qu’on les hissait jadis sur un pavois, on jetterait plutôt les scientifiques à la trappe. L’école, sanctuaire des savoirs, multiplie les années d’étude mais sans appétence pour l’étude. L’idée de discuter pied à pied un argument ou même d’en appeler au bon sens paraît vieux jeu ou fatigant. En revanche, la fibre musicale étant la chose du monde la mieux partagée, chacun est appelé à jouir sans entraves et à écouter sans limite les « 350 000 titres » déjà triés sur le volet.
Rétrécissement après lavage
Si l’on en croit l’effet Koulechov, le sens d’une image se révèle dans la dynamique de son insertion. D’après l’effet Zeigarnik, on épuiserait une tâche avant de s’occuper de la suivante. Que se passe-t-il alors quand on se débat au milieu d’une quantité astronomique d’images ? Que se passe-t-il aussi quand au lieu d’exécuter les tâches les unes après les autres, on doit régler simultanément les questions en suspens et les problèmes à venir ? Ne nous serine-t-on pas assez qu’on prépare sa retraite dès la maternelle ? Il faut reconnaître que depuis les années 1920 les données globales ont changé d’échelle. La population mondiale a triplé. La planète aujourd’hui paraît toute ratatinée. La ligne d’horizon ne fait plus rêver. Il n’y a plus de démarcation entre ici et là-bas. Le proche, nous l’avons envoyé au diable. Tout le lointain nous pend au nez ou se tient à nos côtés. On s’est pourtant ingénié à perforer le sous-sol, à sillonner le ciel, à multiplier les voies de communication. On a eu beau modeler le milieu ambiant et éprouver sa plasticité, il a fallu déchanter. Nous sommes pleine page, il n’y a plus de marge. L’espace terrestre est quadrillé et sursaturé.
Des comprimés de durée
Ayant dévasté l’espace, nous nous sommes tournés vers le temps, vers la seconde forme pure de la sensibilité, pour parler comme Kant. Mais en abattant la carte du temps, nous n’entendions pas nous limiter à sa dimension historique ou à ses usages pratiques. Nous voulions visionner le temps, le toucher du doigt personnellement. Les spectateurs ont été longtemps initiés au temps dans le recueillement des salles obscures. Cela se produit maintenant un peu partout, chez soi, dans la rue, en plein air, en auto. L’homme ne se nourrit plus de pain. Il tire la langue pour recueillir des hosties temporelles. Du soir au matin, il écluse des bribes de parole, des morceaux de musique ou des clips vidéo. Il passe le plus clair de son temps et assouvit les plus sombres de ses désirs dans des microdurées préenregistrées ou médiatisées. Kronos dévorait ses enfants. Invités au festin de Kronos, nous dévorons la nouvelle cuisine du temps. Et nous en redemandons.
Georges Sebbag
Références
Georges Sebbag, Microfilm, Sens & Tonka, 2005.