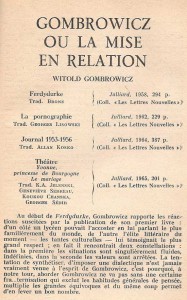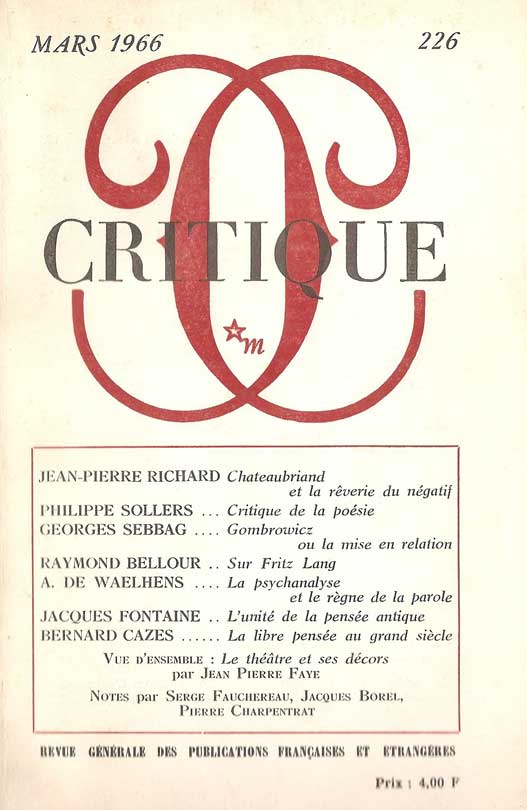 Au début de Ferdydurke, Gombrowicz rapporte les réactions suscitées par la publication de son premier livre : d’un côté un lycéen pouvait l’accoster en lui parlant le plus familièrement du monde, de l’autre l’élite littéraire du moment – les tantes culturelles – lui témoignait le plus grand respect ; en fait il rencontrait deux constellations : dans la première les situations sont singulièrement fluides, indéfinies, dans la seconde les valeurs sont arrêtées. La tentation de synthétiser, d’imposer une dialectique n’est jamais vraiment venue à l’esprit de Gombrowicz, c’est pourquoi, à notre tour, aborder Gombrowicz ne va pas sans une certaine fra…ternisation qui exclut les habitudes générales de pensée, multiplie les grandes équivoques et du même coup permet d’en lever un bon nombre.
Au début de Ferdydurke, Gombrowicz rapporte les réactions suscitées par la publication de son premier livre : d’un côté un lycéen pouvait l’accoster en lui parlant le plus familièrement du monde, de l’autre l’élite littéraire du moment – les tantes culturelles – lui témoignait le plus grand respect ; en fait il rencontrait deux constellations : dans la première les situations sont singulièrement fluides, indéfinies, dans la seconde les valeurs sont arrêtées. La tentation de synthétiser, d’imposer une dialectique n’est jamais vraiment venue à l’esprit de Gombrowicz, c’est pourquoi, à notre tour, aborder Gombrowicz ne va pas sans une certaine fra…ternisation qui exclut les habitudes générales de pensée, multiplie les grandes équivoques et du même coup permet d’en lever un bon nombre.
Ferdydurke ou la mise en pièces
Dès Ferdydurke, Gombrowicz se montre sociologue accompli et habile psychanalyste ; voilà qui en dit long et semble sonner creux, comme toute formule éculée ; la Forme, le Langage – ces curieuses instances – sont combattus, pétris par Gombrowicz, et finalement vivifiés. Où trouver la psychologie, la sociologie ? Un exemple : Gombrowicz s’empare du corps social et le morcelle selon l’âge, la profession, la position familiale, la classe sociale et n’oublie pas de faire ressortir l’opposition ville / campagne. Il opère une même division en distinguant dans le corps de l’individu diverses parties : cul (cucumard, cuculosème, etc.), doigts, pieds, bras, yeux, dents, oreilles et visage (gueule) ; le cuculosème est le fondement du corps individuel, dont il faut déjà dire qu’il est en relation avec le corps social, justement par la domestication du cucumard. Le cheminement cucumignon-gueule correspond à une expérience individuelle et à un dressage social. Aucun doute, Gombrowicz remplit largement son contrat de romancier : il se propose de vivre avec ses contemporains, de les suivre dans leurs retranchements, mais aussi de faire connaître constamment son point de vue.
Théories fumeuses et bouffonnes ou existence exaltée jusqu’à la décomposition, ordonnée suivant la loi des composés humoristiques ? La vie, en tout cas, ne manque pas au rendez-vous. Avec Ferdydurke, nous percevons les hésitations de Gombrowicz devant les entités fondamentales de la durée humaine : maturité ou immaturité ? Ni jeune, ni vieux, Gombrowicz est tenté par une troisième voie, par le troisième homme ; mieux encore, il s’aperçoit qu’il n’est plus rien, puisqu’il n’est ni adolescent ni adulte. Cet étrange nihilisme, fait de pure neutralité, ayant pour origine la grande confrontation entre les deux Âges de l’homme, amène la prolifération des plans d’investigation : là où le choix n’intervient pas, l’indécision est couronnée de multiplicité. La sociologie pluraliste, chère à Gurvitch, nous la trouvons ici, parfaitement illustrée, bouillonnante et rigoureuse. Univers découpé, en parties de parties de parties, morcellement schizophrénique du corps humain, énumération des points de vue semblable à une sociologie de la connaissance ; ainsi la pluralité s’insinue dans les jugements (de gentilshommes campagnards, de pensionnaires, de petits employés, etc.), dans l’esprit (de l’Histoire, de l’Antiquité, de la langue, etc.), dans l’innocence des écoliers (innocents dans leur volonté de ne pas l’être, innocents une femme dans les bras, etc.), dans la Jeunesse (Adolescents, Jeunes Hommes, Garçons, Komsomols, Jeunes Sportifs, Jeunes Pieux, Gamins Fripons, Jeunes Esthètes, Jeunes Philosophes, etc.) et dans la foule paysanne (les palefreniers, les filles, les tâcherons, etc.). Le pluralisme accompagne nécessairement un nihilisme qui ignore la conciliation dialectique : par-delà l’affrontement de l’Adolescent et de l’Adulte, ou des Jeunes entre eux, il n’y a rien, sinon précisément cette pluralité de positions, ce flux de la vie. Il n’est pas étonnant que les nombreux duels mettant aux prises des regards ennemis tombent dans la surenchère et n’aboutissent qu’à la proclamation vainqueur provisoire. Le Garçon et l’Adolescent entament un duel à la grimace, l’Analyste et le Synthétiste se lancent dans une joute verbale puis dans un duel au pistolet ; une condamnation latente de la dialectique qui croit résoudre les conflits ou les contradictions, alors que les situations demeurent inchangées ou qu’en définitive le dernier mot ne revient à personne, telle est l’essence d’un pluralisme ne s’enfermant pas dans le dilemme mais tirant des données un maximum de joie et d’humour : « en toute rigueur l’Analyste avait gagné, mais qu’en résultait-il ? Absolument rien. » (F 110). La diversité règne dans la société et dans l’individu ; ainsi l’âme ne possède pas d’unité supérieure mais est composée d’un système de forces conscientes et inconscientes ; mieux encore, les rapports de l’âme et du corps traduisent la dispersion, l’altérité et l’autonomie des parties du corps ou de l’esprit ; toutefois si l’on admet la fiction du Moi, on est en droit de reconnaître l’intersubjectivité ; en effet, s’inspirant d’une sociologie marxiste et empiriste, Gombrowicz constate que les relations entre les hommes sont les seules réalités qui entrent en ligne de compte.
Bien que disloquant le corps et l’esprit, qu’il soit social ou individuel, Gombrowicz éprouve la nécessité de s’appuyer sur les liaisons entre le corps et l’esprit, entre la société et l’individu. Paradoxalement, c’est en multipliant les exemples où la séparation intervient qu’on introduit un mélange des situations et des valeurs : le Supérieur ne s’isole pas, mais est violé et fécondé par l’Inférieur. Psychanalyste des œuvres poétiques, Gombrowicz va plus loin : derrière la Beauté, la Technique ou la Conscience de classe se cachent les Cuisses. Jusqu’à présent nous avons aperçu l’envergure théorique de Ferdydurke, cela est insuffisant car l’invention et le génie d’un tel récit résident dans l’histoire savamment développée, dans la répétition d’expressions hautement symboliques, dans la description des mythes sociaux. Pourquoi l’intérêt de Gombrowicz est-il fixé par la pantomime des corps ? Comment imaginer que l’orteil de son héros puisse réagir avec autant d’intensité ? L’analyse de l’âme se double d’une analyse du corps : le corps signifie, une partie de l’esprit parle à travers le corps ; et voilà que l’esprit social s’exprime dans le corps individuel : on nous fabrique la cuculosème et on nous fabrique la gueule. Pimko, modèle du vieux professeur pontifiant et malicieux, gardien des valeurs culturelles, ne cesse de fabriquer le cuculet de notre héros, qui a pourtant dépassé les trente ans : l’éducation, l’infantilisation se porte sur la zone anale, en un premier stade ; ensuite, l’individu s’est tellement assis, a été si profondément cuculisé qu’il est prêt à être domestiqué en sa seconde zone érogène : il sera défiguré ; le visage devient une gueule, un masque à grimaces, le réceptacle de la laideur. Comme le regard et le geste, l’amour et l’indifférence, ne cessent d’affecter les relations humaines, d’étonnants rapports de possession s’instituent : un mot, une attitude suffisent à rapetisser l’Autre ; une image, un symbole m’introduisent dans la sphère de l’Autre, où je demeure prisonnier ; et toute l’agitation de la vie consiste à enfermer l’Autre en moi, au lieu de me perdre en lui. Les actes et les paroles sont placés entre les hommes, mais à qui sont-ils destinés ? La volonté de donner une signification aux détails, à l’insignifiant dépasse le cadre d’une psychanalyse : Gombrowicz trace les lignes imaginaires reliant ses personnages, indique les directions des forces inconscientes, et surtout donne aux petits phénomènes, aux parties de parties, un sens d’une surprenante cohésion.
Pour qui, ceci ou cela est-il fait ? Cette question nietzschéenne est implicite ; si le lecteur découvre un début de réponse c’est qu’il entrevoit la complicité des êtres, des choses ; la beauté et l’humour sont parmi les éléments de cette pluralité qui ne se laisse pas aisément interpréter : « Avait-elle vu la branche dans la bouche du mendiant, avait-elle deviné pour qui il la tenait ? » (F 161). Gombrowicz nous introduit dans le secret des impressions et des idées, des fantasmes et des croyances. Le héros de Ferdydurke, ni jeune ni adulte, invente des rites et des jeux qui à la longue modifient la réalité des objets et des êtres. Isolé dans une famille qui incarne la modernité, il se débat et tente d’exorciser son internement. Des conduites quasi magiques lui permettent de rompre l’envoûtement de la modernité. Divers procédés sont utilisés : il danse dans la chambre de ses hôtes pour qu’éclatent le ridicule et le mauvais goût – le caractère hygiénique de la modernité en particulier ; il arrache les pattes et les ailes à une mouche qu’il fourre dans la sandale de la fille de la maison – son ennemie – pour détruire, à travers cette torture, les objets et les images de son monde. Gombrowicz résume ainsi les intentions et les actes de son héros : « Le barbu verdoyant demeurait à son poste – la mouche souffrait silencieusement dans la sandale, maintenant chinoise, byzantine – dans la chambre des Jouvencel ma danse était restée – je commençais à fouiller plus à fond parmi les affaires de la moderne. » (F 166).
Mais le grand exemple de la manière de Gombrowicz et de ses intuitions est certainement le récit de nombreux mythes sociaux, comme ceux de la lycéenne moderne et de la fra…ternisation avec le palefrenier. L’Image Symbolique Idéale de la Lycéenne Moderne a donc été explicitée en 1937, avant qu’elle ne devienne une Image connue de tous. Le délicieux mythe ne se comprend que dans une confrontation entre la sociologie et la psychanalyse, mais nous nous en tiendrons aux prémisses de Gombrowicz, pour qui la beauté et la force résident avant tous dans la jeunesse ; or, la lycéenne est doublement jeune : par son âge, et par son appartenance à ce qu’il y a de plus avancé dans la société c’est-à-dire de plus moderne ou de plus jeune ; c’est la jeunesse par la jeunesse, comme dit Gombrowicz. Inutile de retracer le portrait de la lycéenne, il suffit de lire Ferdydurke ou bien d’entreprendre la sociologie de la chanson des jeunes chanteurs actuels – auxquels un grand intérêt est porté, comme si leur Image recoupait en profondeur celle de la Lycéenne Moderne. Gombrowicz montre bien que la plupart des catégories et classes sociales sont préoccupées par la lycéenne moderne : bon nombre d’hommes lui envoient des lettres, en cachette il est vrai ; que disent dans leurs billets intimes les lycéens, les étudiants, les politiciens, les militaires, les pharmaciens, les commerçants ? Ils parlent de tout, en particulier du fait qu’au fond ils incarnent le Garçon Moderne, mais ils oublient, semble-t-il, l’essentiel, à savoir la Cuisse. Gombrowicz dévoile l’un des attraits de la lycéenne moderne, la cuisse ; aussi pour lui, les poèmes que reçoit la jeune fille ne peuvent être clairement traduits qu’en termes de cuisse. Nous voyons donc à quelle allure les parties du corps singent les réalités individuelles et sociales. À lire les laborieuses phénoménologies du corps de certains philosophes, on ne craint pas de dire que Gombrowicz donne une raclée aux représentants de la pensée publique : en tant que psychanalyste distingué et historien aguerri, Gombrowicz situe dans le corps l’expression des conflits sociaux, la différence entre la ville et la campagne ; le déroulement de toute une culture peut être lu dans un déhanchement, dans le mouvement d’une main, dans la grimace d’un visage : « La hiérarchie séculaire reposait sur la domination des parties du corps seigneuriales, et c’était une hiérarchie tendue et féodale, où la main du Maître équivalait à la gueule du serviteur, et où son pied arrivait à mi-hauteur du corps campagnard. » (F 247). Le mythe de la fraternisation avec le palefrenier (mélange curieux d’un retour au bon sauvage et de la main tendue au prolétariat), les Images Symboliques de la lycéenne, de l’Inférieur, de la Tante, du Domestique, tel est l’univers où le cucumignon et la gueule disent mieux qu’un discours les aventures des rapports entre les hommes. Les objets et la Nature sec métamorphosent en parties du corps, et se mettent à parler à leur tour : la lune est un cucugnard et le soleil un super-archicul resplendissant. Mais assez de puérilités, direz-vous, fabriquez de la gueule.
La Pornographie ou la mise en scène
De la gueule, il y en a plus qu’il n’en faut dans La Pornographie ou dans le Journal. La pornographie n’est pas seulement un érotisme inférieur ou supérieur, elle est la complicité radicale qui lie deux adultes entraînés dans le mystère de l’interprétation des conduites et dans l’art de la mise en scène. Nos deux hommes, gagnés par la Maturité, s’exercent à modeler le comportement d’un garçon et d’une fille qui, selon eux, sont faits l’un pour l’autre. Être pornographe c’est reconnaître ce qui va ensemble, c’est identifier les combinaisons érotiques, c’est pratiquer l’art pervers des mélanges : la complicité des êtres, la correspondance entre les choses, s’effectuent dans le silence, car les situations parlent d’elles-mêmes, et il n’est guère besoin de répéter par le discours ce qu’on a vu ou ressenti. Et la pornographie d’après Gombrowicz ne se résume pas à la patiente attente du voyeur, elle est une invention permanente qui permet de jeter un regard sur le voyeur, et surtout de lire dans les événements pour parvenir au but ultime, à savoir la mise en scène. On fait jouer les autres, on distribue les rôles, cela pour former un ensemble chargé de sens. Parmi nos deux messieurs, Frédéric est celui qui élève la pornographie à son niveau le plus haut, la Création ; et il va jusqu’à défier la Nature, autre puissance créatrice, qui parfois ne joue pas le même jeu que lui. Une des finesses de Frédéric consiste à suggérer dans son discours un autre discours : la parole se dédouble, le sens dévoilé et caché détruit le sens de l’énoncé. L’écoute et le regard, les intentions et les intensités, les impressions et les sentiments sont mis à l’épreuve : le déchiffrement de l’insignifiant accompagne le gigantesque projet d’interprétation. Ainsi le fait d’écraser un ver peut signifier pour la jeune fille le désir de piétiner son fiancé. Une chimie des corps amoureux est tentée par Frédéric : le composé initial (la fille avec le garçon) donne la véritable clé de l’histoire ; des formules chimiques symbolisent alors certaines relations humaines. Mais ce qui pour Gombrowicz unit les êtres est infiniment complexe ; la complicité, le secret, l’art de la suggestion sont les composants d’une pornographie où l’imagination occupe la première place : « quel admirable système de miroirs : il se réfléchissait en moi, moi en lui, et ainsi, tissant chacun des rêves pour le compte de l’autre, nous en arrivions à formuler des intentions qu’aucun de nous n’aurait osé reconnaître pour siennes. » (P 90-91).
Psychologie à la Gombrowicz : on détermine pour qui les choses se font ; on invente aussi des jeux, on crée la vie, bref on met en scène ; spectacle de soi-même et de l’Autre ; expérience des combinaisons et des mélanges ; les mécanismes du théâtre et de l’existence sont démontés puis remontés. Les acteurs sont dirigés par des mains de maître et apprennent à jouer ensemble : « ce jeu avec les fourchettes prolongeait de toute évidence le jeu factice dans l’île et ce flirt ébauché entre eux était entièrement “théâtral”. » (P 194). Gombrowicz expose dans La Pornographie la manière de lier l’imagination à l’action, grâce à une mise en scène de soi-même et des autres. La libération des actes, des sentiments et des idées est facilitée par la, représentation de la vie comme théâtre, comme improvisation et méditation des conduites. Les jeux et les répétitions, le langage et l’action se placent d’emblée sur le terrain de la création ; mais là, il n’est pas dit que la liberté règne ; la Nature veille et aucun cynisme ne peut la prendre complètement à revers. Gombrowicz participe à un temps essentiellement humain ; l’annonce par Nietzsche de la mort de Dieu a été entendue. En effet Frédéric, présent dans une église, à, genoux, consacre la mort de Dieu : pour Gombrowicz, la mise en doute de l’existence divine ne réclame pas le cri ni le blasphème mais simplement une présence humaine capable de transformer l’atmosphère sainte d’une église en un vaste espace cosmique où Dieu n’existe plus, où le vide et l’infini, l’homme et son esprit se distribuent suivant un ordre éminemment ironique. L’homme retrouve une puissance, mais il ne va pas où il veut, il suit les lignes de force de son désir.
Yvonne, Le Mariage : les mises en bière
L’imagination est aussi à l’honneur dans le théâtre de Gombrowicz. Logique capricieuse des répliques, pourtant rôles et acteurs sont bien déterminés, mélangés. Apparaît Yvonne, symbole de la laideur physique, que va-t-il se passer ? Le beau prince, mis hors de lui, ne peut que vouloir l’épouser. L’imagination vagabonde : la plaisanterie, la bouffonnerie, l’humour et l’absurdité se côtoient ; les lois de la nature et de la raison sont remises en question. Le prince veut montrer qu’une fille laide peut plaire ; d’une façon générale, il s’agit de briser les cercles de la dialectique (apathique parce que maussade, maussade parce qu’apathique). Mais le Prince revient sur sa décision d’épouser Yvonne : elle, a encore en elle une certaine représentation du prince, elle le possède ; il se trouve à l’intérieur d’elle ; il décide de la tuer. Lors d’un banquet trop officiel, les arêtes d’un poisson étranglent Yvonne : le savoir étouffe, dit le devin de Zarathoustra, ici c’est l’intimidation par les bonnes manières qui étrangle Yvonne. Gombrowicz poursuit sa quête d’images nouvelles et proclame le règne de l’Homme sur terre ; les leçons de Nietzsche sur la mort de Dieu sont acceptées en partie, le meilleur des croyances d’un Marx ou d’un Bergson est revu ; Gombrowicz parle alors du Mariage en ces termes : « Henri crée le rêve et le rêve crée Henri, l’action se crée elle-même aussi, les personnages se créent mutuellement et l’ensemble va au hasard vers des solutions inconnues. » (TH 87).
L’imagination des hommes est seule responsable des lois de l’histoire, de cette Église de la terre ; il suffit de toucher avec un doigt les personnages intouchables pour les désacraliser, et de se toutoucher pour se donner le sacrement du mariage : « le sacré, la majesté, le pouvoir, la loi, la morale, l’amour, le ridicule, la bêtise, la sagesse, tout cela vient des hommes, comme le vin du raisin. » (TH 158). La Raison et Dieu ont perdu de leur vivacité, mais l’homme qui nous est donné est inachevé, mouvant, préférant l’instant à l’absolu, embrouillé dans le réseau des forces en présence ; ce qui définit cet homme moderne est plutôt étrange : le toutouchement lui appartient en propre (toutouchement comme attouchement sexuel mais aussi comme association d’idées ou de personnes). Si Gombrowicz évoque la mort de Dieu ou la mise à mort de certains personnages, c’est que la rapidité d’effacement des images est indéniable chez l’homme moderne, chez le narrateur : nous nous souvenons, nous oublions aussi, les événements voltigent dans le vide, les apparitions succèdent aux disparitions. Suicide et meurtre indiquent l’insidieuse attirance pour la mort : parfois facilité à ne pas être, parfois difficulté d’être. Vie et mort mettent à découvert le subtil ressort de l’imagination : les corps se dissolvent, les mots surgissent ; les images éclatent, s’amplifient ou se ternissent. Et mourir n’est pas la vague nécessité d’un discours imagé ; donner la mort ou se donner la mort, c’est laisser parler l’inconscient : l’imagination suscite les plus belles synthèses, les actes les plus vivants ; elle nous entraîne à de pernicieuses analyses ; et nous nous détachons de toute raison humaine. Puissances de la mort et de la vie troublées par les forces sanglantes ou esthétiques de l’imagination.
Gombrowicz s’arrête à l’homme, aux relations entre les hommes. Il montre comment le Supérieur est assujetti à l’Inférieur, pourquoi le jeu de l’acteur doit être infiniment conscient, que tout repose sur l’individu et que l’esprit collectif n’a de cesse de s’exprimer. Gombrowicz puise évidemment dans notre temps formes, images et mythes. Il possède, à l’égal d’un Jarry, automatisme et réflexion ; il manie comme un réalisateur de cinéma – Polanski, Has – les plus intenses visions. Gombrowicz se promène dans un humour et dans ses souvenirs ; et la tête du lecteur bouge. Qu’y a-t-il ? Un début de fra…ternisation, sans doute.
Georges Sebbag
Références
« Gombrowicz ou la mise en relation », Critique n° 226, mars 1966.