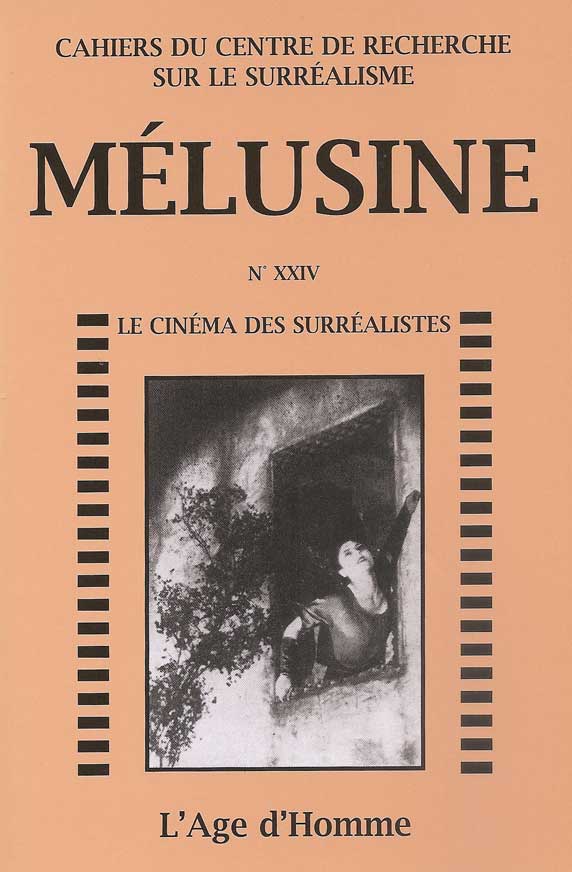 Le cinéma et le surréalisme ont ceci en commun qu’ils sont tous deux défunts et survivent néanmoins. Nous étayerons ce parallèle, entre la survie du cinéma et la survivance du surréalisme, par divers rappels et analyses. Second postulat : la technoscience et l’économie de marché continuent à structurer le monde contemporain. Nous essaierons pourtant de montrer que la foi en la science ou en la richesse des nations ne suit pas ou ne suffit plus. Un imaginaire inattendu, tournant autour du spectacle et des médias, du tourisme et des loisirs, est venu relayer la rêverie scientiste et les fantasmes hédonistes. Mais cet imaginaire ne nous dira rien si nous le réduisons à un fatras d’images ou si nous nous laissons bercer ou berner par la rhétorique des communicateurs. En revanche, nous en palperons l’étoffe dès lors que nous y verrons une expérience pure et subjective du temps.
Le cinéma et le surréalisme ont ceci en commun qu’ils sont tous deux défunts et survivent néanmoins. Nous étayerons ce parallèle, entre la survie du cinéma et la survivance du surréalisme, par divers rappels et analyses. Second postulat : la technoscience et l’économie de marché continuent à structurer le monde contemporain. Nous essaierons pourtant de montrer que la foi en la science ou en la richesse des nations ne suit pas ou ne suffit plus. Un imaginaire inattendu, tournant autour du spectacle et des médias, du tourisme et des loisirs, est venu relayer la rêverie scientiste et les fantasmes hédonistes. Mais cet imaginaire ne nous dira rien si nous le réduisons à un fatras d’images ou si nous nous laissons bercer ou berner par la rhétorique des communicateurs. En revanche, nous en palperons l’étoffe dès lors que nous y verrons une expérience pure et subjective du temps.
Durées filmiques
Pour Bergson, l’intuition du temps relevait de l’exploit, car jusqu’à lui, le temps était spatialisé, numérisé. Ni les philosophes, depuis Zénon d’Élée, ni le commun des mortels, surtout à l’âge industriel, n’échappaient au mouvement des astres, au déplacement des aiguilles sur les horloges. Or voilà qu’au moment même où Bergson a eu pour ambition de percevoir « la création continue d’imprévisible nouveauté » ou, si l’on préfère, d’écouter la mélodie de la durée, on a justement inventé une modalité technique d’appréhension du temps. Et contrairement à ce que redoutait Bergson, la culture occidentale ne travaillait pas seulement pour l’espace mais se mettait délibérément au service de la durée. Car le cinéma a été notre grand initiateur, notre grand pourvoyeur en durées. Alors qu’il fallait des années pour accéder au livre, tout un cérémonial pour pénétrer dans un théâtre, la salle de cinéma a offert immédiatement et à chaque séance le traitement d’une passion. Le grand écran a montré à toutes les populations de la planète que le pauvre espace n’était qu’une espèce de durée. À chaque plan, à chaque séquence, les spectateurs calés dans leur fauteuil s’introduisent sans gêne dans une image mouvementée, dans une durée enseuillée.
Grâce au cinéma, le temps n’est plus inimaginable, comme le croyaient les philosophes, il se réalise, se matérialise sous nos yeux. Mais cette leçon nous l’avons un peu oubliée car nous n’en sommes plus à téter les durées filmiques d’une séance hebdomadaire, nous nous abreuvons en durées artificielles à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. À présent, le public planétaire intuitionne des durées sans désemparer.
Durées surréalistes
En découvrant le double jour de naissance d’André Breton, le 18 février et le 19 février 1896, j’ai acquis la conviction que Breton et les surréalistes avaient inventé ce que j’ai appelé des durées automatiques ou durées surréalistes. Pour le dire vite, une durée automatique est un mixte de message automatique et de hasard objectif. Exemple de message automatique : « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre », phrase de présommeil entendue par Breton vers janvier 1919. Exemple de hasard objectif : le lundi 16 janvier 1922, Louis Aragon, André Breton et André Derain qui se retrouvent au café des Deux Magots constatent qu’ils viennent successivement de manquer leur rencontre avec la même jeune femme. Exemple de durée automatique : l’apparition de l’année 1713 lors du tracé de la signature d’André Breton.
Une durée automatique est un message qui ne nous est pas spécialement destiné et qui nous atteint pourtant de plein fouet. C’est un collage temporel, bruissant de désirs, de sons et d’images. Bref, c’est une durée qui nous parle, au gré du temps sans fil.
Mais sur le terrain des durées, les surréalistes ne sont pas arrivés les premiers. Ils ont trouvé deux cadeaux dans leur corbeille de naissance : le concept bergsonien de durée ainsi que les premières durées filmiques du cinématographe.
Poussière de microdurées
Telles des habitudes vite prises et exhibées, les microdurées pullulent et rivalisent avec l’ordre stable des choses et des dictionnaires. Une émission, une affiche, un slogan, un trajet, ou tous faits et gestes, paroles et événements remplissant les conditions d’apparition d’une durée, arrachent le monde à la quiétude des choses et de leurs définitions et le précipitent, non dans le gouffre du néant, mais dans un devenir perpétuel brassant des bris de mots et des débris de conscience. Ces passe-temps à vide qui ne relèvent déjà plus du divertissement ni des loisirs invalident les repères existentiels et historiques et, se jouant de la chronologie, donnent l’impression de pincer les cordes, d’effleurer les touches d’une multitude de sensations et de situations.
Que nous le voulions ou non, nous expérimentons des durées, bien plus que nous n’usons des choses et des mots. Plus rien n’oppose le mort au vivant, l’inerte au mouvant. Déjà les durées aimantées du hasard objectif et de l’écriture automatique, passant outre le temps irréversible et segmenté, fomentaient des événements, opéraient des rapprochements, imposaient des recoupements, mêlant les sortilèges des lieux et de la mémoire, redistribuant les dates des biographies et de l’histoire. Déjà, les durées filmiques, en remaniant le temps qui fuse et qui s’efface, magnifiaient l’éphémère et raccordaient directement une quantité de corps et de décors, de voix et d’émotions, laissant loin derrière les représentations scéniques et les récits romanesques. Mais à présent, avec les microdurées des médias, un pas est franchi. Les autorités du réel, comme les mœurs ou les institutions, sont, en dépit de leur extériorité, percées à jour et débusquées. Les réserves connues de l’imaginaire — les beaux-arts, les faits divers, sont surexploitées et systématiquement pillées. Dès lors, la durée pulvérisée, dont il importe peu de connaître l’origine et la teneur, s’amoncelle sur les étagères des médiathèques, imprègne l’air ambiant et électrise les consciences.
Régime général des durées
À défaut de voisins et d’amis, on a récolté le grand nombre. Désormais on entend des mots sans les comprendre, on caresse des objets sans les toucher, on jongle avec des valeurs sans les juger. Toutefois, le régime des durées qui convoque des sujets désirants et pensants, qui combine l’outil technique et l’effet immédiat, qui capte le sens et l’émotion, qui fascine et irrite, qui remanie des matières temporelles déjà élaborées, ne se réduit pas aux relations équivoques de médias mégalomanes avec une masse d’individus isolés et déboussolés. Au-delà des prouesses techniques et d’un certain vide politique, la contemplation active et inespérée du temps, expérimentée à une vaste échelle, porte un coup d’arrêt à ce qui rappelle le passé — les solides habitudes, les gestations lentes, les ressassements de l’origine, les références historiques —, et même à ce qui annonce l’avenir — l’utopie révolutionnaire, l’aventure moderne, le culte de la jeunesse. Le cloisonnement traditionnel passé / présent / futur ne résiste pas à la pratique intempestive du temps : une durée, ou une microdurée, n’est pas perçue une fois pour toutes, elle peut se glisser ici et là entre deux pages ou entre deux jours.
Alors que, dans l’approche classique du temps, on admettait la transformation de la Nature, du langage et de la société, mais sans jamais douter de leur réalité transcendante, avec les durées automatiques ou artificielles, on s’emploie, au contraire, à révéler le caractère immanent des choses, des mots ou des gens. Une durée peut se polariser sur une lumière ou un son, comme elle peut mêler, délicatement ou violemment, une masse de signes, d’objets et de personnes. Toutes ces choses sont montrées, non telles qu’elles sont, mais telles qu’elles coexistent dans une conscience. Le monde connu n’existe plus. Il est enfin mis entre parenthèses. L’esprit se concentre sur un absolu. De même que la langue écrite s’est efforcée de ne pas mimer la parole, une durée artificielle ou synthétique n’enregistre pas un fait, ne reconstitue pas une histoire. Elle jette les bases de sa perception et de sa perpétuation. Elle entraîne la conscience qui se découvre elle-même dans ce lâcher d’oiseaux, dans cette démonstration d’immanence.
Le tournage de Nadja
Qu’est-ce que Nadja ? Un roman ? Surtout pas, le poète dada-surréaliste a les romans en horreur. Un reportage ? Attention, l’auteur de Nadja ne fait pas dans le journalisme. Une confession ? Sans doute. Mais qu’est-ce donc au juste ? Voyons, c’est un film qui défile sous nos yeux, un montage de durées automatiques et d’images-durées, un scénario où comme il se doit sont généreusement brassées les temporalités sans fil des plans et des séquences. D’ailleurs une cinquantaine de photogrammes est généreusement fournie au public qui aurait raté la sortie du film. À cet égard, deux photogrammes successifs de Desnos assoupi et de Desnos éveillé ont bel et bien été taillés dans la pellicule du film Nadja. De même que dans une séquence de Nadja, André Breton et Jacques Vaché saucissonnent, trinquent et causent, en pleine séance de cinéma, « à la grande stupéfaction des spectateurs », de même, et en retour, la caméra accompagne les vedettes Nadja et Breton tout au long de leurs déambulations ou lors de leurs stations au café ou au restaurant.
Il ne faut pas croire que les surréalistes guettent la venue du hasard objectif les bras croisés et la bouche bée. Quand Breton rencontre Nadja le 4 octobre 1926, le décor du film est déjà planté, plusieurs plans et séquences ont été tournés. L’hôtel des Grands Hommes, la statue d’Étienne Dolet, Paul Éluard, Desnos endormi, la très belle et très inutile porte Saint-Denis, l’enseigne « BOIS-CHARBONS », le serial en quinze épisodes L’Étreinte de la pieuvre, la librairie de L’Humanité, etc., toutes ces durées, vécues, élaborées, filmées par Breton seul, n’attendaient plus que l’entrée en scène de Nadja. Sans repérages, sans décors, sans photographies prises sous un certain angle, sans caméra attentive, sans répliques, sans la voyante Madame Sacco, sans poésie, sans durées préenregistrées, Breton n’aurait jamais rencontré la vedette du film et tourné avec elle des séquences exigeant des deux acteurs, des deux metteurs en scène une égale disponibilité.
Fiction du document, document de la fiction
Au cinéma, les durées filmiques ont une épaisseur temporelle. Elles sont documentées par le temps. Les durées automatiques qui surviennent dans la ville ou la rue surréaliste mêlent aussi deux états d’esprit : incrédulité devant la coïncidence, authentification de la merveille. Le dada-surréalisme, au même titre que le cinéma, n’est ni réaliste ni romanesque. Il n’est ni réaliste ni empiriste : ses trouvailles ne sont pas le fruit d’une observation servile. Il n’est ni romanesque ni fantaisiste : il est trop soucieux d’exactitude pour se laisser aller à broder ou même à mentir vrai.
Le cinéma est par définition un documentaire surréaliste. C’est pourquoi il n’a rien à voir avec les enregistrements et les platitudes télévisuelles. Tous deux, cinéma et surréalisme, savent pertinemment qu’ils ne trempent pas dans la réalité, mais qu’ils fourbissent des durées. Notons en passant que la réalité n’est pas un simple objet à décalquer. On ne l’attaque pas de front, comme le croient les véristes et les scientistes. On ne peut l’aborder que de biais, en multipliant les perspectives.
Cinéma et dada-surréalisme sont frères jumeaux. À preuve, Vaché et Breton, qui zappaient d’une salle de cinéma à l’autre et s’administraient une bonne dose de durées filmiques. C’est pourquoi il y a maldonne à vouloir dresser une liste de films surréalistes. Même si le fameux tableau « Lisez / Ne lisez pas » a inspiré un « Voyez / Ne voyez pas », les surréalistes n’ont jamais trouvé le moyen d’enrichir la liste des films authentiquement surréalistes, limitée à quelques titres immuables : Fantômas, Nosferatu, Ombres blanches, L’Âge d’or, Peter Ibbetson… Ils étaient embarrassés car ils avaient du mal à reconnaître leur dette envers le cinéma. Ils n’ont pas osé admettre que les durées surréalistes et les durées filmiques puisaient à une source unique, celle de la contemplation métaphysique du temps.
À ce propos, un témoignage personnel. Dans le groupe surréaliste, la discussion sur un film tournait vite court. Il était convenu qu’on s’amourachait d’un film comme d’une personne. On ne jugeait pas, on entretenait une relation passionnelle avec le cinéma. On trouve un écho de cette attitude dans Le Surréalisme au cinéma d’Ado Kyrou : « Le film existe avant tout par le spectateur. » Le même Kyrou, après avoir fait l’éloge de navets français et italiens, de mélos religieux et érotiques, et qualifié de chefs-d’œuvre des séquences pornos d’avant-guerre visibles dans des appareils à sous, s’exclamait alors : « Je vous en conjure, apprenez à voir les “mauvais” films, ils sont parfois sublimes. »
Roman-feuilleton et « ciné-drame »
Une gardienne de phare bretonne qui a reçu la visite d’un romancier découvre jour après jour dans le journal un feuilleton relatant sa propre histoire et donnant des nouvelles de son fiancé disparu. En 1917, quand Apollinaire et André Billy écrivent le « ciné-drame » La Bréhatine, ils ont sans doute conscience que les serials du cinéma ont pris le relais des feuilletons populaires publiés dans les journaux avant d’être vendus en fascicules ou en volumes. On remarque au passage que le roman-feuilleton a longtemps tenu en haleine un vaste public en maîtrisant deux formes temporelles : le découpage des épisodes dans le récit et leur lecture journalière ou hebdomadaire. Le scénario d’Apollinaire a non seulement le mérite de démonter le principe de fiction dont la gardienne de phare est victime, mais de suspendre l’action du film à la régularité fatale de la livraison du journal. Si un livre est un carrefour de phrases et de paragraphes, un film est un écheveau inextricable de durées combinant le temps du tournage et du montage (mise en pièces des durées), le temps du film (durée de la projection), le temps du spectateur (perception unitaire du film) et le temps projectif propre au cinéma (fiction du document, réalisation de la fiction). La matière première et dernière du film étant la durée ou, en d’autres termes, l’esprit, le scénario ne joue alors qu’un rôle accessoire. Aide-mémoire pour le réalisateur et les acteurs, le scénario n’est pas identifié par le spectateur, qui perçoit des affects, des sons, des visages, des couleurs et non la trame d’un récit. Tout en gestuelle et en gags, un film de Buster Keaton peut se passer d’un scénario d’écrivain.
« Quel film je jouerai ! »
La plupart des amis d’Apollinaire étaient subjugués par Charlot et le cinéma. En janvier 1918, Philippe Soupault publie dans Sic une « Note sur le cinéma » suivie d’une sorte de synopsis intitulé « Indifférence ». D’un côté, il précise que le cinéma, déjouant les lois de la nature, n’a rien à voir avec le théâtre, d’un autre côté, son « poème cinématographique » abonde en transformations temporelles et autres accélérés. Il récidivera avec une série de six « Photographies animées ». Dans Sic d’octobre 1919, Pierre Albert-Birot ne sera pas en reste avec son essai « Du cinéma » et son scénario « 2 + 1 = 2 ». L’enthousiasme des dada-surréalistes pour le cinéma n’est pas feint. Il suffit de lire coup sur coup « Du décor » de Louis Aragon paru dans Le Film du 15 septembre 1918 et la lettre de Vaché à Breton du 14 novembre 1918 :
Ce grand démon aux dents blanches, les bras nus, parle sur l’écran une langue inouïe, mais qui est celle de l’amour. Les hommes de tous les pays l’entendent […] La porte d’un bar qui bat et sur sa vitre les lettres capitales de mots illisibles et merveilleux, ou la vertigineuse façade aux mille yeux de la maison à trente étages, ou cet étalage enthousiasmant de boîtes de conserve (quel grand peintre a composé ceci ?), ou ce comptoir avec l’étagère aux bouteilles qui rend ivre à sa vue […] Tout notre émoi subsiste pour ces chères vieilles aventures américaines qui relatent la vie quotidienne et haussent au dramatique une bank-note sur laquelle se concentre l’attention, une table où repose un revolver […] Oh ! ce mur quadrillé des Loups sur lequel l’homme de Bourse, en bras de chemise, écrivait le cours des valeurs ![1]
…je sortirai de la guerre doucement gâteux […] ou bien… ou bien… quel film je jouerai ! — Avec des automobiles folles, savez-vous bien, des ponts qui cèdent, et des mains majuscules qui rampent sur l’écran vers quel document !… Inutile et inappréciable ! […] — Téléphone, bras de chemise, avec des gens qui se hâtent, avec ces bizarres mouvements décomposés […] Je serai trappeur, ou voleur, ou chercheur, ou chasseur, ou mineur, ou sondeur — Bar de l’Arizona (Whisky — Gin and mixed ?) […] J’ai lu l’article (dans Film) sur le cinéma, par L.A., avec autant de plaisir que je puis, pour le moment.[2]
Le cinéma enchante le quotidien. On peut changer sa vie comme on joue dans un film. Les dada-surréalistes en herbe ont été subjugués par la liberté des feuilletons de Feuillade, la désinvolture des burlesques américains, l’intensité des images-durées. Louis Aragon, dans un compte rendu de Photogénie de Louis Delluc, n’hésite pas à faire du cinéma la clé métaphysique du monde : « […] le cinématographe, aux yeux d’une génération, restera la meilleure hypothèse poétique pour l’explication du monde. »[3] Le mot cinéma s’impose encore à Aragon lorsqu’il analyse le processus de pensée de Lautréamont : « Un cinéma cérébral. »[4] Autre signe fort : les contes et la poésie de Benjamin Péret semblent contaminés par le cinéma burlesque. En mai 1923, Pulchérie veut une auto, truffé de gags et de poursuites, paraît dans Littérature sous le label « film ». Ultime touche : Minuit à quatorze heures, le scénario en bonne et due forme de Robert Desnos publié en 1925, est sous-titré : « Essai de merveilleux moderne ».
Retour sur Nadja
Revenons au film Nadja tourné par André Breton et Léona Delcourt, alias Nadja. Depuis la récente vente Breton à Drouot, nous pouvons tous consulter les lettres de Nadja. Très vite, Breton entreprend d’écrire un récit de la décade enchantée du 4 au 13 octobre 1926. Et il soumet le synopsis à sa coréalisatrice. Celle-ci réagit violemment le 1er novembre : « Comment avez-vous pu m’écrire de si méchantes déductions de ce qui fut nous, sans que votre souffle s’éteigne ? […] Comment ai-je pu lire ce compte rendu… entrevoir ce portrait dénaturé de moi-même, sans me révolter ni même pleurer… » On peut faire l’hypothèse qu’au vu de cette réaction, Breton a demandé à Nadja de contribuer au film en s’exprimant par écrit. Mais le cahier que Léona Delcourt s’appliquera à rédiger n’aura pas l’heur de plaire au réalisateur Breton, qui le jugera « pot-au-feu ». Nadja y verra même le signe fatal de l’indifférence de son amant.
En revanche, les talents de voyante, de mythologue et de dessinatrice de Nadja n’échappent pas à Breton qui, courant novembre, propose à Nadja Delcourt de réaliser, dans le cadre de la collection de boules de neige, au même titre que Man Ray, Tanguy, Malkine ou Picasso, la boule de neige n° 3 : « L’Âme des amants »[5] . Malheureusement, la collection en question capotera. Quoi qu’il en soit, l’imaginaire de Léona Delcourt hante le film Nadja, depuis les repérages jusqu’au montage. Nous savons que le 6 octobre 1926, dans un taxi, pour la première fois, Nadja fermait les yeux et offrait ses lèvres à son partenaire. C’est alors qu’elle dit incarner Hélène, personnage d’une scène dialoguée de Poisson soluble. Par la suite, dans les lettres du 4 et du 23 décembre, elle identifiera Breton à un autre personnage du sketch, Satan. Or, est-ce un hasard, l’illustration dans Nadja de L’Étreinte de la Pieuvre, « grand sérial mystérieux en 15 épisodes », porte sur le cinquième épisode, intitulé « L’Œil de Satan ».
La page, le drap et l’écran
Depuis l’apparition des durées filmiques et le surgissement des durées surréalistes, la question de la métempsychose se pose à nous autres, modernes contemplatifs. Sans compter que nous ne savons plus où donner de la tête, depuis que nous sommes emportés dans le tourbillon des microdurées médiatisées. Nous sommes devenus des chats. Chacun d’entre nous est plus ou moins sommé de jongler avec sept vies ou plus. Tout cette agitation d’âmes, cette circulation de personnes, cette métempsychose en acte, n’a-t-elle pas été amorcée ou initiée par Nelly Kaplan ? Ne voit-on pas dans sa biographie, sa filmographie et sa bibliographie, les Belen, les Panthères, les Bisons blanc d’or, les Léonie Aubois d’Ashby, les Néa, les Lampes au bec d’argent, les Nostradama se relayer, s’interposer, se superposer ou même se contrarier ?
Un passage de son « ciné-roman » Le Collier de ptyx paraît emblématique à cet égard. Quand Ducasse assiste à la projection de L’Étreinte de la pieuvre il découvre avec stupéfaction sur l’écran Ashby en train de danser avec la Mort, et c’est la Mort qui chavire. La preuve semble alors administrée qu’une séquence filmique, le bal avec la Mort, peut céder la place à une durée surréaliste, à la durée désirée par Ashby.
Pour Nelly Kaplan, la page, le drap et l’écran, et on pourrait y ajouter la toile, sont autant de réceptacles où se projettent et s’accomplissent les désirs irrépressibles de l’amour et de l’écriture. Les vases, comme les temps, sont communicants. Le songe s’épanche dans la vie. La vie est un ciné-roman qui vibre à l’écran.
Mythe, histoire et microdurées
Il y avait la tradition du mythe oral et imagé, transmis de génération en génération. Il y avait la transmission de l’histoire écrite, enseignée aux jeunes générations à l’école. Aujourd’hui, des durées artificielles sont diffusées en permanence à l’attention du public universel. Auditeurs et téléspectateurs, voyeurs et voyageurs, joueurs-vidéo et navigateurs sur internet, consommateurs de marchandises et d’icônes publicitaires, nous passons le plus clair de notre temps à nous abreuver en microdurées. Chômeurs ou employés, bambins ou retraités, nous sommes devenus des experts en la matière. Songeons par exemple au nombre de messages ou de microdurées qu’un téléphone portable avec répondeur peut traiter en une journée.
Le ressassement de la langue parlée et sacrée tendait à révéler une image fantastique des origines. Mais les mythes, faute de ressassement, se sont éteints. L’étude patiente des sources documentaires et monumentales visait à rendre plus crédible la biographie de l’humanité. Or la partie n’a pas été gagnée : un large fossé subsiste entre la crédulité du public et les connaissances pointues des historiens. Sans compter que la philosophie de l’histoire ne fait plus florès, l’avènement des régimes totalitaires ayant représenté pour la dialectique hégéliano-marxiste une forme de désaveu.
L’important, l’étonnant, est que nous ne nous raccrochons plus au fil historique mais au sans-fil des durées. Nous ne sommes plus persuadés que le passé est racontable et que le présent est lisible. Le régime temporel des ans, des âges et des générations est chamboulé depuis que le grand nombre visionne des durées, ou ce qui revient au même, depuis qu’il perçoit dans la pénombre du temps son propre nombre.
En contemplant le temps, les individus du grand nombre exaucent un vœu déclaré ou secret des poètes et des mystiques. Pourtant ils laissent filer, dans le torrent impétueux des microdurées, les durées filmiques et les durées surréalistes. Il n’est pas dit que les durées qui ont l’âge du cinéma et du surréalisme soient les plus précieuses. Il n’est pas dit non plus que nous soyons condamnés à réécrire l’histoire. Au contraire, nous venons de le suggérer, l’histoire ne sera déchiffrée qu’à la lumière des durées.
Si survivait, contre vents et marées, une parcelle de Chirico, Buster Keaton, Breton, Ozu ou Resnais, cela ne serait pas dû à leur inscription dans l’histoire, ni à la dimension mythique de leur art. Cela coïnciderait avec les durées filmiques et les durées surréalistes, qui ont comme propriétés d’éclore et de durer.
Georges Sebbag
Notes
[1]Aragon, Chroniques I, 1918-1932, Stock, 1998, éd. établie par B. Leuilliot, pp. 23-25.
[2] Jacques Vaché, Soixante-dix-neuf lettres de guerre, éd. établie par G. Sebbag, Jean-Michel Place, 1989, lettre n° 76.
[3] Littérature n° 16, septembre-octobre 1920.
[4] « Préface à Maldoror », Les Écrits nouveaux, août-septembre 1922.
[5] Voir le placard publicitaire des Éditions Surréalistes dans La Révolution surréaliste n° 8, 1er décembre 1926.
Références
« Durées filmiques et durées surréalistes », Mélusine n° 24, février 2004.