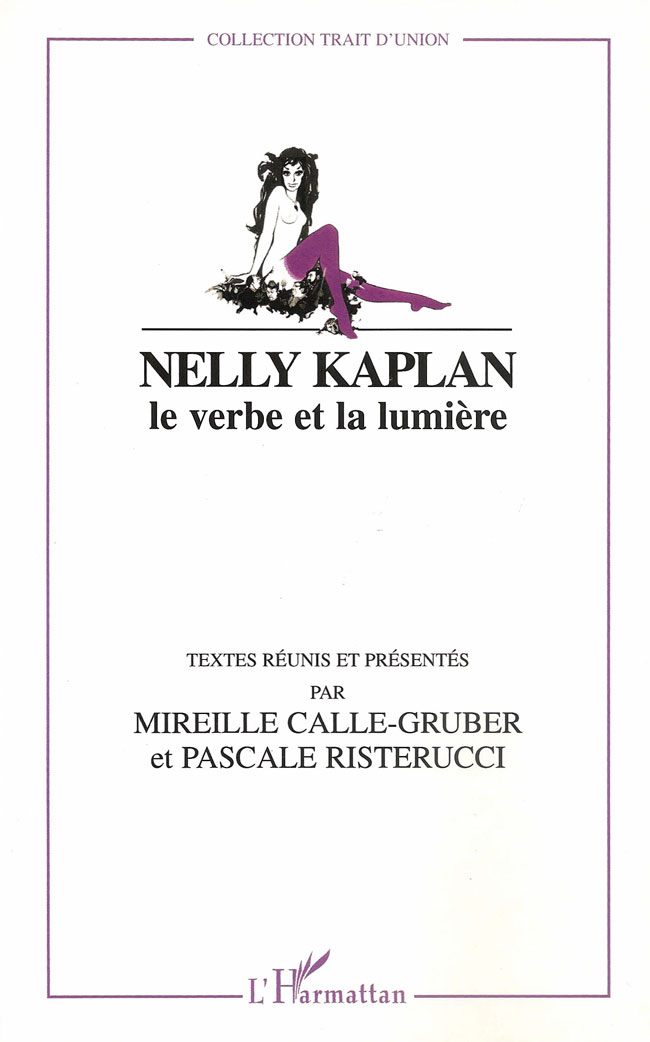
Rappel de l’épisode précédent
En découvrant le double jour de naissance d’André Breton, le 18 février et le 19 février 1896, j’ai acquis la conviction que Breton et les surréalistes avaient inventé ce qu’il faut bien appeler des durées automatiques. Mais qu’est-ce au juste qu’une durée automatique ? C’est un mixte de message automatique et de hasard objectif.
Exemple de message automatique : « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre », phrase de présommeil entendue par Breton en janvier 1919.
Exemple de hasard objectif : le lundi 16 janvier 1922, Louis Aragon, André Breton et André Derain qui se retrouvent au café des Deux Magots constatent qu’ils viennent successivement de manquer leur rencontre avec la même jeune femme.
Exemple de durée automatique : l’apparition de l’année 1713 lors du tracé de la signature d’André Breton.
Une durée automatique est un message qui ne nous est pas spécialement destiné et qui nous atteint pourtant de plein fouet. C’est un collage temporel, bruissant de désir, de sons et d’images. Bref, c’est une durée qui nous parle, au gré du temps sans fil. Notons au passage que Breton a trouvé dans sa corbeille de naissance, d’une part le concept bergsonien de durée, d’autre part les premières durées filmiques du cinématographe.
Mais il est impossible de parler d’André Breton sans évoquer son ami Jacques Vaché. Souvenons-nous de l’aveu du Manifeste du surréalisme : « Vaché est surréaliste en moi. » Aussi l’imprononçable jour de naissance d’André Breton conduit-il inévitablement à l’Épiphanie du 6 janvier 1919, à l’imprononçable jour de la mort de Jacques Vaché.
Autre découverte que j’ai faite : dans les gorges du Verdon, le Point Sublime, qui est le haut lieu du surréalisme, surplombe exactement le confluent du Verdon et du torrent Baou. Depuis que les surréalistes ont lu le poème « Dévotion » de Rimbaud, le mot Baou n’a cessé de résonner avec le nom de Léonie Aubois d’Ashby : « À ma sœur Léonie Aubois d’Ashby. Baou — l’herbe d’été bourdonnante et puante. — Pour la fièvre des mères et des enfants. » J’ai pu montrer que dès l’été 1931 ou 1932 la « mystérieuse passante des Illuminations » hantait le torrent Baou et le Point Sublime, et c’est pourquoi Breton songera à élever personnellement un autel à Léonie Aubois d’Ashby, lors de l’exposition surréaliste de 1947.
L’affiche de Plaisir d’amour
En 1989, j’ai publié dans la revue Gradhiva une première version de ma découverte du saut du Baou et du Point Sublime. En avril 1991, paraissait une seconde version dans la revue Opus International. Or c’est en avril 1991 que se produit un double déclic, offrant une nouvelle perspective à mes recherches. D’abord, le 8 avril 1991, comme à l’accoutumée, je feuillette les journaux, car je tiens une revue de presse dans La Revue des Deux Mondes. Fait inhabituel, mon commentaire va porter sur une affiche qui s’étale sur une demi-page du Figaro, l’affiche de Plaisir d’amour, le film de Nelly Kaplan. Ensuite, le 24 avril, dans la page du Figaro consacrée à l’ouverture de la grande exposition André Breton à Beaubourg, figure cette fois-ci un article de Nelly Kaplan qui m’apprend que Breton avait surnommé la cinéaste Bison blanc d’or. Cela m’intrigue beaucoup car dans L’Imprononçable jour de ma naissance j’avais identifié Bison blanc d’or à Jacques Vaché. Dès le lendemain, j’ai réussi à joindre par téléphone Nelly Kaplan, que je ne connaissais pas personnellement. Il s’en est suivi la mise au jour de plusieurs durées automatiques, mettant en relation Breton, Rimbaud et Nelly Kaplan, mais aussi Vaché, Nietzsche et Chirico. Le fruit de mes recherches et interprétations a été consigné dans mon ouvrage Le Point Sublime.
Le Point Sublime
Voyons rapidement quatre chapitres du Point Sublime.
1° Le chapitre intitulé « Ashby ». Dans le ciné-roman Le Collier de ptyx de Nelly Kaplan, Stéphane Ducasse retrouve la trace d’Ashby en la localisant sur une hauteur, agrémentée d’un point sublime. On s’aperçoit que dès 1971, Nelly Kaplan avait relaté et visionné une durée automatique, à savoir le passage de Léonie Aubois d’Ashby dans les gorges du Verdon.
2° Le chapitre intitulé « Bison blanc d’or ». Ici est passé au peigne fin le message automatique entendu par Breton dans la nuit du 11 au 12 avril 1956, « Si vous vivez bison blanc d’or, ne faites pas la coupe de bison blanc d’or ». Notons tout de suite que le 11 avril, la saint Léon, est le jour anniversaire de Nelly Kaplan. Quant au message, si l’on veut comprendre sa dualité ou sa dichotomie, d’un côté il faut l’éclairer par le message fondateur de l’écriture automatique : « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre », et d’un autre côté il faut identifier les deux Bison blanc d’or intervenant tour à tour dans le message. Le message décrypté donne alors : « Si vous vivez, Jacques Vaché, Jacques d’Or et d’Orient, ne faites pas la coupe de Nelly Kaplan, de votre sœur au chapeau de clarté. »
3° Le chapitre « Le tableau anonyme ». Dans une lettre à Nelly Kaplan, datée du 15 juillet 1957, Breton relate une durée automatique : il certifie que ce jour-là, rue Fontaine, le professionnel chargé de photographier un tableau, qui au regard de Breton est le portrait de Nelly Kaplan « dans un rôle inconnu », ce photographe, après une heure d’allées et venues dans les deux ateliers de Breton, finit par poser le tableau exactement à l’endroit, au centimètre près, où se trouvait la Comète, c’est-à-dire Nelly Kaplan en personne, le 14 juillet, juste avant son départ de la rue Fontaine.
4° Le chapitre « La lampe au bec d’argent ». Dans une lettre de la fin juillet 1957, Breton ne contient plus sa passion pour Nelly Kaplan, qu’il identifie à « la lampe au bec d’argent » de Lautréamont, d’autant plus qu’André Breton et Philippe Soupault, les deux pagures des Champs magnétiques, les deux associés « Bois & Charbons », les deux admirateurs des Chants de Maldoror, sont à présent rivaux, face à la lampe au bec d’argent, qui n’est autre que Bison blanc d’or ou la Comète Nelly Kaplan.
Le chat Schrödinger
Dans le bestiaire de Nelly Kaplan, je retiendrai le chat, sachant, et cela tout le monde l’admettra, que le chat est instinct, le chat est indépendant et le chat a sept vies. Le chat Maldoror est un acteur à part entière du ciné-roman Le Collier de Ptyx. Dans le film Néa, le chat Villiers de l’Isle de Cumes est le témoin impassible et attentif de scènes sidérantes. Est-ce dû au déplacement comme en apesanteur de l’animal ou cela tient-il au réglage de sa pupille ? Toujours est-il que le chat semble absorber l’événement. Il a une façon à lui d’être là et pas là, d’être présent et absent, de se dédoubler en somme. On retrouve d’ailleurs cette impression d’absolu détachement et de participation intense dans certains gros plans de Bernadette Lafont, qui viennent ponctuer les scènes les plus ensorcelantes de La Fiancée du pirate. Chez Nelly Kaplan, le chat occupe la position du tiers. Sur un terrain familier, le tiers tient la chandelle, sans participer aux ébats amoureux. Mais le chat de Nelly Kaplan n’a pas seulement des dispositions de voyeur ou des dons de voyance, il se déploie sur le terrain épistémologique, il assume un rôle d’observateur ou d’appareil enregistreur. Rappelons que pour la physique moderne, l’observation humaine ou instrumentale n’est surtout pas indépendante du fait observé. Elle fait partie intégrante de l’événement qu’elle construit. Sans la présence du chat, ou ce qui revient au même, sans l’intervention de la caméra, l’événement ne pourrait pas se concrétiser. En fait, le philosophe Berkeley avait déjà donné une certaine assise à cette idée, en affirmant le principe : être, c’est être perçu. Esse est percipi. On songe aussi à la phrase de Duchamp : « Ce sont les REGARDEURS qui font les tableaux ».
Le chat Schrödinger joue un rôle déterminant dans le roman-scénario Ils furent une étrange comète. Le chat théoricien occupe la place du moyen terme, du troisième terme, grâce auquel le raisonnement, mis en forme, peut aboutir à une conclusion. En effet, seul le chat subtil est à même de dénouer et de renouer les fils de la destinée, au lieu de les rompre. De plus, le chat érotique et agile ne dispose-t-il pas de plusieurs vies ? En fait, ce guetteur hors pair, cet individu d’un troisième type, est surtout fidèle à la leçon du philosophe Plotin, pour qui il n’y a pas d’action sans contemplation. Parce que le chat est contemplatif, les images de la mémoire et les moments de l’histoire, les précipités du désir et les lois du devenir, restent à sa portée ou peuvent être réactivées. Ce qui veut dire que le cinéma a encore de beaux jours devant lui, ou plutôt, si l’on est un peu plus circonspect, que l’imagination seule est créatrice.
La circulation des durées
Depuis l’apparition des durées filmiques et le surgissement des durées surréalistes, la question de la métempsychose se pose à nous autres, modernes contemplatifs. Sans compter que nous ne savons plus où donner de la tête, depuis que nous sommes emportés dans le tourbillon des microdurées médiatisées. Nous sommes devenus des chats. Chacun d’entre nous est plus ou moins sommé de jongler avec sept vies ou plus. Toute cette agitation d’âmes, cette circulation de personnes, cette métempsychose en acte, n’a-elle pas été amorcée ou initiée par Nelly Kaplan ? Ne voit-on pas dans sa biographie, sa filmographie et sa bibliographie, les Belen, les Panthères, les Bisons blanc d’or, les Léonie Aubois d’Ashby, les Néa, les Lampes au bec d’argent, les Nostradama se relayer, s’interposer, se superposer ou même se contrarier ?
Un passage du Collier de ptyx paraît emblématique à cet égard. Quand Ducasse assiste à la projection de L’Étreinte de la pieuvre il découvre avec stupéfaction sur l’écran Ashby en train de danser avec la Mort, et c’est la Mort qui chavire. La preuve semble alors administrée qu’une séquence filmique, le bal avec la Mort, peut céder la place à une durée surréaliste, à la durée désirée par Ashby.
Autre indication qui montre bien que la destinée de Nelly Kaplan ne se déroule pas dans le cadre étroit d’un parcours linéaire mais dans une histoire au long cours où les voyages métaphysiques le disputent aux parties de fou rire. Dans la lettre du 15 juillet 1957, Breton confie à la cinéaste argentine ces propos de Benjamin Péret : « Extraordinaires, […] extraordinaires les yeux de Nelly Kaplan, on dirait des pierres qui se révèlent seulement à la lumière… […] ultraviolette. » Et le locataire de la rue Fontaine d’ajouter à sa destinataire : « Vous voyez qu’il n’est pas si mal disposé envers vous, je le savais d’ailleurs depuis mille ans et plus. » À travers cette expression « mille ans et plus », on a l’assurance que l’existence surréaliste n’est pas contingentée, car s’offre à elle la perspective d’une magnétisation des durées. D’ailleurs Nelly Kaplan postule aussi cette dimension millénaire dès la première phrase de l’avant-propos des Mémoires d’une liseuse de draps : « J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans… »
La page, le drap et l’écran
Pour Nelly Kaplan, la page, le drap et l’écran, et on pourrait y ajouter la toile, sont autant de réceptacles où se projettent et s’accomplissent les désirs irrépressibles de l’amour et de l’écriture. Dans Mémoires d’une liseuse de draps, le nom de baptême de Belen est tracé sur du papier glacé, au cours d’une cérémonie d’éjaculation-painting à bord du Sperma. Et lors de l’épisode du palais Obsexuel de Shanghai, les draps tachés de sperme déclenchent chez la narratrice le plus puissant des tests projectifs, puisqu’elle visionne une durée filmique sur grand écran : « Dans un dédoublement, une partie de moi se vit traverser les draps comme si elle pénétrait de l’autre côté d’un écran de cinéma pour s’intégrer dans un film. » Mieux encore, l’hallucination opérée sur l’écran des draps a valeur d’oracle ou de voyance. La liseuse de draps en transe prédit l’avenir.
Chez Nelly Kaplan les vases, comme les temps, sont communicants. Le songe s’épanche dans la vie. La vie est un ciné-roman qui vibre à l’écran. L’œil de la caméra peut caresser l’intimité d’un tableau. L’art est source d’exaltation. Le plaisir est incendiaire. La passion est reine. Le règne animal et le règne végétal, les facultés de l’esprit et les parties du corps, les mythes modernes et antiques, les dimensions du temps, tout est motif à exploration et érotisation. On s’en doute, une divinité érotique anime tous les vivants de la création et veille peut-être même sur les âmes mortes.
Sexualité et humour
Certes, la sexualité est omniprésente chez Nelly Kaplan. Pourtant il ne faudrait pas en faire la clé passe-partout de l’œuvre. Notre cinéaste-romancière n’a aucune visée thérapeutique. Elle n’est pas non plus le porte-drapeau de la révolution, fût-elle sexuelle. À ce propos, dans Un Manteau de fou rire, version remaniée des Mémoires d’une liseuse de draps, si les draps ont conservé leur faculté érogène et hallucinatoire, tous les petits drapeaux révolutionnaristes et avant-gardistes ont été remisés dans les poubelles de l’histoire. Non, le père de Nelly Kaplan, le navigateur du Manteau de fou rire, ou le milliardaire de Papa, les petits bateaux, n’est certainement pas Wilhelm Reich, le théoricien de la révolution sexuelle.
En revanche ce Père, ce pourrait être Charles Fourier, l’utopiste du nouveau monde amoureux, qui a essayé de cataloguer l’extraordinaire diversité des passions et des attractions. Ce pourrait être Abel Gance, autre visionnaire et inventeur, mais je laisse à l’intéressée elle-même le soin d’en parler. Ce pourrait être André Breton, si l’on en croit le toast porté par le Père lors du baptême de Belen dans Un Manteau de fou rire : « Sois heureuse de savoir ma fille, que tu aimeras beaucoup et que tu seras follement aimée. » On reconnaît là les derniers mots de la lettre à Écusette de Noireuil, par quoi s’achève L’Amour fou : « Je vous souhaite d’être follement aimée. » Le Père de Belen poursuit ainsi son toast : « Sache aussi que quand tes passions te rendront mélancolique tu auras pour te défendre l’arme la plus fabuleuse qui puisse être offerte à un être humain : l’humour. » Et joignant le geste à la parole il lui fait cadeau, et pour la vie entière, d’un manteau de fou rire.
Il y aurait deux autres pères putatifs, pour leur génie burlesque, Groucho Marx et Buster Keaton. N’est-il pas vrai que Papa, les petits bateaux, ce pur joyau de parodie et d’espièglerie, s’inscrit dans la lignée des grands humoristes ou ironistes du cinéma ?
Mais finalement j’opterai pour Alfred Jarry. Non en raison de la marionnette Ubu, mais à cause du « roman moderne » Le Surmâle. Car l’humour suppose un engrenage logique, une petite machine axiomatique. André Marcueil, l’être le plus insignifiant en apparence, énonce ce premier axiome, devant ses hôtes du château de Lurance : « L’amour est un acte sans importance, puisqu’on peut le faire indéfiniment. » À cette phrase, qui est l’incipit du roman, il faut adjoindre un second axiome, avancé par Marcueil au cours de la conversation : « Les forces humaines n’ont pas de limites ». De tous les représentants de la société, qui sont réunis là, aucun n’est disposé à suivre André Marcueil sur ce terrain, hormis la toute jeune américaine Ellen Elson. Or cette Ellen, une sorte de Belen avant la lettre, est prête à croire en l’existence de « l’Indien », nom attribué à celui qui mettrait en pratique les deux principes physiques de Marcueil. Et quand Ellen rend visite à ce dernier, elle énonce à son tour un premier axiome : « Il y a une chance sur mille que “l’Indien” existe, et pour cette chance, il valait la peine de venir. » Puis elle enchaîne avec ce second axiome : « Il y a mille chances pour une — et ceci importe à ma respectabilité — que personne ne croie que l’Indien existe. » Et elle conclut par cette curieuse addition : « Il y a donc, au total, mille et une bonnes raisons que je sois venue vous voir. »
L’humour est l’autre versant de la métaphysique. Car il est aussi rationnel ou irrationnel de croire en Dieu que de croire en l’Indien ou en l’Amour absolu. Ellen ne se prive pas de le remarquer : « L’Amant absolu doit exister puisque la femme le conçoit. » Nelly Kaplan, à mes yeux, emprunte elle aussi la voie axiomatique pour animer les jeux d’Éros. Elle a recours, dans Un Manteau de fou rire, à deux postulats, qu’on pourrait d’ailleurs étendre au reste de l’œuvre : 1° « Tant qu’on n’a pas tout fait, on n’a rien fait ». 2° « Je n’avais que mon angoisse à perdre et tout un monde à gagner ». Partant de là, elle peut se lancer dans l’aventure des passions et des perversions polymorphes. Par exemple, toujours dans le même roman, au moment fatidique où, dévoilant ses charmes, Belen va se jeter, au risque de sa vie, sur son ennemi abhorré, elle dégaine l’arme de l’humour en direction du lecteur : « Les dés étaient jetés. À moi d’abolir le hussard. »
Le procédé Kaplan
La Fiancée du pirate n’est pas plus un film naturaliste qu’une comédie psychologique. C’est parce qu’elle transforme l’intérieur de sa cabane que Marie bouleverse ses relations avec les gens. Et non l’inverse. Déroulant cet axiome, Marie transportera son intérieur à l’extérieur pour ériger une superbe installation d’artiste et incendiera les planches de sa cahute. Dans Papa, les petits bateaux, la même pulsion d’aménagement transformera la pièce où est sequestrée Cookie en un lieu enchanteur. Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur la cabane, la grotte, le refuge, la cachette chez Nelly Kaplan, sur tout un imaginaire lié à l’enfance.
Passons vite en revue quelques axiomes ou postulats. Pour Papa, les petits bateaux, ce serait : la sophistique ou la dialectique casse les briques. Pour Néa : à force de s’en imprégner, on égale les grands érotiques. Pour Plaisir d’amour : dans une femme, il y a plusieurs femmes et encore une femme en plus.
J’y insiste. Nelly Kaplan, à l’égal d’Alfred Jarry, de Raymond Roussel ou des Marx Brothers, ne fait que dérouler ses propres axiomes, son procédé. Sa règle du jeu est son premier moteur. C’est pourquoi elle ne nous entraîne ni dans un monde naturaliste ni dans la transgression de ce monde. Chez Nelly Kaplan, le désir n’est pas éveillé par le péché, par la tentation du mal. Son désir n’est pas réactif. Il n’est pas dicté par le double signe de l’interdit et de sa transgression. Le désir se déploie selon une règle souveraine et individuelle, où l’humour tient lieu de morale.
Le jardin des strelitzias
J’ai dit plus haut que Nelly Kaplan, Bison Blanc d’or, était sœur du dandy des tranchées Jacques Vaché, de l’inventeur de l’umour sans h. On sait que, pour André Breton, Jacques Vaché n’était pas mort. Dans l’Anthologie de l’humour noir, il qualifie son ami de déserteur « à l’intérieur de soi-même ». En fait, il campe le personnage insoumis, dès les premiers mots de la notice : « La strélitzie au doigt […] ». Le terme « strélitzie » renvoie à « strélitz », le soldat mutin, et à « strelitzia », la fleur. Le corps des strélitz, qui constituait la garde des tsars, fut supprimé par Pierre le Grand, après une mutinerie. Quant à strelitzia, ou oiseau de paradis, c’est une fleur exotique orangée et violacée. Breton se représente donc Vaché la fleur de l’insoumission à la main. Or Nelly Kaplan raffole de strelitzias. Dans Le Collier de ptyx, la dalle funéraire d’Ashby, qui en réalité n’est pas morte, est recouverte de strelitzias. La fillette de huit ans du Manteau de fou rire, est appelée par un marin du Sperma, « ma strelitzia des profondeurs ». À la dernière page du roman Aux orchidées sauvages, le monument funéraire du précepteur est agrémenté de « quelques strelitzias ». Enfin et surtout, les strelitzias jouent un rôle éminent dans Ils furent une étrange comète. Pierre, le généticien qui a créé une variété de strelitzias, l’a exportée dans l’outre-monde. Le jardin de ce nouvel Eden est planté de massifs de strelitzias bleu saphir. Et quand les rapports se tendent entre Ariane et Pierre, « les strelitzias, étranges arbitres, oscillent en tous sens, en modifiant la teinte de leur bleu. »
Jacques Vaché est-il mort ? L’amour est-il mortel ou éternel ? On ne peut affronter ces questions qu’avec l’esprit de l’humour, « la strélitzie au doigt ».
La Mort aux trousses
Le film d’Alfred Hitchcock, La Mort aux trousses (North by Northwest), repose sur une axiomatique, au même titre que Le Surmâle de Jarry ou Plaisir d’amour de Nelly Kaplan. En voici les deux postulats : 1° Le publiciste, incarné par Cary Grant, est un homme quelconque, en apparence. 2° Cary Grant est confondu avec un certain Kaplan, qui en réalité est un leurre, un personnage inexistant. Hitchcock peut alors déployer sa logique implacable. Sortir de soi-même, déjouer la mort, rencontrer l’amour, endosser le rôle d’un leurre, tous ces temps de tension pulsionnelle et d’attention au réel, exigent du sang-froid et de l’humour. C’est forts de cette distance ironique, que Hitchcock peut frôler la mort et Nelly Kaplan titiller le désir. D’ailleurs, les scènes d’inhumation de Mais qui a tué Harry ? et la cérémonie d’enterrement de La Fiancée du pirate se déroulent avec le même entrain. On sent aussi planer une atmosphère à la Hitchcock dans le cimetière du Collier de ptyx.
Claude Cahun et Witold Gombrowicz
En rapprochant les procédés de fabrication de Nelly Kaplan des processus constructifs d’Alfred Hitchcock ou d’Alfred Jarry, j’ai voulu souligner deux traits essentiels de la cinéaste-écrivain, sa méthode volontariste et son individualisme irréductible. On comprendra que sans hésiter je situe Nelly Kaplan dans la lignée des individualités excentriques, parmi lesquelles je citerai la photographe-écrivain Claude Cahun et l’écrivain polonais Witold Gombrowicz, qui vécut en Argentine de 1939 à 1963. Tous trois, Claude, Witold et Nelly ne cachent pas leur égotisme. Non pas un narcissisme intériorisé et honteux mais une affirmation de soi mordante et extravagante. Dans Un Manteau de fou rire, roman de formation et d’aventure, Belen prend conscience de son corps, de son moi et du temps. L’héroïne de La Fiancée du pirate découvre simultanément l’individualité et le temps filmique. Quant à Cookie de Papa, les petits bateaux, elle organise une série de duels à mort, où la conscience de soi supplante le désir charnel et se moque de la mauvaise conscience. Toutefois, Nelly Kaplan vise moins ici un accomplissement du vrai, comme chez Hegel, qu’une démonstration ironique, à la manière des duels à la grimace décrits par Gombrowicz. Il faudrait aussi évoquer l’individualité précoce et farouche de Sybille Ashby dans Néa ou encore dans Plaisir d’amour la recomposition de trois âges de la vie à travers l’individualité plurielle et conquérante de Do, Clo, Jo et Flo.
C’est au nom de sa subjectivité qu’il arrive à Gombrowicz de s’insurger contre les poètes, contre les peintres, contre les critiques, contre les intellectuels. Il adore d’ailleurs jouer à un contre tous. En 1954, toujours en terre argentine, il consacre plusieurs pages de son Journal au pavé de Dionys Mascolo, Le Communisme, sous-titré « Révolution et communication ou la dialectique des valeurs et des besoins ». Gombrowicz propose un tableau à deux colonnes traduisant sa perplexité devant un pur produit de l’intelligentsia parisienne et européenne :
« Remarquablement intelligent. D’une rare stupidité.
Profondément moral. Scandaleusement immoral.
Absolument réel. Follement irréel.
Très sincère. Très insincère. »
Bref, les arguties dialectiques de Mascolo n’ont ni touché ni convaincu l’individu Gombrowicz.
Passons à l’autre individualité qui, elle aussi, ne se laisse pas imposer le diktat des vulgates populaires ou lettrées, et ose penser à la fois pour soi-même et contre soi-même, je veux parler de Claude Cahun. Ses confessions, Aveux non avenus, ouvrage illustré publié en 1930, sont originales sur tous les plans — forme, fond, style et genre. Je me contenterai d’en citer deux passages. Premier fragment : « Brouiller les cartes. / Masculin ? féminin ? mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours. » Second fragment : « L’exception confirme la règle — et l’infirme également. / J’ai la manie de l’exception. Je la vois plus grande que nature. Je ne vois qu’elle. La règle ne m’intéresse qu’en fonction de ses déchets dont je fais ma pâture. Ainsi je me déclasse exprès. Tant pis pour moi. »
Claude, Witold et Nelly : trois individualités fortes, mais aussi trois tempéraments différents.
En 1966, quand paraissait Le Réservoir des sens sous le nom de Belen, on pouvait y voir un mélange détonnant de flashes érotiques et de jeux de mots provocants. Mais aujourd’hui, on y découvre autre chose. Arrêtons-nous au conte « Je vous salue, maris… », qui dès la phrase d’introduction annonce la couleur : « Depuis des millénaires déjà, nous vivons de nouveau sous le règne du matriarcat. » Le lecteur comprend vite que depuis que le matriarcat a renversé dialectiquement le patriarcat, il a simplement inversé les rôles, en substituant les dominés aux dominants et les dominants aux dominés. Est-ce là toute l’ironie de l’histoire, ou toute la malice du genre humain ? Il ne le semble pas, car Belen désigne une fenêtre. Elle pressent le règne futur d’« androgynes troublants aux yeux semés de poussières d’or ». Je crois qu’il y a beaucoup de clairvoyance dans les quelques pages de « Je vous salue maris… » D’abord, depuis les années soixante, l’effondrement du patriarcat s’est bel et bien produit. Ensuite, surtout en Occident, la famille nombreuse s’est réduite, diminuant en conséquence le rôle du père mais aussi de la mère. Enfin, il est patent que nous sommes en plein individualisme démocratique. À présent, les individus du grand nombre, de moins en moins retenus par des attaches communautaires ou par des liens sociaux, sont de plus en plus convaincus qu’ils ont des droits égaux et une personnalité unique.
Nelly Kaplan et le surréalisme
Il y a deux ans, dans un colloque sur le surréalisme organisé à Rome par Germana Orlandi, j’ai eu l’occasion de poser la question suivante : « Le surréalisme est-il soluble dans la démocratie ? » Et j’ai répondu, ce qui pouvait paraître surprenant, que le surréalisme était effectivement soluble dans la démocratie. Je rappelle les étapes de mon argumentation : 1° Le groupe dada-surréaliste ne s’est pas organisé en avant-garde révolutionnaire. Le surréalisme n’était donc pas soluble dans la révolution politique. 2° Cette association d’individualités fortes a expérimenté une poétique collagiste sur trois plans : spatial, passionnel et temporel. 3° Aujourd’hui, l’individu du grand nombre qui délaisse la politique afin de cultiver sa subjectivité et objectiver le temps, est prêt à souscrire au postulat de base du dada-surréalisme : « La poésie doit être faite par tous ». 4° Où est donc passé le surréalisme ? Il a coulé dans les eaux étales de la démocratie.
Une dernière précision. Le dada-surréalisme est né à la mort d’Apollinaire et de Jacques Vaché. Et peu après la mort de Breton, le groupe surréaliste de Paris s’est littéralement volatilisé lors des journées de révolte démocratique de mai-juin 1968.
L’anticonformisme, qui est au cœur du dada-surréalisme mais aussi des travaux de nos trois excentriques, Cahun, Gombrowicz et Kaplan, est devenue la chose du monde la mieux partagée. Marotte de quelques collectionneurs, honoré dans les musées, rendu insipide à l’université, le dada-surréalisme semble appartenir à un passé antédiluvien. Gombrowicz, le grand inventeur des Verts et des Mûrs, attend encore son heure. Certes, Claude Cahun, redécouverte par François Leperlier, suscite la curiosité, au point que des féministes sectaires tentent, mais en vain, de la récupérer. Quant à Nelly Kaplan, elle m’apparaît comme la pierre de touche de l’expansion formidable de l’individualisme et de l’anticonformisme.
Il n’est pas facile d’analyser le courant irrésistible d’anticonformisme démocratique, qui s’est propagé après 1968. En ouvrant grand les vannes de la poésie par tous, de la sexualité par tous, de la philosophie par tous, de la musique par tous, du cinéma par tous, on a peut-être étendu le champ de la création mais pas nécessairement celui de la réception. Extraordinaire paradoxe : les institutions, en particulier l’école et les médias, se sont rangées sous la bannière de l’anticonformisme démocratique. Étonnant cercle vicieux ou vertueux : l’anticonformisme généralisé se convertit logiquement en conformisme de masse. Comment détecter alors une Nelly Kaplan parmi ces cohortes de poètes, ces foules empressées d’érotomanes, ces légions de philosophes, ces multitudes de musiciens, ces populations bigarrées de photographes et de cinéastes ? Pourquoi s’arrêter à Néa ou à Ils furent une étrange comète, quand triomphe la recette du remake et de la surenchère ?
C’est sans doute parce que nous piétinons les plates-bandes du dada-surréalisme que le dada-surréalisme est passé à la trappe. Quant à Nelly Kaplan, jongleuse de gravité, gardienne du temps et non du temple, sibylle d’une étrange comète d’excentriques, elle semble jouer sur la touche depuis des décennies. Cela ne m’a pas empêché de lire dans les pages de Nelly Kaplan comme sur un écran magique et de sentir l’étoffe de ses draps sur le grand écran de ses films.
Georges Sebbag
Références
« Nelly Kaplan, la page, le drap et l’écran », in Nelly Kaplan le verbe et la lumière, textes réunis et présentés par Mireille Calle-Gruber et Pascale Risterucci, L’Harmattan, 2004.