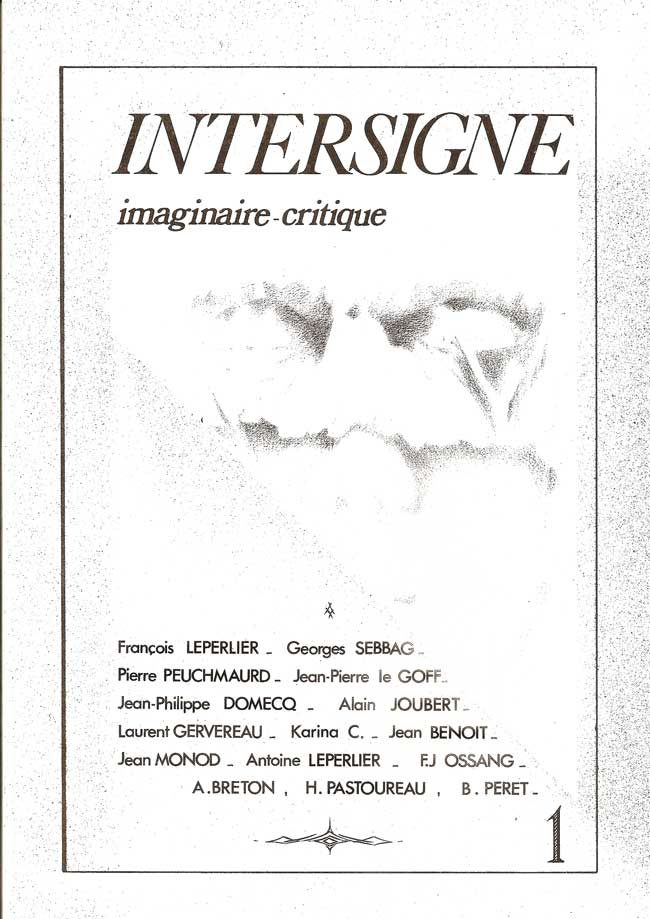
Qu’attends-tu, au juste ? La séance de cinéma, le bulletin d’informations, un coup de fil, un faire-part, une franche explication, le déclenchement des opérations, l’accalmie sur tous les fronts, la confirmation des sondages ? Tu attends, tu le sais, et ta patience n’entame pas l’amoncellement des questions.
Les prophètes du quotidien ont la vue courte et la dent dure. Des envoyés spéciaux se tiennent derrière une porte, devant un dictaphone ou dans un décor planté à la hâte sur quelques-uns des milliers de mètres carrés d’un gratte-ciel adipeux. Se constituent des files d’attente qui se démarquent des très statiques queues de rationnement. On s’observe de loin, on monte la garde pour conserver le moral. Dans cette salle d’attente, aussi vaste que la planète, sobre et climatisée, on s’oblige à l’impassibilité. Les gorges sont un peu nouées mais on ne frissonne pas. L’interminable attente est entrelardée de vraies sorties et de fausses entrées. On se réveille en sursaut, après s’être à peine assoupi.
L’attente n’est ni longue ni courte. Une limite est fixée : ne pas dépasser le jour. Sucer le sang avant le chant du coq. On répudie les lamentos du spleen et les trémolos de l’ennui. On veut empaqueter, serrer fort sa propre existence. On choisit sèchement d’arpenter les couloirs de l’oubli. Plutôt que de fabriquer des happenings contestables, d’inventer une heure de gloire nimbée d’une chronologie fastidieuse, plutôt que de courir après de beaux rôles qui sonnent creux. On participe à quelques cérémonies, sans se faire remarquer. On reprend ses esprits, on vise la cible même si le soleil s’éteint. Les retours en arrière ont un avant-goût de vide, l’anxiété se dépose. L’attente s’accroche à des repères. L’école du quotidien embauche aussi bien des pervers que des chômeurs ; elle décabosse leurs gueules. Masseuse exotique, elle promène son haleine sur les visages lisses.
Le ciel déverse sa manne. On se baisse. Les gosses récupèrent la menue monnaie. Au lieu de défier le destin ou de l’ignorer, on se réjouit du ballet anarchique de la lune et des étoiles. L’attentisme devient la règle. On va au devant des traitements de choc du quotidien.
Y a-t-il jamais eu une époque où chaque illuminé se jugeait à l’arrivée, prononçait son autocritique ? À présent, le quotidien déplace les échéances lointaines et proches. Il bat les cartes. Le tri est automatique. On se plie aux allées et venues du lendemain. L’attente est insidieuse, poreuse, parfois insipide. On ne nage pas dans l’huile, on se fait peur. Comme des mouches, les jours tombent les uns sur les autres. Les vagues montantes de la marée prennent possession du littoral et le lessivent abondamment.
Au sein de l’attente, les hautes classes se joignent aux bas étages, la solitude n’envie rien à la compagnie. Le temps presse ou passe. On va voir, on laisse venir, on fait traîner, on laisse faire, on constate, on envisage, on programme. On monte le direct avec autant de recul que le différé. De l’entrebâillement des attentes pointent une familiarité, une simplicité, une habitude qui font oublier la position attentive, opportuniste de celui qui attend.
L’attente, oublieuse et vaniteuse, paraît détachée de tout passé, de toute perspective. Immobile, d’une lenteur à rendre l’âme. Il faut se détromper. L’attente est agrémentée de bruits et de colères, de compétitions et de surenchères. Les modernes, les modistes, les récupérateurs, les nouvellistes s’accordent pour court-circuiter l’histoire après l’avoir inaugurée, pour exhiber leur cas d’espèce, pour grossir l’événement, pour triturer la mémoire, pour faire parler les morts, si possible à l’aide de remontants techniques. Ils tirent prétexte du triomphe de la contingence et d’une inappétence intellectuelle répandue pour imposer leur présence miraculée. Leurs oublis sont plus systématiques qu’inconscients. La modernité combine promptement la circulation des attentes et l’appareillage de l’oubli. Blindée dans une chape de sérieux, agrémentée d’un chapeau-fantaisie, elle conduit une politique tatillonne et sans risque.
L’attente déborde l’oubli. On hésite, on repousse, on reporte, on s’enhardit, on marque le coup. On expérimente l’attente avec des unités minimales, infinitésimales. On ne s’impatiente plus. On a toute la journée devant sa cloison vitrée.
Le quotidien
Les toasts brûlent, on est réveillé, le sentiment d’exister envahit les étages. Quand la nuit est tombée, on se fait petit sous l’édredon. En vérité, du début à la fin du jour, on jette des ponts, on noue des liens, on rabote les aspérités de l’emploi du temps. Rien ne trouble la longévité de la période quotidienne. Les heures faufilées, on file à une allure réglementaire. Même en mettant les bouchées doubles, on ne saurait engloutir la ration du jour. Il reste que souvent l’attente est laborieuse ou nerveuse.
La vie de tous les jours désamorce une attente si redoutée dans une vie au jour le jour. C’est que les gens du quotidien respectent les chiffres, les jouent à la roulette. Le jour n’est pas un abcès de fixation, c’est l’image puissante d’une montagne aux pentes amères. On prend des pauses, on s’installe, on oublie, on ingurgite un lot d’idées, on éjecte les ultimes secondes. On se frotte les mains, on se désintéresse des grandes questions, on résout, on raisonne, on ne bute que sur des accidents de parcours. On a beau ironiser sur la journée révolue, on entrouvre les lèvres pour happer la tétine matinale.
L’attente journalière, étalée ou ramassée, satisfait les populations. Personne ne tombe sur un os. On ne s’étrangle pas avec la tranche d’un calendrier. Si ça allait mal, du haut des tribunes, en bas des journaux, on prépare le terrain, on annonce la couleur, on combat l’angoisse, tout en l’entretenant. Un seul flash sert d’appât ou de repas. On évite les embûches, avec de l’entraînement. On traverse le pays en temps voulu. Les images affichées sont insensibilisées, on en tire parti tout de même. On ne bombe pas le torse, on apprécie l’étiquette. On a de la retenue, on est moyennement démonstratif. On redouble d’efforts.
La quotidienneté ignore les envolées du jour meilleur, la tenue pour soirée de gala. L’attente, intériorisée, efficace, est conforme aux recommandations techniques en vigueur. Une courte attente est rarement décevante. On en profite, on tend seulement à connaître la fin du jour. On participe, on renvoie la balle, on temporise. Bref, on dure.
Pourtant il y a ceux qui font la chasse au présent qui leur file entre les doigts, et qui se mordent les ongles. Leur conscience enregistreuse s’affole ou s’exalte quand des signes concordants culminent dans l’imminence, quand des symptômes inquiétants réclament une solution d’urgence, quand les ordres et les contre-ordres sont si rapprochés qu’ils sont emportés par l’immédiat. Face à ces agités de l’instant, ces insomniaques du moment, le jour s’entoure de factionnaires au sang-froid. Et les marchés économiques, mentaux, physiologiques sont traités par de simples exécutants, au nez et à la barbe des partisans du présent en ébullition. Le quotidien diffuse en tous lieux la mesure de toutes choses. Ses procédés vont de la stimulation électrique à la tape amicale.
Il arrive que le quotidien soit inénarrable. Il fourmille de détails, il frétille de désirs rentrés. Sont passés sous silence ses temps morts, ses sécurités renforcées, ses instincts insondables. Mais il triomphe du départ à l’arrivée, en faisant justice de toute récrimination, en faisant apprécier la plus minable des journées. Dans la foulée, il mène tambour battant des opérations de prestige. L’innervation sociale est à ses pieds. À haute voix, il teste l’avenir. L’intérim est assuré coûte que coûte. Il homologue puis garantit de nombreuses formules. Il se gave sans se purger, il enfle sans éclater. Le quotidien mène ses affaires comme un professionnel. Il abat du boulot, il oublie sa peine. Envahi par l’écho de sa publicité, de ses plaisirs solitaires, il rend inaudible sa propre parole, sa sexualité.
Les média rendent les lecteurs et les journalistes masochistes. On livre à domicile des plaisirs inextricables. Chaque adhérent reconduit ses abonnements sans explication. On ne coupe pas le contact avec les générations montantes. Qu’on taille dans le vif ou qu’on affronte la routine, on modère ses envies, on envie sa modération. Le quotidien allège les mœurs en les classant, les déclassant, en les concentrant puis les diluant. On s’agrippe au bon format, on réclame de justes mesures. Le pont surpeuplé tient bon. Le défilé des jours déride les fronts assombris. L’horloge sonne, le boulanger ne livre plus des petits pains au chocolat. On salive, sans avoir faim.
Au jour le jour, le jour cède son tour à la journée de travail qui pour ne pas paraître gourde, pour s’afficher au grand jour, sollicite la presse quotidienne. Le quotidien se charge de couvrir entièrement la journée, d’infiltrer l’emploi du temps, matin et soir. Petit jour à la clarté vacillante, journée minutieusement remplie, journal dont les titres sont autant de bonnes nouvelles, d’invites à fêter l’inoubliable journée. Premier article du journal : rendre compte non pas d’hier mais d’aujourd’hui. Deuxième article : pouvoir paraître le lendemain. Troisième article : oublier les jours précédents pour ne s’occuper que d’un seul jour.
Tout au long de la journée, l’attente s’allonge. On déguste quelques idées fraîches, on s’apprête à écouter le grand air de l’oubli.
L’actualité
C’est classique, le week-end est devenu une échappatoire. Courte échappée, concédée puis reprise par le quotidien. Sans être totalitaire – sans réclamer pour lui seul la semaine, l’année, la vie –, le quotidien ne peut s’empêcher d’envahir les refuges où on essaye de l’oublier, de l’endiguer. La furie quotidienne enlève d’un coup dimanches, fêtes et vacances. On fait allusion à sa personne profane jusque dans le déambulatoire des temples éclairés : « Nous admettons son endurance, nous endurons sa connaissance. Mais nous ne supportons pas sa banalisation ».
Il arrive que le charme cesse. Les rythmes se défont, les cales et les caves se vident. Pourtant le navire se remet à flots. Le quotidien persiste avec sa seconde poussée, son autre détente. On appuie sur une touche et l’actualité vient à son secours. La dose miracle fait baisser la tension et comble l’attente. Les âmes sont ballotées, le quotidien est démonté, on perçoit nettement la sirène des temps de brume. On peut humer l’air du large, on salive à la vie sauve. Chaque bourrasque rafraîchit les idées des survivants. Le quotidien se cantonne dans son gîte ordinaire, dans les coulisses de son Opéra pour que l’actualité transperce les boucliers d’airain, les carapaces de nacre, pour qu’elle crève les écrans immaculés, pour qu’elle s’installe au premier plan. Et le spectacle commence.
Démarrage en trombe, dédain pour l’entourage. Respect infini de la sainte journée. Chaque jour aura sa part de pain bénit, chaque jour exhalera des senteurs ineffables. Aussi les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les chronomètres s’épuisent à fonctionner et distribuent d’insipides renseignements. Inutile de remonter la pente, de suivre une idée, de compulser des fiches. L’attente se braque sur cet instant-ci, sur ce jour-là. Un point, c’est tout. On ne s’interroge pas, on ne s’explique pas. On attend, on se fie au hasard qu’on provoque ou qu’on imite. On remplit l’attente de coups d’éclat, on déborde de générosité. Celui qui oublie franchement ce qui précède ne s’attend plus à ce qui suit. Actualité enragée, démesurée, décontenancée par un simple hoquet. Chutes, envolées, bombardements, déconfitures sans début ni fin. Montage d’un film muet des années vingt avec quelques inévitables tartes-à-la-crème. Même les paranoïaques s’inquiètent : pour maintenir leur ligne politique, ils remplissent les cases manquantes et payent de leur personne. Impressions fugitives mais extravagantes d’un déjà-vu-et-corrigé. Car ce que l’actualité cuit, le quotidien l’avait pétri.
Convoquez une assemblée générale. Elle s’installe. Vous l’intoxiquez, vous l’informez. Elle délibère. Ainsi se met au garde-à-vous un public rebelle, distant et néanmoins séduit. La promiscuité vire à l’intimité, les voyeurs se montrent dans les galeries. Les secrets de Polichinelle sont pompeusement publiés. L’actualité tombe, éclabousse le parterre. L’opinion publique, située nulle part et partout, réagit correctement. Le système de persuasion fonctionne. Des têtes circulent, des images sont déployées. Quand on s’essouffle, on se laisse porter pour ne pas sortir du jeu.
Durant la période quotidienne, on attend le jour suivant au tournant. L’actualité fait l’économie d’une attente. Elle bouscule les pancartes, elle se déhanche, elle caresse les enfants. On se croirait dans une comédie américaine où la parole a pour unique partenaire le charme des visages impeccables et des postures sophistiquées. Parfois on est immergé dans la séquence interminable d’un cri insupportable. L’actualité assaille le quotidien, le mitraille, le défie. Danse fraternelle, parodie de mort. Les mentalités qui transpiraient depuis des millénaires coupent brutalement leur réseau d’irrigation, d’irritation et se soumettent, démunies et surchargées à la fois, à l’éblouissement de l’actualité. Bien-être. Douleur lancinante. Leçon assimilée immédiatement.
Le quotidien baptise actualité ses moments de grâce et de disgrâce. Les histoires brèves sont de loin les meilleures. L’aphorisme journalistique, le slogan publicitaire font davantage recette que le roman-feuilleton. Le quotidien lui-même paraît d’un autre âge, d’une autre saison. Les nouveau-nés sont accueillis avec joie, on les berce. Plutôt une méchante couleur qui s’estompe qu’un serment indélébile. On ne stocke pas pour conserver mais pour débiter. On lève la main et on choisit un des emballages qui garnissent les rayonnages. On a juste le temps de se dessaisir ou de se ressaisir. Quand tout paraît calme, l’actualité reprend son souffle, vomit ses arrière-pensées. Porteuse de conviction et de flatteries, l’actualité impose un temps d’arrêt, non pour se défendre, pour célébrer un rite ou pour alarmer, mais pour esquisser une gestuelle sans signification. On entame une conversation, on stoppe un débordement, on déplie un journal, on appelle un ascenseur. Alors que le quotidien aménage souverainement ses apparitions, l’actualité fait le geste de porter ses valises. Ainsi elle accentue la mainmise quotidienne. Elle démultiplie les règles, les accords, elle les déforme et les défait.
Comment se mettre au goût du jour, tout en respectant les consignes quotidiennes ? En visant dans le mille, en informant jour et nuit, toujours et toujours. L’actualité capte l’attention pour un temps imparti, elle n’excède jamais le temps de la communication. Des séances improvisées, imprévisibles de chatouillements, de confidences invitent le public à attraper les nouvelles au vol. La loi n’oblige plus quiconque à surveiller son voisin mais à prononcer l’exacte formule, à appliquer l’ultime recommandation. Cérémonie sans cérémonial où l’on authentifie la plupart des certificats d’existence.
L’empressement
Quand surgit le moment tant attendu, il est hors de question de prolonger l’attente. L’empressement efface les attentes. Le piétinement de l’attente est contrebalancé par les petits pas en avant de l’empressement. Les gens empressés veulent assister à un rendez-vous dont ils ont l’intuition qu’il sera manqué.
Le corps supporte mal les attouchements de la socialité ambiante. D’où une fuite en avant, une course haletante – le regard juste distrait par un bracelet-montre. La frustration est secondairement sexuelle. Les objets de préoccupation prolifèrent. Les choses, artefacts ou fantasmes, se mélangent et grossissent à vue d’œil. La musique abolit le silence, les populations grouillent et s’ignorent, les automobilistes circulent sur des rails, les propos se heurtent sans éclats, les aliments sont prêts à être ingérés. Il est impossible de stationner sur un quai. Le grondement des idées et l’alimentation des désirs encombrent les cervelles, propulsent les corps le nez en avant.
L’empressement freine brutalement l’oubli. Intervention aussi franche et massive que l’actualité. Les attentes sont suspendues, remises à la semaine des quatre jeudis, mises au pas. On travaille automatiquement, sérieusement, sans conviction, mais avec l’idée saugrenue et un peu bête que ça avance. On progresse, on est moderne, mais à une échelle locale. On salue l’actualité, ponctuelle et audacieuse. Comme elle, on marque un trait sur les antécédents. On veut faire mieux qu’elle encore : on hâte la venue d’un dernier arrivant. Et cet objet de convoitise, on le bouffe à moitié, on l’escamote entièrement.
Sauve-qui-peut généralisé. On se bouscule.
Dans les situations apparemment tranquilles, on s’agite expressément. On veut déduire les ultimes conséquences, passer à la limite, pousser à fond la contradiction. On bronze intégralement. On saute la barrière. On s’amuse à vérifier. On joue le pour et le contre à pile ou face. On brave l’interdit, on s’interdit de répondre à des provocations. On jubile dès qu’on passe d’une tranche à l’autre de l’emploi du temps. On danse en forçant les rythmes, on travaille en cadence. On s’épuise. Les trajectoires sociales, les cahots mécaniques, les tensions électriques sont des prétextes à excitation, à empressement. On interagit, on ne débouche sur rien, on se dissipe. Seuls résistent à ces trains d’ondes les bons dormeurs ou les gros mangeurs. Mais dès qu’un rendez-vous est pris avec la socialité, impossible de l’éviter, on s’empresse et on s’en met plein les doigts.
L’empressement évite de buter sur les laps de temps réservés ou préservés (les trêves, les haltes, les urgences). Il ne fabrique pas du temps spécifique, il intervient mais sans prétexter l’imminence d’un besoin, la spontanéité d’un élan ou l’urgence d’un secours. Bien plus, il confond les moments, les chevauche. Hennissement sans relâche face aux secondes, aux paquets de secondes. L’empressement se charge de contracter les défilements réguliers, les déroulements intégraux.
On ne fait plus confiance aux signaux, aux cadrans. On ne répond plus aux avertissements. On manifeste en permanence un esprit de défiance pour stopper net l’avalanche des secondes. On se débat dans une curée de chiffres, on étouffe sous l’amas de documents. On n’oublie pas de frayer avec son temps, on prend l’air avec l’actualité. Mais on veut pourtant défrayer la chronique car on participe à fond, on élance son buste, son cou et ses obsessions.
Le couperet tombe. Nous n’avons pas le temps. Nous nous ramassons sur nous-mêmes, nous nous détendons mais nous n’avons pas le temps. Aucun signe de révolte ou d’impatience. Nous savons que le quotidien est invariable, que l’actualité n’agit pas sur les vertèbres cervicales. Nous compulsons notre agenda pour confirmer, annuler, reporter des rendez-vous. Nous prenons le temps à partie. Nous fonçons, nous nous éparpillons, nous nous concentrons, nous renonçons. Nous oublions d’attendre.
Une fois la machine lancée, plus moyen de l’arrêter. On rêve alors d’un ailleurs, d’un état d’apesanteur. L’engouement, l’emballement, la vitesse ne se divisent pas. On remue, on sursaute la nuit venue. Les pensées cachées sont dévoilées. On comptabilise un peu n’importe quoi, pour le plaisir de photographier des colonnes de crédit et de débits.
Avec l’empressement, le temps est pris en flagrant délit de vitesse. Petit trot pour laisser derrière le quotidien. Grand galop pour sauter la barrière de l’actualité. On s’empresse, on tourne en rond dans des locaux loués à la journée. On s’empresse, on reste relativement froid face aux points chauds de l’actualité.
On fait du sur place, on se cogne contre le vide, on poursuit un but indéfiniment déplacé. On s’empresse pour ne pas rater le coche, pour offrir ses services à la machine humaine, pour éreinter la conjoncture. Mais le temps presse. On assiste, muet, à tous les décalages possibles. On est soit en retard, soit en avance. Et si l’on tombe au bon moment, le succès prend un goût d’amertume. Certes, quelques supporters, à l’ancienne mode, se réjouissent. Mais tous les perdants se liguent pour montrer les dents aux gagnants. Alors on délire contre le temps, on accuse le présent, on plonge dans un immédiat fantomatique.
Les ravages de l’empressement contrastent avec les solides assises de l’attente quotidienne. D’un côté on est à l’aise, on mesure les risques de la journée, de l’autre on mise tout sur une affaire, sur un moment. On s’obstine surtout si c’est dérisoire. L’inertie quotidienne, jugée invivable, voit se briser les assauts de l’empressement, se disloquer les intentions de l’actualité. Après une évaluation confuse, on s’engouffre dans le quotidien avec l’idée que le moindre imprévu captera l’attention. Ne voyant rien venir, on palpe les corps, on presse l’ombre qui passe. On retient son souffle, on bloque sa réflexion. À défaut d’avoir entendu les minuteries d’ambiance, d’avoir chatouillé les aventures sélectionnées, on attend le déclin du jour. Car la tension baisse en fin de journée. Les rideaux se ferment, le halo des lampadaires fige la Place – vide – de l’Église.
J’enterre religieusement mes vaines attentes de la journée. Sur la couronne de l’actualité flotte un ruban rose. Les foules empressées viennent de gripper leur détente insensée.
La fin du jour
La tradition semble la plus forte : la nuit achève en beauté l’incroyable journée. On prépare l’extinction des feux. Si c’était faisable, on empêcherait les draps de se froisser. On pose la tête sur le mol oreiller de la certitude. On se jette dans les bras d’un sommeil qui annulerait les couinements du rêve. On sombre corps et biens. Pour parer au plus pressé, pour en finir avec lui-même, le quotidien aimerait flirter avec le diable, avec la nuit des ancêtres et des étoiles.
La modernité n’accepte pas ce compromis. Elle n’abandonne pas à la soirée le soin de chasser les pensées récalcitrantes, de brouiller les images persistantes. Elle se défie du culte millénaire de la déesse d’ombre, de sa silhouette emmitouflée, de son érotisme fou et flou. Aussi explique-t-elle à tout le monde le mystère des cathédrales, aussi regarde-t-elle avec simple curiosité les effets de transparence dans la Grande Peinture. Le quotidien doit se supprimer, mais d’une autre façon. Par exemple, il préférera les éclats blafards d’un écran de télévision aux rayonnements anémiques d’astres qui ne discernent guère une ville et sa banlieue, le centre et la périphérie.
Pour parfaire la journée, pour l’étalonner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (le comble du quotidien, à cet instant fatidique, c’est d’oublier le bon sens progrédient), on compte à rebours les derniers instants. Le soldat caresse la quille, le prisonnier gravit son chemin de croix. Attente délirante de la dernière ligne droite, une bouffée d’air pur coupera le fil invisible de l’arrivée. À l’issue d’un défilé harassant d’heures creuses et pleines, les usagers raflent n’importe quelle prise. Le combattant entre en convulsions, le mourant fait de l’hypermnésie, les amants se dépensent beaucoup pour une ombre d’orgasme. La tension chute lors du dépôt de bilan. Les douleurs sont supprimées, les plaisirs sont inachevables. Quelques échappements ne sont pas contrôlés.
Ça y est ! La fin de journée pèse sur tout le squelette. En dépit de l’animation de certains quartiers, des consignes de silence congèlent les habitants. À quoi bon obtenir une dérogation ? Il est impossible d’allumer un contre-feu. Captif pour captif, on décide de passer inaperçu. Dans le secret, on accomplit quelques rites : laver l’acidité de ses dents, vider l’onctuosité de sa bouche.
Est-ce le désarroi d’une fin de fête ? On s’interroge. Qu’ai-je foutu de la journée ? J’ai traîné avec un paquet de boue achetée en vrac. Qui racontera que la fin de journée est une morne plaine ? Le soleil décline. Il rugit aussi. C’est l’heure des aboiements et des encombrements, c’est la minute des retrouvailles. Le temps est une denrée dilapidée dans les préambules rugueux du transport, des WC, du sommeil et des projets. En fin de journée rien n’est entrepris, tout reste à faire. Le pillage du temps exige un peu d’insouciance et beaucoup d’insolence.
Coup d’œil ultime sur l’ouvrage façonné. Les phalanges se plient, les mandibules se resserrent. Effondrement passager de l’attente. Les fantômes desservent la table en retirant la nappe. On déguste un dessert, une bonne parole, on frôle des abîmes, on met en boîte le quotidien. L’actualité a lâché prise. Au souper alcoolisé succède un cinéma intérieur. On ne rejoue pas la partie incertaine de la journée, on essaye de l’éloigner. La passation de pouvoirs est compliquée mais la fin de fête reste discrète. On continue à s’enfermer à double tour. Saynète sans témoin ni gag. On laisse approcher le lendemain, comme on ouvre le gaz. Rare occasion accordée aux familles ensommeillées d’accoucher d’une souris débile ou d’un réveil en fanfare.
Les fins de soirée tournent de plus en plus à l’apologie du jour à venir. Le quotidien a sa postérité assurée. Timbre cassant des autorités en place : les citoyens font la pause. Oubli intégral de l’attente, simulation grossière de la surprise. Le matin tinte. Certes une soirée entre amis fait remonter des gisements préhistoriques. Certes le quotidien est vraiment déchiqueté, zébré. Pourtant l’apaisement est là. À la limite, la nuit n’existe plus, mais on reporte ses dividendes sur la fin du jour. Au seuil du jour et de la défunte nuit, on dégriffe, on défalque, on récupère, on ignore.
Les ponctuations de l’actualité, les manières inélégantes de l’individu empressé rompent l’attente quotidienne, un peu monotone, un peu atone. Et puis, la fin du jour est bien plus radicale qu’un commando empressé. En somme, quelle habileté ! On donne dans l’intempérance comme dans la tempérance. Quelle volonté ! On coupe les relations avec le passé, mais on ouvre les persiennes pour observer visiteurs du lendemain.
Un jour, c’est trop court ! On n’a pas le temps d’attendre. Il suffit donc d’allonger le délai pour que le quotidien traverse la rue. On se prépare, on s’organise. Il est hautement improbable que le cœur du réacteur flanche.
Georges Sebbag

Références
Georges Sebbag, « L’attente », Intersigne, n° 1, fin 1982.
Le texte est repris dans Georges Sebbag, Le Temps sans fil, Quando, 1984 : première partie, chapitre II.