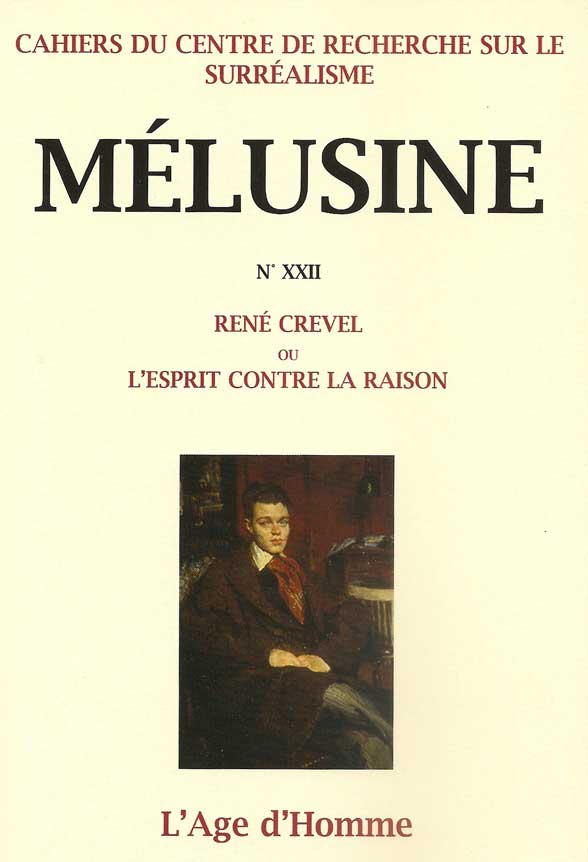
En 1925, dans le feuillet autobiographique rédigé pour Mon corps et moi, René Crevel mentionne la révélation que fut pour lui la « peinture métaphysique » de Chirico : « […] et un jour, devant un tableau de Giorgio de Chirico, il eut enfin la vision d’un monde nouveau. » Et dans la foulée de cette confidence, il note son rejet brutal de la pensée rationaliste : « Il négligea définitivement le vieux grenier logico-réaliste, comprenant qu’il était lâche de se confiner dans une médiocrité raisonneuse […] » Comment comprendre cette curieuse conjonction, ce double événement, où simultanément la métaphysique est appelée et violemment rejetée ?
L’usage équivoque du mot « métaphysique » éclate jusque dans la vie intime de Crevel. « Je t’embrasse, mais sans métaphysique », cette formule finale de la lettre à Mopsa Sternheim du début mars 1928, semble vouloir dire : « je t’embrasse sensuellement, et non pas platoniquement ». Or une autre lettre à Mopsa du 8 mars 1928 se conclut par un dessin comprenant un cœur et une flèche ainsi que les noms de Mops et René, le tout ainsi légendé : « Diamant pour ta bague métaphysique ». Sommes-nous dans la symbolique sexuelle ou s’agit-il d’un mot de passe amoureux ou autre ? On se perd en conjectures, d’autant plus que le 8 avril, la « bague métaphysique » est évoquée à trois reprises. Au tout début de la lettre : « Merci pour la bague métaphysique, apportée hier par Ph.[ilip] Lasell. » Dans les dernières lignes : « Que ta bague métaphysique me redonne force. » Et en post-scriptum, sous le dessin d’une bague : « Pour toi cette bague métaphysique. » Mopsa a-t-elle confectionné un anneau magique pour René ? Mais alors on ne voit pas en quoi la symbolique de l’alliance et de la puissance rentrerait dans le champ de la métaphysique.
Quoi qu’il en soit, il faut dire qu’en 1925, voulant rendre hommage à Lautréamont dans Le Disque vert, Crevel n’hésitait pas à faire d’une bague poétique le symbole de sa « bouleversante amitié » avec Breton, Aragon et Éluard. Dans le titre et en conclusion de son article, il usait de cette formule incantatoire : « Lautréamont, ta bague d’aurore nous protège. »
René Crevel, qui est un contempteur de la raison métaphysique, qui combat l’existence de toute métaphysique, semble pourtant faire une exception avec les philosophies de l’existence. On n’aurait d’ailleurs aucun mal à faire de Crevel un existentialiste et à le rapprocher de Kierkegaard, Heidegger et Sartre. Ne va-t-il pas dans un passage de La Mort difficile, titre existentialiste s’il en fût, jusqu’à forger l’expression d' »angoisse métaphysique » ? N’y emploie-t-il pas le mot « métaphysique » à bon escient ? : « Pierre [à savoir René Crevel] […] parfois, n’est pas loin de croire que ses craintes particulières et même l’angoisse générale que volontiers il qualifierait de métaphysique, ne valent humainement ni plus ni moins que la peur de se perdre au Bois de Boulogne ou au Luxembourg quand il avait trois ans. »
Quel bel exemple de déréliction que celui de l’enfant perdu dans un bois ou égaré au milieu des gens. Du même coup, la métaphysique n’est-elle pas mise à la portée des enfants ?
Crevel existentialiste ? peut-être. Mais à coup sûr, il se déclare, en particulier dans Le Clavecin de Diderot, contre l’humanisme, contre le réalisme, contre l’idéalisme, contre la morale et la métaphysique dont il fait bruyamment le procès. Ses attaques qui visent au premier chef la philosophie classique de Descartes à Kant, se résument à la trahison de l’esprit par la raison. Car avec l’imposture du cogito cartésien, avec le tabou kantien sur l’inconnaissable chose en soi, avec la coupure entre soi et autrui, la raison a fini par triompher de l’esprit. À l’instar de Hegel et des phénoménologues, Crevel défend l’intersubjectivité contre les errements de la conscience monadique. Comme sur le plan de l’être il est plutôt moniste et sur le terrain de la connaissance plutôt holiste, Crevel ne cesse de dénoncer, chez « l’analysto-métaphysicien », un travail de décomposition, des opérations de réduction, une mise en épingle du détail. On devine de quel l’outillage peut se servir dans son laboratoire ou son cabinet l’analysto-métaphysicien : « les râpes métaphysiques, les vilebrequins de l’analyse ». Assurément pour Crevel la râpe métaphysique n’évoque pas les sensations amoureuses ou érotiques de la bague métaphysique. Comme le dit expressément René Crevel : « l’idéaliste refuse d’être le clavecin qui se laisse pincer. » En cette occurrence, métaphysique ne peut pas rimer avec musique.
Crevel met dans le même sac l’humaniste, le réaliste et l’idéaliste, qui tous trois puisent dans la raison métaphysique. L’humaniste, exhibant la plus plate définition de l’homme qui soit, cache mal sa mauvaise foi morale et son idolâtrie religieuse. Le réaliste, avec subsidiairement la caution de Thomas d’Aquin, dépeint le monde, comme toute une école de romanciers, aux couleurs du conformisme moral et politique. Quant à l’idéaliste, il représente avec son idéal ascétique le plus frénétique des masochistes, lui qui n’a que mépris pour le corps, la sexualité, les nourritures terrestres. Nécrophile impénitent, c’est un cercueil ambulant : « Il devient une boîte hermétiquement close, dont les cordes, faute d’être pincées, ne vont cesser d’aller se désaccordant. »
Crevel ne manque pas de ranger dans le camp rationaliste, à côté des idéalistes du sujet pensant et des analystes positivistes ou scientistes de la matière, certains psychanalystes dont la pratique comme les discours lui semblent normalisateurs. Le surréalisme n’est en aucun cas une resucée du freudisme. L’écriture automatique, les récits de rêve, la pratique du rêve éveillé dans Les Vases communicants, la paranoïa-critique de Dalí et dans le même registre les interprétations affolantes du chemin de croix dans Le Clavecin de Diderot n’expriment-ils pas un dépassement du rationnel et du raisonnable et n’affirment-ils pas du même coup une liberté d’esprit face à toute dogmatique freudienne ? À examiner l’idée d’inconscient, qui est une autre appellation de l’esprit, on s’aperçoit qu’elle est aussi percutante dans l’aventure surréaliste que dans la théorie psychanalytique. On trouvera d’ailleurs un écho des spéculations de Crevel et Dalí chez un certain Jacques Lacan.
De même, il ne faudrait pas croire qu’au cours des années vingt et trente Crevel et ses amis dadasurréalistes (il y a toujours le bruit de fond de la rébellion dada dans le surréalisme) seraient les seuls à se révolter contre le rationalisme ambiant. Ici il convient de citer le nom d’Emmanuel Berl, dont les deux pamphlets Mort de la pensée bourgeoise et Mort de la morale bourgeoise recoupent le contenu et le style de certaines pages de Crevel. Toutefois une violente polémique relative à « la littérature de sanatorium » les opposera l’un à l’autre. Il convient aussi de remarquer que si le grand bourgeois Emmanuel Berl inaugure, avec sa propension à l’autoflagellation, le poncif de la haine de la pensée bourgeoise, René Crevel pour sa part, au moment où il dévoile les supercheries de la raison, ne fait pas nécessairement le point sur ses embardées révolutionnaires et son engagement partisan.
Le mot « métaphysique » est employé à plusieurs reprises dans un passage des Pieds dans le plat. D’abord, Crevel, évoquant le mot « maison » nous met en garde contre la « maison en soi », contre une éventuelle substantialisation de la notion ; « gare à la métaphysique », nous dit-il. Ensuite, dans une note sur Heidegger, il observe que le philosophe de Fribourg s’est fourré dans un « cul-de-sac métaphysique ». Enfin à l’occasion des « explosions régénératrices » qu’il appelle de ses vœux, il précise que le discours métaphysique n’embrumera plus les esprits : « Les hommes alors ne s’emberlificotent plus dans des serpentins métaphysiques. » Plus loin dans l’ouvrage, à la fin d’une longue note, Crevel met en scène le surréalisme qui justement se déleste de la raison logique, morale ou esthétique. Employant l’expression « course de l’esprit », il montre l’esprit bondissant de « buissons d’actions et de réactions » en « buissons d’actions et de réactions ».
Cette course haletante de l’esprit ressemble au bouquet final d’un feu d’artifice : « Alors jaillissent des lianes de mercure, des liserons de vif-argent qui palpitent de l’un à l’autre pôle. La courbe va du plus secret au plus extérieur, de l’inconscient au conscient et vice versa. À travers choses, sensations, sentiments et idées, que de crépitants allers et retours. L’écriture est non plus un simple moyen d’expression, mais la ligne sismographique d’une pensée toujours en marche […] »
Il faut rapprocher tout ce flamboiement végétal et minéral, toute cette course de l’esprit d’un article de Documents 34 où Crevel prend la défense de Freud contre ses adversaires de droite comme de gauche en rappelant que le médecin viennois n’a jamais accordé à l’inconscient de « valeur nouménale ». Là il laisse poindre sa propre philosophie de l’esprit, qui ne serait autre qu’une dialectique du rationnel et de l’irrationnel : « Le déterminisme psychique est déterminé par d’autres déterminismes que, lui-même à son tour, il va déterminer. Il s’agit de ne négliger aucun de ces liserons conducteurs qui peuvent nous aider à nous y retrouver dans l’enchevêtrement équatorial des déterminismes. »
On voit comment Crevel, délaissant les « serpentins métaphysiques » de la raison, opte pour les « lianes de mercure », les « liserons de vif-argent » de l’esprit. Ces nouveaux fils conducteurs permettraient de mieux démêler « l’enchevêtrement équatorial des déterminismes » ou d’introduire un peu de clarté dans les « buissons d’actions et de réactions ». Mais y gagne-t-on vraiment au change ? Crevel n’use-t-il pas à son tour d’un subterfuge métaphysique ? Car sa dialectique des « liserons conducteurs » vaut-elle mieux que l’élucubration sortie d’un cerveau positiviste, à savoir la théorie des actes-champignons inventée par le grand-père du roman Babylone ? Les actes-champignons, dénués de racines, surgissent spontanément, gratuitement, bizarrement. Si la théorie gidienne de l’acte gratuit est la version ironique, esthétique du libre arbitre métaphysique, la théorie positiviste des actes-champignons est la version ahurie ou naïve du désir irrationnel. À ce compte, les liserons conducteurs de l’esprit, qui établissent un lien ténu entre la raison et la folie, peuvent-ils à la fois dissiper l’illusion du libre arbitre et radiographier les dendrites du désir ?
La métaphysique de Crevel s’ancre dans l’image et l’automatisme. Pour l’image, on songera aux tableaux de Chirico et Dalí, pour l’automatisme à la peinture de Max Ernst et Tanguy. Le point de départ du « Discours aux peintres », prononcé par Crevel le 9 mai 1935, est éloquent à cet égard : « Devant le tableau le plus bouleversant, que l’on se garde bien de crier au miracle de la génération spontanée. » On voit que l’orateur balaie d’un revers de main la théorie des actes-champignons. Et il poursuit : « Ils ont une racine, ils s’accrochent au quotidien ces fugaces liserons de l’inconscient, qui veinent le cristal ésotérique et marquent des chemins au plus inextricable du labyrinthe intérieur. » La métaphore du lien végétal et de l’architecture minérale est le sauf-conduit que Crevel nous délivre pour pénétrer la vie de l’esprit et de la société. Mais qui fera le relevé de ces arborescences, plans ou labyrinthes ? Certainement pas la science ni la philosophie, qui se croiraient obligées d’embaumer ou de disséquer les liserons de la pensée. Crevel s’en prend une fois de plus à l’analysto-métaphysicien : « Nous pouvons reconnaître la toute-puissance de ces fils ténus, sans être tentés d’en faire des lignes-frontières. L’analyse n’a que trop longtemps, trop impunément, scindé, morcelé. Elle avait construit des cloisons étanches autour des plus infimes poussières d’état psychique. Or, comme l’a constaté Hegel, l’esprit n’est pas un sac à facultés. »
Précisons ici que, pour les surréalistes et René Crevel, le mot « esprit » n’encourt pas le discrédit dans lequel le terme et la chose métaphysiques sont tombés. Rappelons que le premier procès-verbal de hasard objectif, publié en mars 1922 dans Littérature, s’intitule « L’esprit nouveau », concept emprunté à Apollinaire. Rappelons qu’aurait dû se tenir à la même date, sous la houlette de Breton et d’autres animateurs de revue un « Congrès international pour la détermination des directives et la défense de l’esprit moderne ». Rappelons surtout que « La Crise de l’esprit » de Paul Valéry paru en anglais puis en français, avait fait sensation en 1919. Si l’incipit du texte, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles », ressemblait à une profession de fois historiciste, c’est l’Europe mentale d’avant-guerre, celle de 1914, que Valéry caractérisait comme une époque moderne, la modernité pouvant d’ailleurs s’appliquer à des époques reculées, à condition qu’y soufflât la liberté de l’esprit et qu’y fusionnassent diverses matières incandescentes. Pour Paul Valéry, la modernité aurait résulté en 1914 d’une multiplicité d’apports gagnant vite tous les esprits et instaurant en quelque sorte un « désordre à l’état parfait ».
Selon Valéry, l’esprit moderne qui soufflait le chaud en 1914, avait été passablement refroidi durant la guerre. Il entrait en crise. Il n’était plus question d’une coexistence des différences ou des oppositions. Toutes les mentalités, toutes les idées avaient été chahutées, aussi bien la culture européenne que la science, l’idéalisme que le réalisme, les croyances religieuses que les retranchements sceptiques. On trouvera chez René Crevel un sentiment semblable de tournis devant les frasques de l’histoire et de la raison. Y avait-t-il en 1919 un espoir de redresser la barre de l’histoire, de surmonter la crise de l’esprit ? La question formulée par Valéry allait être reprise en 1926 par Crevel dans L’Esprit contre la Raison. Disons tout de suite que Crevel entend penser avec les mots de Valéry pour les retourner contre Valéry.
Donc, au sortir de la Grande Guerre, Valéry diagnostique une crise grave et profonde de l’esprit. Tel un médecin avisé mais prudent, il se garde de tout pronostic sur les suites de la crise. Et quand il se met à prononcer le mot « espoir », c’est pour le disqualifier et le rejeter aussitôt : « Mais l’espoir, dit-il, n’est que la méfiance de l’être à l’égard des prévisions précises de son esprit. » Valéry maintient donc son diagnostic de crise de l’esprit en écartant à l’avance toute objection frappée des couleurs de l’espoir. Le sentiment d’espoir n’étant que la dénégation des prévisions acérées de l’esprit. Qui se réfugie dans l’espoir se refuse d’y voir clair.
Par trois fois la sentence valéryenne contre l’espoir est convoquée dans le manifeste crevelien L’Esprit contre la Raison. Citée d’entrée de jeu, elle est certes revendiquée mais pour être réinterprétée et retournée contre son auteur. Alors que pour Valéry, l’esprit est inséparable de la raison, pour Crevel, la raison doit être mise au ban de l’esprit. C’est pourquoi sont aussitôt pointés les « méchancetés de l’intelligence », les « syllogismes truqués », les « principes à double fond », bref toutes les raisons sournoises de la raison. Et ces tricheries ou ces mensonges de la raison sont solennellement dénoncés comme « un véritable crime contre l’esprit ».
Pour Crevel, les enquêtes dadasurréalistes, dérangeantes et démoralisantes, posent les vraies questions morales et métaphysiques : « Pourquoi écrivez-vous ? », « Le suicide est-il une solution ? » Revenant justement sur cette dernière question, Crevel l’interprète à la lumière de la sentence de Valéry contre l’espoir. Face au suicide, l’esprit passera outre les ruses de la raison. Imagine-t-on le désespoir se laissant mystifier par l’espoir ? Crevel poursuit en fait une confrontation avec Valéry, entamée dans La Révolution surréaliste. Car curieusement la revue avait publié, à la suite l’une de l’autre, la réponse de Crevel en faveur du suicide et la mise au point plus détachée et sophistiquée d’un certain Edmond Teste.
Et lorsque Crevel parvenu au terme de L’Esprit contre la Raison cite une troisième fois la sentence de Valéry contre l’espoir, il s’approprie entièrement la citation. Est poète celui qui étreint l’ombre et non la proie, le désespoir et non l’espoir, est surréaliste celui dont les ruses de la raison n’amadoueront jamais la liberté de l’esprit.
Une seconde phrase, tirée de « La crise de l’esprit » a requis Crevel : « Un frisson extraordinaire a couru la moelle de l’Europe ». Le poète surréaliste, sans citer sa source, applique cette secousse qui fait frémir l’Europe à l’individu écartelé entre la raison et l’esprit : « Tout au long de sa moelle court le frisson des certitudes négatives […] ». Mais, plus loin, la phrase sur le frisson sera prise à charge contre son auteur. Crevel se démarquera de Valéry en réfutant le concept de « crise de l’esprit ». Crevel exécutera son inspirateur dans une véritable envolée oratoire : « Libre donc à Paul Valéry d’évoquer sur le mode lyrique les frissons extraordinaires qui ont couru sur la moelle de l’Europe, les produits connus de l’anxiété qui va du réel au cauchemar et retourne du cauchemar au réel, libre à lui de prononcer l’oraison funèbre du Lusitania et d’entonner ses thrènes. Ni les frissons extraordinaires, ni les produits connus de l’anxiété, ni l’histoire pitoyable du Lusitania, ni aucun des spectacles où il est d’une telle facilité de nous convier à nous apitoyer et qui, dans leur plus terrible désolation, demeurent tout de même du domaine du relatif, ne sauraient être invoquées comme preuves ou causes d’une crise de l’esprit. / Crise de l’esprit ? Le symbole est bien commode, mais l’expression même trop lourde de sous-entendus pour que ne s’éveille point notre méfiance. »
Arrêtons-là cette attaque en règle. Il y a certes une crise politique ou économique. Mais pour Crevel les malheurs de l’Occident ne suffisent pas à décréter une crise de l’esprit. L’esprit n’est pas en panne. À preuve, l’esprit de l’Orient. À preuve, l’esprit surréaliste ou dadasurréaliste.
Il est piquant de noter ici que le cérébral Valéry est traité par Crevel de sentimental. Mais si l’on veut continuer à traquer la pulsion métaphysique de Crevel, il faut revenir à la peinture métaphysique de Chirico. Dans son premier article sur Chirico intitulé « La minute qui s’arrête », Crevel fait une belle réflexion sur l’expérience de la « première impression ». La première impression, dont on sait qu’elle est la meilleure, est hélas vite recouverte par mille autres impressions inopportunes, fâcheuses ou ennuyeuses. Et c’est le mystère de cette première impression, de cette première secousse que révèle la peinture de Chirico. Crevel voit en Chirico l’archéologue qui fait remonter à la surface une ville immuable, une Pompéi enfouie, qui nous fait parcourir « les rues de quelque cité nouménale ». Le mot noumène étant associé à Kant, Crevel remarquera dans L’Esprit contre la Raison que les tableaux de Chirico nous rendent « plus dignes du rêve absolu où un Kant put sentir son esprit s’amplifier en plein vertige nouménal ».
Même si selon nous la peinture métaphysique de Chirico n’est autre que la transfiguration de la ville de Turin contemporaine des dernières illuminations de Nietzsche puis de son effondrement, il reste que Crevel découvre chez Chirico l’intuition d’un absolu, la minute qui s’arrête sur une première impression. Crevel esquisse l’analyse de ce qu’il faut appeler une durée automatique. Le Clavecin de Diderot se fait justement l’écho d’une durée surréaliste dans les pages étranges relatives à deux chiens. Son fox baptisé Marius ayant disparu, on offre à Crevel une femelle caniche. Première coïncidence, elle se nomme Marianne. Crevel, frappé par la personnalité de sa chienne insomniaque dont il dresse un portrait affolant, décide de l’appeler Mme Hebdomeros, « parce qu’elle n’était pas sans rapport avec le héros de Chirico ». Deuxième coïncidence, Mme Hebdomeros, qui alla se cogner contre une voiture, ne survécut qu’une semaine.
Écoutons Crevel : « Une lourde pelote de laine qui perd sa chaleur, sur une route, au soir tombant, je ne pourrai plus, sous un autre aspect, me figurer la mort. Dans mes rêves, le regard de Mme Hebdomeros se ralluma, ne se ralluma que pour s’éteindre. » Crevel poursuit : « À la minute où elle se laissait aller de toute sa masse, une autre masse faisait une chute simultanée. C’était mon sexe qui se détachait à l’instant que Mme Hebdomeros n’avait plus le courage, la vie de se laisser tenir sur ses quatre pieds de midinette. Elle avait au préalable, lu, jugé mes plus intimes pensées. »
Plutôt que de tirer l’épisode du côté de la castration, ce à quoi René Crevel se refuse, il faudrait le rapporter à la peinture métaphysique de Chirico. Deux signes temporels de l’épisode renvoient à Chirico : Mme Hebdomeros abrège à une semaine son existence ; la chute du sexe de Crevel se produit « à la minute » même où s’éteint Mme Hebdomeros, le mot « minute » rappelant « La minute qui s’arrête », le premier article de Crevel sur Chirico.
Justement jetons un œil sur le premier article de Breton consacré à Chirico. Dans Littérature de janvier 1920, Breton fait de Chirico le mythologue de la modernité, ajoutant que la nature de son esprit « le disposait par excellence à réviser les données sensibles du temps et de l’espace ». Il accorde alors une stature métaphysique au peintre qui réintuitionne le temps et l’espace, les deux formes pures de la sensibilité selon Kant. S’il y avait un doute à ce sujet, il suffirait de lire de près la citation ouvrant l’article : « Lorsque Galilée fit rouler sur un plan incliné des boules dont il avait lui-même déterminé la pesanteur, ou que Toricelli fit porter à l’air un poids qu’il savait être égal à une colonne d’eau à lui connue, alors une nouvelle lumière vint éclairer tous les physiciens. »
Ces considérations viennent tout droit de la Préface de la seconde édition de la Critique de la raison pure, où Kant s’appuyant entre autres sur la révolution épistémologique de Galilée, explique la révolution copernicienne que lui-même opère en philosophie. Signalons que la source kantienne, citation d’ailleurs tronquée, n’a pas été identifiée par Marguerite Bonnet qui note dans l’édition de la Pléiade : « Ce paragraphe paraît provenir d’un ouvrage de vulgarisation ou d’une page de dictionnaire […] » Dès son premier article, Breton célèbre donc Chirico comme un étrange ingénieur, grand témoin de son temps, mais aussi comme un super kantien, un super copernicien, un nouveau métaphysicien du temps et de l’espace.
Les dada-surréalistes, René Crevel ou André Breton, dans leur investigation de l’esprit, ont trois interlocuteurs majeurs : Valéry, Chirico et Freud. En 1919, Valéry suggère à Breton de prendre comme titre de revue Littérature, le mot étant souligné. En 1929, Breton et Éluard, sous le titre « Notes sur la poésie » rewriteront le texte de Valéry intitulé « Littérature ». Entre-temps, avec L’Esprit contre la Raison, Crevel proposait une libre adaptation de « La crise de l’esprit ». Les surréalistes se montreront intraitables avec Chirico, dès qu’ils jugeront le peintre indigne de sa peinture métaphysique. Enfin, avec Freud, l’affaire se complique, Crevel, Breton, Dalí étant à la fois des analystes sauvages de l’inconscient et des métaphysiciens désireux de couper l’herbe sous le pied des philosophes rationalistes.
Crevel rappelle, à la dernière page de Êtes-vous fous ?, que jamais la raison n’abordera l’Amérique de l’esprit : « […] de mystérieux Gulf Stream vont, viennent, labourent les flots de la mappemonde spirituelle, où restent à découvrir tant d’Amériques dont la Raison voudrait bien être, mais ne sera pas le Christophe Colomb. » Car il y a de l’imprévu et de la folie dans la quête de l’esprit. Breton le remarquait déjà dans le Manifeste du surréalisme : « Il fallut que Colomb partit avec des fous pour découvrir l’Amérique. » Il fallait être fous à quelques-uns et ensemble pour dessiner la mappemonde dadasurréaliste. Il fallait des aînés, des revenants : Chirico, Valéry ou Freud. Et des cadets, des survenants aussi dissemblables, de corps comme d’esprit, que Breton, Aragon, Soupault, Éluard, Dalí ou René Crevel.
Georges Sebbag
Références
Georges Sebbag, « René Crevel métaphysicien », Mélusine n° 22, mai 2002. Conférence prononcée lors du colloque international « René Crevel ou l’esprit contre la raison », dirigé par Jean-Michel Devésa et qui s’est tenu à Bordeaux du 21 au 23 novembre 2000.