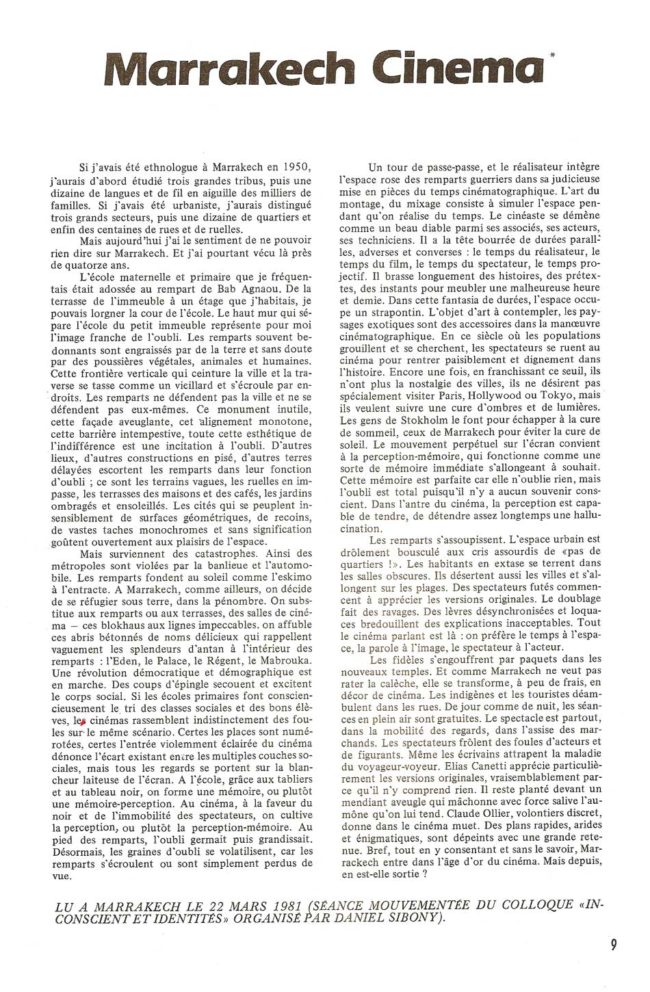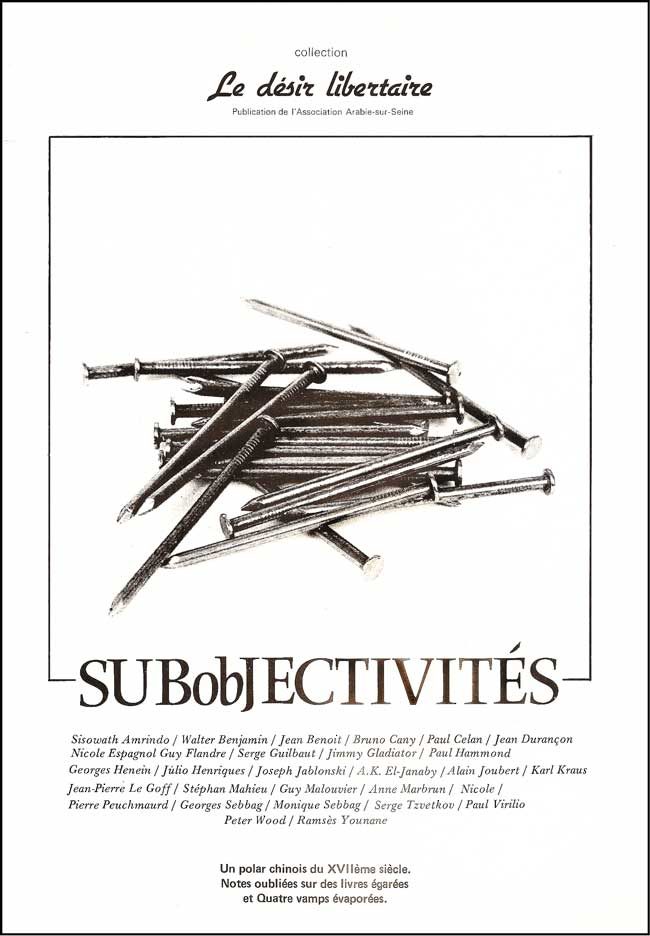
Si j’avais été ethnologue à Marrakech en 1950, j’aurais d’abord étudié trois grandes tribus, puis une dizaine de langues et de fil en aiguille des milliers de familles. Si j’avais été urbaniste, j’aurais distingué trois grands secteurs, puis une dizaine de quartiers et enfin des centaines de rues et de ruelles.
Mais aujourd’hui j’ai le sentiment de ne pouvoir rien dire sur Marrakech. Et j’ai pourtant vécu là près de quatorze ans.
L’école maternelle et primaire que je fréquentais était adossée au rempart de Bab Agnaou. De la terrasse de l’immeuble à un étage que j’habitais, je pouvais lorgner la cour de récole. Le haut mur qui sépare l’école du petit immeuble représente pour moi l’image franche de l’oubli. Les remparts souvent bedonnants sont engraissés par de la terre et sans doute par des poussières végétales, animales et humaines. Cette frontière verticale qui ceinture la ville et la traverse se tasse comme un vieillard et s’écroule par endroits. Les remparts ne défendent pas la ville et ne se défendent pas eux-mêmes. Ce monument inutile, cette façade aveuglante, cet alignement monotone, cette barrière intempestive, toute cette esthétique de l’indifférence est une incitation à l’oubli. D’autres lieux, d’autres constructions en pisé, d’autres terres délayées escortent les remparts dans leur fonction d’oubli ; ce sont les terrains vagues, les ruelles en impasse, les terrasses des maisons et des cafés, les jardins ombragés et ensoleillés. Les cités qui se peuplent insensiblement de surfaces géométriques, de recoins, de vastes taches monochromes et sans signification goûtent ouvertement aux plaisirs de l’espace.
Mais surviennent des catastrophes. Ainsi des métropoles sont violées par la banlieue et l’automobile. Les remparts fondent au soleil comme l’eskimo à l’entracte. À Marrakech, comme ailleurs, on décide de se réfugier sous terre, dans la pénombre. On substitue aux remparts ou aux terrasses, des salles de cinéma – ces blockhaus aux lignes impeccables. On affuble ces abris bétonnés de noms délicieux qui rappellent vaguement les splendeurs d’antan à l’intérieur des remparts : l’Éden, le Palace, le Régent, le Mabrouka. Une révolution démocratique et démographique est en marche. Des coups d’épingle secouent et excitent le corps social. Si les écoles primaires font consciencieusement le tri des classes sociales et des bons élèves, les cinémas rassemblent indistinctement des foules sur le même scénario. Certes les places sont numérotées, certes rentrée violemment éclairée du cinéma dénonce l’écart existant entre les multiples couches sociales, mais tous les regards se portent sur la blancheur laiteuse de l’écran. À l’école, grâce aux tabliers et au tableau noir, on forme une mémoire, ou plutôt une mémoire-perception. Au cinéma, à la faveur du noir et de l’immobilité des spectateurs, on cultive la perception, ou plutôt la perception-mémoire. Au pied des remparts, l’oubli germait puis grandissait. Désormais, les graines d’oubli se volatilisent, car les remparts s’écroulent ou sont simplement perdus de vue.
Un tour de passe-passe, et le réalisateur intègre l’espace rose des remparts guerriers dans sa judicieuse mise en pièces du temps cinématographique. L’art du montage, du mixage consiste à simuler l’espace pendant qu’on réalise du temps. Le cinéaste se démène comme un beau diable parmi ses associés, ses acteurs, ses techniciens. Il a la tête bourrée de durées parallèles, adverses et converses : le temps du réalisateur, le temps du film, le temps du spectateur, le temps projectif. Il brasse longuement des histoires, des prétextes, des instants pour meubler une malheureuse heure et demie. Dans cette fantasia de durées, l’espace occupe un strapontin. L’objet d’art à contempler, les paysages exotiques sont des accessoires dans la manœuvre cinématographique. En ce siècle où les populations grouillent et se cherchent, les spectateurs se ruent au cinéma pour rentrer paisiblement et dignement dans l’histoire. Encore une fois, en franchissant ce seuil, ils n’ont plus la nostalgie des villes, ils ne désirent pas spécialement visiter Paris, Hollywood ou Tokyo, mais ils veulent suivre une cure d’ombres et de lumières. Les gens de Stockholm le font pour échapper à la cure de sommeil, ceux de Marrakech pour éviter la cure de soleil. Le mouvement perpétuel sur l’écran convient à la perception-mémoire, qui fonctionne comme une sorte de mémoire immédiate s’allongeant à souhait. Cette mémoire est parfaite car elle n’oublie rien, mais l’oubli est total puisqu’il n’y a aucun souvenir conscient. Dans l’antre du cinéma, la perception est capable de tendre, de détendre assez longtemps une hallucination.
Les remparts s’assoupissent. L’espace urbain est drôlement bousculé aux cris assourdis de « pas de quartiers ! ». Les habitants en extase se terrent dans les salles obscures. Ils désertent aussi les villes et s’allongent sur les plages. Des spectateurs futés commencent à apprécier les versions originales. Le doublage fait des ravages. Des lèvres désynchronisées et loquaces bredouillent des explications inacceptables. Tout le cinéma parlant est là : on préfère le temps à l’espace, la parole à l’image, le spectateur à l’acteur.
Les fidèles s’engouffrent par paquets dans les nouveaux temples. Et comme Marrakech ne veut pas rater la calèche, elle se transforme, à peu de frais, en décor de cinéma. Les indigènes et les touristes déambulent dans les rues. De jour comme de nuit, les séances en plein air sont gratuites. Le spectacle est partout, dans la mobilité des regards, dans l’assise des marchands. Les spectateurs frôlent des foules d’acteurs et de figurants. Même les écrivains attrapent la maladie du voyageur-voyeur. Elias Canetti apprécie particulièrement les versions originales, vraisemblablement parce qu’il n’y comprend rien. Il reste planté devant un mendiant aveugle qui mâchonne avec force salive l’aumône qu’on lui tend. Claude Ollier, volontiers discret, donne dans le cinéma muet. Des plans rapides, arides et énigmatiques, sont dépeints avec une grande retenue. Bref, tout en y consentant et sans le savoir, Marrakech entre dans l’âge d’or du cinéma. Mais depuis, en est-elle sortie ?
Le cinéaste ne nous accable pas de portraits saisissants, d’images affolantes ou d’une association d’idées bien conduite. Il garde la tête froide, compulse longuement des documents, détruit certains rushes, coupe court à toute insinuation, impose un tempo, finalement apaise les esprits. Sa patience est jalonnée de fractures, de disparitions, de raccords, d’apparitions. Les durées sont à la fête dans toutes les bobines. Le film ne raconte pas la légende d’un temps et d’un lieu mais sème le doute et la déroute, la mort et la résurrection. De même que la production industrielle a favorisé l’exode rural, les projections cinématographiques ont stimulé les fuites urbaines. On quitte sa ville momentanément ou définitivement. Pour la campagne, pour une autre ville, pour un nouveau continent. Ces déplacements dans l’espace sont les modestes traductions des inversions, des chassés-croisés, des éclipses du temps filmique.

À Hollywood on fait du cinéma, à Marrakech on est en plein cinéma. Revoir Marrakech c’est revoir un film avec le risque que la nouvelle projection ne coïncide pas avec les précédentes. Le cinéma est une histoire mouvante et émouvante et non un dépôt d’images, c’est pourquoi les populations du globe ont vite gobé la notion de modernité. Cette simple technique de foire, cette merveille pour enfants est capable de révéler à tous la mode, le m’as-tu-vu, les beaux jours et les petits matins du quotidien et surtout le refus de la tradition. D’où l’embarras non feint des religions ancestrales et des principaux courants de ferveur contemporains. Alors qu’il faut des années pour accéder au livre, tout un cérémonial pour pénétrer dans un théâtre, le cinéma offre immédiatement et à chaque séance le traitement d’une passion. Comment condenser de longues histoires compliquées et les faire tenir dans des instants fragiles ? Comment affronter les changements, les perversions, les cataclysmes ? Le spectateur, calé dans un fauteuil, perçoit et expérimente en douceur les réponses à ces questions. Dans la plupart des villes, les spectateurs viennent étancher leur soif de durées visibles et de temporalités non identifiables dans le bunker de leur choix, mais à la sortie ils écarquillent encore les yeux. Marrakech, ville plutôt maternelle, a réussi à amortir les craintes et les tremblements puisque l’irréalité des rues, des murs et des passants ne dément pas les visions de l’écran. C’est comme si Marrakech évitait à des joueurs de billards électriques, ébranlés par les vibrations étincelantes des appareils, le tilt de l’angoisse.
L’écran blanc fait l’amour avec tous les films. Les amants passent et repassent, l’écran demeure immaculé. Cette érotique fantastique, cet amour sans problème décontenancent les multitudes de voyeurs amateurs. L’écran supporte les fadaises et les outrances, l’attendrissement et le soulagement. Le spectateur perd complètement les pédales. La maison où il est né, la rue où il joue, l’école où il va – ces emplacements et ces trajets sont déchiquetés par les plans et les séquences qui déferlent sur l’écran. En regardant les remparts, on s’exerçait à l’oubli, en revoyant l’écran on cesse aussitôt de penser qu’on va sombrer dans l’oubli. Comment résister aux diverses mises au point faites sur l’écran ? Comment repousser les nuances du noir et blanc, les avances du technicolor ? L’ère de la double-vue commence, les simulacres montent sur scène. On ne garde plus ses yeux dans la poche. On lève fièrement la tête après s’être recueilli passionnément dans la pénombre du cinéma.
On se met à caresser des objets non identifiables : la ville, l’enfance, le cinéma. On se heurte à ses contemporains sans les voir. On prend ses distances avec l’esprit de sérieux et les bons mots ne nous font pas rire. On plonge dans la mêlée, on se détache des contingences. On n’est pas pour autant coupé en morceaux, on ne se précipite pas vers les issues de secours. Le cinéma intérieur ronronne. On est entré, on a franchi le seuil du cinéma. Mais nous voilà bien avancés, d’autres objets techniques – automobile, télévision, satellite – nous tournent autour. On se contente pour l’instant de la double-vue que les ouvreurs et les ouvreuses de cinéma nous ont donnée en pourboire. Cette double-vue nous est utile dans le dédale des circuits de durées.
J’ai envie de répondre à la question « quand cela se passera-t-il ? » et j’aimerais ignorer la lancinante question « qui es-tu donc ? ». Par exemple, si ma venue à Marrakech comporte certainement ses parts d’anticipation, de prévention, d’improvisation, de ritualisation, il n’est pas indispensable de savoir avec qui, pour qui, contre qui se font les promenades et les discussions. Si on admettait, en général, que qui a la préséance sur quand, le pauvre qui impavide mais poussé par le démon de la distraction, n’aurait qu’une ressource, faire diversion avec un autre qui. Par contre si qui talonnait quand, qui oublierait, s’oublierait et au détour d’une période ou d’un moment se retrouverait.
Les échelles du temps, les chronologies, la datation des événements, l’économie des épisodes dans une histoire ne me paraissent pas d’un grand secours pour analyser la déstabilisation des villes par le cinéma. Toutefois si les techniques quantitatives ou structurales sont inopérantes dans un cas, elles sont indispensables dans d’autres cas. Il est imprudent de proposer des modèles formels du temps, car la vérité est toujours particulière et quand elle est générale, il s’agit encore d’un cas particulier. La démarche Marrakech cinéma n’est pas celle d’un souvenir en quête d’auteur, ni celle d’un brillant calcul démontrant que le temps perdu est rattrapable, mais celle d’une occasion d’évoquer la rencontre fortuite d’une ville et d’un vertige. Marrakech enfante le cinéma et le cinéma ne dévide pas entièrement Marrakech. Un drame a été évité de justesse, la cohabitation des durées modernes est possible pendant un certain temps. Mais les durées ne disent jamais leur dernier mot. Jetons un coup d’œil dans l’entrée du cinéma : le passé, le présent et le futur font sagement la queue devant la caisse. Une fois ces messieurs du temps en possession de leur billet, leur dispersion statistique et humoristique dans le noir devient la règle commune.
La conduite du récit dans un roman, la mise en pièces des durées au cinéma sont de bonnes introductions et conclusions à la double vie. Tout commence et tout finit par des plans cinématographiques. Les villes ne fixent plus leurs habitants. Les habitants ne fixent plus les murs. Les murs perdent de leur épaisseur et se déplacent ; ils sont en transit comme les idées et les plaisirs qui se confondent avec leurs simulacres. Les petits et les grands écrans, à demeure, portables, transportables attendent la minute de projection, l’étincelle de vérité. Les écrans annoncent la couleur : le train qui entre en gare de La Ciotat n’en cache pas un autre. Étant donné le lexique en vigueur – image, écran, souvenir, plan, oubli – on croit toucher du doigt une psychologie de la perception ou une théorie de l’inconscient. On est surpris de ne pas photographier le moi à l’aéroport, dans l’avion, à l’hôtel. Il a peut-être disparu mais s’il revient, une théorie de durées se prépare à l’accueillir en fanfare.
Il faudrait classer Marrakech et le cinéma dans les durées pures et sages. Par contre les notions d’identité, de vécu, d’inconscient, de religion, de politique auraient leur place dans le rayon des durées folles et polémiques. Les combats de mots sont les traces sanglantes et amoureuses des ébats du temps. Pour prononcer des mots, pour les écrire, on emprunte soi-même un échangeur de durées. Ce qu’on reçoit, ce qui nous revient, on voudrait le rendre au centuple. Les changements de bobines sont fréquents. On s’interrompt. On craint d’avoir fait trop long à une époque où il faut faire court. On n’a pas la chance d’avoir droit aux trois lettres qui au cinéma avertissent les spectateurs que leur infortune commence.
Georges Sebbag
Note
Lu à Marrakech le 22 mars 1981 (séance mouvementée du colloque « Inconscient et identités » organisé par Daniel Sibony).
Références
Georges Sebbag, « Marrakech cinéma », Le Désir libertaire, « SUBobJECTIVITÉS », fin 1981 (revue bilingue, français et arabe). Le texte est repris dans Georges Sebbag, Le Temps sans fil, Quando, 1984.