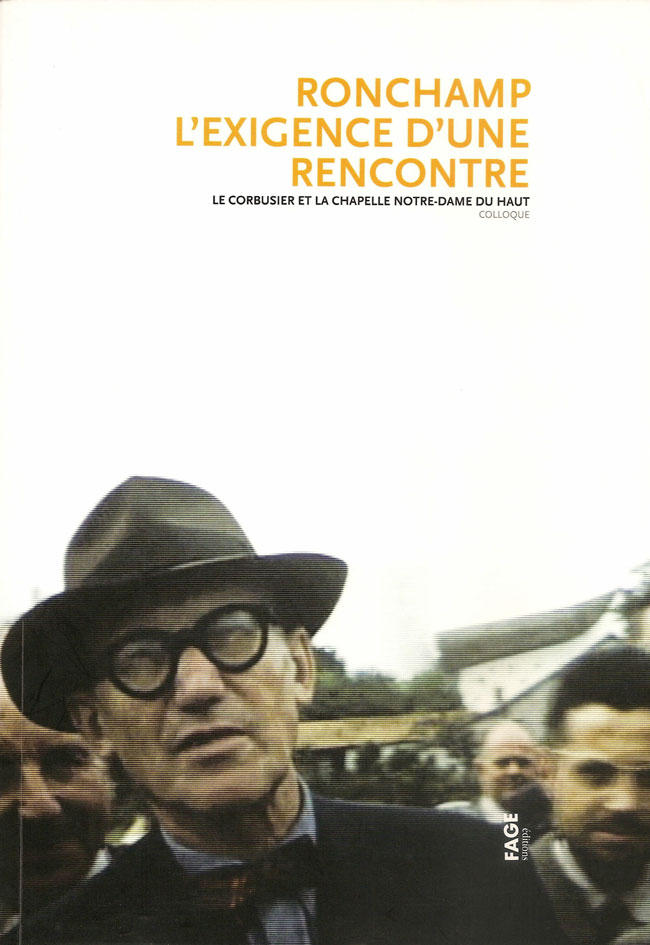
Imaginons que nous soyons au XIXe siècle et que nous mettions côte à côte un échantillon de l’art sacré, comme un vitrail du Moyen Âge, et un produit de l’industrie moderne, une locomotive par exemple, le rapprochement paraîtrait incongru et, en tout cas, le choc serait assez rude. Situons-nous maintenant en 2005 et essayons d’opposer les deux termes d’art sacré et de modernité. Une étonnante surprise nous attend. Première constatation, la modernité, qui a sans doute inauguré une nouvelle ère, a derrière elle à présent deux, trois, voire quatre siècles. Elle a beau s’enorgueillir de ses avancées, elle porte aussi le fardeau de ses acquis. Elle découvre bon gré mal gré qu’elle relève d’une tradition, qu’il faut bien appeler la tradition moderne ou même le bon vieux moderne. Deuxième constat, l’art sacré des religions occupe une place minuscule dans la république des arts alors que sur le fronton de tous les monuments de cette même république, on peut lire ces devises répétitives : « l’art profane est sacré », « l’art moderne est sacré », « l’art contemporain est sacré », « les installations sont sacrées », « l’anti-art est sacré », bref « l’art est sacré ». D’où la question pendante, où est passé l’art sacré traditionnel ?
Disons les choses autrement. À la naissance des temps modernes, l’art profane et l’art sacré faisaient semble-t-il jeu égal, de nombreux artistes intervenant d’ailleurs sur le parvis de l’art sacré comme dans la cour d’honneur de l’art profane. Mais à présent, à l’issue de cette longue durée moderne, qui n’est toujours pas achevée, car elle est peut-être interminable ou inachevable, et qui a connu tour à tour l’épanouissement, l’éclatement et la dissémination des beaux-arts, l’art profane, qui monopolise tous les arts actuels, tend pour l’essentiel à une adoration des artistes et à un fétichisme des produits. Et devant un tel culte de l’art, devant une telle religion des stars, des artistes ou des vedettes, l’art sacré fait désormais figure de parent pauvre.
C’est pourquoi le geste architectural d’un moderne comme Le Corbusier touchant au sacré de la religion doit être apprécié au premier chef à la lumière du sacré de la modernité.
La modernité surréaliste et le sacré
Dans La Poésie moderne et le sacré, un essai publié en 1945, Jules Monnerot entendait montrer que la poésie moderne, représentée par le surréalisme, était en consonance avec le sacré venu du plus lointain des religions primitives ou du plus profond des religions sécularisées. Qu’y a-t-il donc de sacré dans la modernité surréaliste ? D’abord, il y aurait du sacré dans le scandale pour le scandale de la période dada, les poètes surréalistes manifestant alors leur révolte devant l’aplatissement du monde par la raison scientiste. Ensuite, il y aurait dans les objets surréalistes autant de sacré que dans les objets des îles d’Océanie. On ne peut pas s’y tromper, même magie, même envoûtement dans un objet à fonctionnement symbolique de Giacometti ou de Salvador Dalí que dans un masque océanien. De plus, la classification des objets surréalistes, comprenant entre autres des ready made et des objets trouvés, a comme but avoué d’opérer un vaste reclassement des objets utiles ou standardisés. Enfin, la recherche, par les surréalistes, du « surréel » ou du « merveilleux », qui leur fait « perdre (“mais vraiment perdre”) la distinction du subjectif et de l’objectif, de l’intérieur et de l’extérieur, du connaître et de l’être[1] », cette recherche donc qui les transporte et les ravit correspondrait très exactement pour Jules Monnerot à l’expérience extatique du sacré.
Essayons de prolonger et d’étoffer la thèse de Monnerot sur le sacré inhérent à la modernité surréaliste en évoquant le groupe surréaliste puis la rencontre, qui est au cœur de l’imaginaire surréaliste, et enfin les images de la modernité mises en avant par les surréalistes.
La notion de groupe
Monnerot remarque tout de suite que les mots de « bande », de « clan » ou de « secte » sont inappropriés pour qualifier le groupe surréaliste. C’est pourquoi il propose le vocable anglais set qui désigne une série et qui, en l’occurrence, rendrait compte d’« une union de hasard sans obligation ni sanction[2] ». Mais comme ce terme de set paraît trop lâche pour évoquer un groupe fondé sur des « affinités électives », Monnerot corrige le tir en indiquant que le set surréaliste tendrait idéalement, mais sans y parvenir, à former un Bund, terme allemand signifiant « ligue », le terme de Bund s’opposant aussi bien à la société de contrat (Gesellschaft) qu’à la communauté de sang (Gemeinschaft). On se doute que cette question de définition n’est pas anodine, car tous ces termes n’engagent pas une expérience similaire du profane et du sacré.
Pour notre part, nous écarterons les dénominations littéraires ou artistiques de cénacle ou de chapelle ainsi que l’étiquette révolutionnaire d’avant-garde et nous dirons des surréalistes, en suivant en partie Jules Monnerot, qu’ils forment un groupe collagiste. En effet, ce qui traverse, déchire et forme le groupe en question, c’est une série fluctuante de collages passionnels entre deux, entre trois, entre quatre ou même entre cinq de ses membres. Le chant du groupe est en permanence entonné par ces duos, ces trios, ces quatuors et autres quintettes collagistes. Une brève note ethnographique pour fixer le collagisme surréaliste : tous les jours, ou presque, nos collagistes sortent à cinq heures pour se rendre au café surréaliste.
La rencontre
L’idée de rencontre, explicitée et exaltée par André Breton sous le nom de « hasard objectif », est l’idée surréaliste par excellence. En 1933, elle fait l’objet d’une vaste enquête dans la revue Minotaure : « Quelle a été la rencontre capitale de votre vie ? Jusqu’à quel point cette rencontre vous a-t-elle donné, vous donne-t-elle l’impression du fortuit ? du nécessaire ? » En nous saisissant de ce mot rencontre, qui est d’ailleurs crucial pour la construction de la chapelle de Ronchamp par Le Corbusier, nous ne pensons pas trop nous aventurer en déclarant qu’il est au croisement de la modernité et du sacré. Pourquoi la modernité ? Parce que dans la ville moderne, l’éventuel est au coin de la rue ou à la terrasse d’un café. Pourquoi le sacré ? Parce que les « pétrifiantes coïncidences » du hasard objectif sont accueillies par les surréalistes comme des révélations et recueillies comme des reliques.
Les images de la modernité
Pour ce qui est des icônes de la modernité, André Breton avait montré, dès janvier 1920, que le parapluie et la machine à coudre de Lautréamont (souvenez-vous : « Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie »), que le chapeau haut de forme introduit par Apollinaire dans un poème, que le mannequin omniprésent dans la peinture métaphysique de Chirico, que tous ces objets alimentaient en images la « mythologie moderne en formation ».
En récapitulant ces trois points, le collagisme du groupe, la rencontre magnétisée au hasard des rues de la ville et l’imaginaire moderne en formation, on s’aperçoit que les poètes et les artistes surréalistes ont découvert qu’il y avait du sacré dans la modernité, offrant ainsi une alternative au sacré des religions.
La sociologie du sacré
Comme en témoignent Le Paysan de Paris de Louis Aragon, La liberté ou l’amour de Robert Desnos ou Nadja d’André Breton, la ville moderne peut être enchantée. Or cette survenue du sacré dans la modernité que les surréalistes ont décelée dans les années 1920 va être au centre des activités et des réflexions d’un tout autre groupe entre 1936 et 1939. En avril 1936, l’histoire de Contre-Attaque, un collectif à visée politique réunissant les amis d’André Breton et ceux de Georges Bataille, est en train de s’achever. Commence alors, autour de Georges Bataille, l’histoire de la revue Acéphale et de la société secrète Acéphale. Quand paraît le premier numéro de la revue Acéphale, sous-titré « Religion – Sociologie – Philosophie » et daté du 24 juin 1936, s’étale sur la couverture l’image-choc de l’homme acéphale dessiné par André Masson : un homme au corps vigoureux et nu, au cou tranché, un bras brandissant un poignard, l’autre main serrant un cœur enflammé ou une grenade, des tripes à découvert recelant un dédale, et un crâne à l’emplacement du sexe. Des formules percutantes émaillent ce premier numéro : « Nous sommes farouchement religieux », « Ce que nous entreprenons est une guerre », « L’homme échappera à sa tête comme le condamné à la prison ». Or lorsque Georges Bataille affirme que l’existence humaine, dépouillée de sa cérébralité, peut frayer avec la mort, sans en être effrayée, il le fait dans un texte-manifeste intitulé « La conjuration sacrée », prouvant ainsi que lui et ses amis sont hantés par le sacré. Nous laisserons de côté la société secrète Acéphale, réunissant au départ une douzaine de membres tourmentés par ce qu’il y a de rituel, d’extatique et de sacrificiel dans le sacré, pour nous intéresser au Collège de Sociologie, une bien curieuse institution fondée dans le sillage de la revue Acéphale.
Voici l’objet de recherche du Collège de Sociologie tel qu’il a été défini par ses fondateurs en mars 1937 : « L’objet précis de l’activité envisagée peut recevoir le nom de sociologie sacrée, en tant qu’il implique l’étude de l’existence sociale dans toutes celles de ses manifestations où se fait jour la présence active du sacré. » Le mot sacré est martelé, mais nous allons voir, essentiellement dans son rapport à la modernité. En effet, Georges Bataille et Roger Caillois, les deux animateurs du Collège, ont conscience que si la sociologie, en particulier celle de Durkheim et de Marcel Mauss, a ouvert la voie avec l’étude du sacré des sociétés dites primitives, il reste à affronter et étudier le sacré dans ses manifestations modernes et dans son actualité brûlante, sans oublier qu’il faudra aussi s’interroger sur ce qui fait lien, et lien sacré, au sein même du Collège de Sociologie.
De novembre 1937 à juin 1939 divers conférenciers se succèderont, dans une salle de la rue Gay-Lussac, devant un public ayant acquitté un droit d’inscription[3]. Commençons par Roger Caillois, qui va bientôt publier son ouvrage L’Homme et le sacré. Le 15 novembre 1938, sous le titre « L’ambiguïté du sacré », il évoque, à travers une multitude d’exemples ethnographiques ou religieux, la double polarité du sacré, le côté pur et le côté impur, le noble et l’ignoble, la droite et la gauche, ce qui provoque le respect, l’amour, la reconnaissance et ce qui déclenche le dégoût, l’horreur, l’effroi. Mais l’originalité de Caillois réside ailleurs. Quand il analyse le temps sacré de la fête, comme Chaos retrouvé et façonné à nouveau. Quand il aborde la « sociologie du bourreau », en conjonction avec l’annonce de la mort d’Anatole Deibler, « exécuteur des hautes œuvres ». Ou bien quand mettant en parallèle les confréries, les ordres, les sociétés secrètes et les églises, il plaide en fait pour sa paroisse, se demandant si le Collège de Sociologie ne serait pas plutôt à ranger dans les ordres plutôt que dans les sociétés secrètes. Quoi qu’il en soit, selon Roger Caillois, les individus d’une « communauté élective » ont nécessairement recours au sacré.
Voyons ensuite rapidement l’apport de Georges Bataille, qui mène une double vie, avec la société secrète Acéphale et le Collège de sociologie. Si Bataille traite sans surprise de la « Commémoration du mardi gras », en revanche, il n’hésite pas à dire, dans « L’apprenti sorcier », que l’art, la science et la politique révèlent trois infirmités ou trois vies dissociées et non une existence dans son intégrité. Dès lors, pour approcher ce sentiment du tout, il en appelle, outre le monde vrai des amants, à la chance et au hasard. Il reconnaît ainsi jouer à l’apprenti sorcier en s’engageant sur le sentier du mythe et du sacré.
L’exposé par Michel Leiris, le 8 janvier 1938, sur « Le sacré dans la vie quotidienne » indique d’emblée que le sacré n’a pas déserté les sociétés modernes. Cependant, le sacré détaillé par Leiris se veut subjectif et a sa source dans l’enfance. Le chapeau haut de forme, le revolver et le porte-or de son père, dignes représentants de la puissance et de l’autorité paternelles, se sont nettement imposés à sa sensibilité comme des objets sacrés. De même, à l’instar de tout espace sacré, la maison était bien polarisée, avec la chambre des parents, la pendule et les portraits des grands-parents comme pôle droit, et les W.C. comme pôle gauche. Mais le plus étonnant est que Leiris ait étendu le sacré à des faits de langage qui l’avaient ébranlé étant enfant et qui ont marqué son imaginaire. Par exemple, le nom de Rebecca. Ou le cri de guerre « Baoukta ! ». Ou encore ces deux prononciations enfantines rectifiées : « …Reusement ! » corrigé en « heureusement », « Moisse » corrigé en « Moïse ».
Mais arrêtons-là ce survol du Collège de Sociologie afin de nous demander pourquoi des esprits sensibles à la modernité ont voulu instituer une sociologie du sacré, voire une sociologie sacrée. Nous esquisserons deux réponses, l’une historique, l’autre anthropologique : s’il y a un objet d’étude concernant le sacré propre à la modernité dans les années 1937-1939 c’est bien la montée des totalitarismes et l’imminence d’une guerre généralisée en Europe. L’autre raison de scruter le sacré dans la modernité vient de la modernité elle-même, qui en principe ne laisse aucune chance au sacré.
La sacralisation de l’art moderne
Dans la période de l’entre-deux-guerres, le groupe surréaliste a donc essayé de trouver le sacré propre à la modernité et le Collège de Sociologie a tenté de l’étudier. Mais aujourd’hui, où le sacré va-t-il se nicher ? Quelle est l’expérience moderne du sacré par excellence ? Pour reprendre nos propos de départ, nous dirons que l’art moderne a été sacralisé ou, si l’on préfère, que le sacré moderne a élu domicile dans l’art.
On pourrait certes nous opposer que l’égalité entre les hommes a été, elle aussi, sacralisée. À quoi nous répondrons que ce qui est sacralisé dans l’égalitarisme c’est un principe et non des personnes ou des objets.
Remarquons plutôt ce fait significatif : on observe de nos jours un rejet de l’action politique et une condescendance vis-à-vis de la recherche scientifique, un sentiment d’ailleurs comparable à celui de Bataille dans « L’apprenti sorcier » ; or ce dédain généralisé qui touche de nombreux domaines se fait beaucoup plus discret dès qu’il est question de l’art ou des artistes. Dès lors, il faut bien s’interroger : pourquoi la modernité la plus récente, contrairement à celle du XIXe siècle ou de l’entre-deux-guerres, met-elle l’art et les artistes au-dessus de tout ?
On songe d’abord à l’impact de certains énoncés, comme « la beauté artistique surpasse la beauté naturelle » ou « la nature imite l’art et non l’art la nature ». Mais ces énoncés, qui ont été le fait de philosophes ou d’esthètes, n’ont guère pu galvaniser les foules. On songe ensuite au triomphe universel de la photographie, du cinéma et de la musique enregistrée. Mais ce triomphe, qui a accompagné l’éclatement des beaux-arts, a vu aussi se manifester des courants résolument anti-art. Être dada par exemple, c’était être à la fois artiste et anti-artiste. Une définition sur laquelle il faudra revenir. On songe enfin qu’avec les banques de données et la circulation des images le patrimoine culturel et artistique de l’humanité semble à la portée de chacun. Cela voudrait-il dire que la quantité et la diversité, voire la pléthore, jouent en faveur de la sacralisation de l’art ? Est-ce l’ampleur de l’offre en matière d’art qui pousse à sa sacralisation ? On ne peut écarter cette hypothèse, mais dans ces conditions toute la sphère de la marchandise dont l’offre est mirifique devrait être aussi sacralisée. Poussons encore le paradoxe : la multiplication des signes et des objets profanes sur la scène de la contemplation et le marché de la consommation, cette multiplication monstrueuse ou quasi miraculeuse des messages, des images et des objets devrait sécréter sa propre sacralité.
L’actuelle modernité, qui n’est plus celle de Breton, ni de Bataille, ni de Le Corbusier, ayant coupé avec la course en avant dans les champs politique, scientifique et même technique, ayant donc marqué une pause dans ces domaines qui régentent la vie quotidienne, semble s’être rabattue sur l’art ou même la culture conçus comme une mine inépuisable d’énergies, de ressources et de talents. L’art et la culture pouvant se déployer à loisir dans les larges plages du temps libre comme dans ses interstices.
Cette religion moderne de l’art, dont les cars de touristes et les flots de visiteurs des monuments et musées sont les ambassadeurs ou les pèlerins, pose la triple question de la conversion du grand nombre à l’art, de la sacralisation des œuvres et de la fonction des artistes. Nous ferons l’hypothèse pour aborder ce problème que la conversion du grand nombre à la religion de l’art précède la sacralisation des œuvres, sacralisation devenue elle-même la condition du travail et de la fonction des artistes. Cette religion moderne de l’art, qui est aussi une religion de l’art moderne, ne serait donc pas suscitée par l’aristocratie des artistes mais par la foi démocratique du public universel. C’est comme si l’idée défendue par Kant dans sa Critique de la faculté de juger de l’existence d’un sensus communis, d’un sens commun esthétique, venait à se réaliser en la personne d’un public universel ravi d’exercer en commun son appétence esthétique, ou plus crûment encore décidé à contempler sans entraves tous les films, installations et autres spectacles où s’exposeraient et se déchaîneraient la beauté la plus convulsive et les frissons de l’horreur. En admettant comme nous le pensons, que le public universel commande, il va de soi que les produits désirés et commandés ne peuvent être assimilés à des objets de pacotille mais à des œuvres de la plus haute spiritualité, ce qui nous ramène sur la terre du sacré.
Les artistes qui sont peut-être les gagnants dans cette opération, sont surtout rappelés à leur devoir d’honorer la demande et à leur fonction de satisfaire la commande. Les artistes d’aujourd’hui, chanteurs ou concepteurs, stars ou vedettes, ne sont plus en mesure d’imposer leur caprice ou leur liberté de création. Ce ne sont plus des démiurges. Ils retrouvent à cet égard la position séculaire et modeste des architectes surveillés de près par leur commanditaire. Qu’ils veuillent la gloire ou la sainteté, il leur suffira de s’exécuter.
La modernité sacralisant l’art en 2005, cela ressemblerait assez à une manifestation dada retracée dans une fresque symboliste. Sur scène, le grand public universel. Dans la salle, des candidats artistes prenant des notes comme des journalistes. Les arts sacralisés par des non-artistes à l’usage de candidats artistes, tel est le tour de force conçu et réalisé par la modernité la plus récente.
La Chapelle de Notre-Dame du Haut construite par l’architecte moderne Le Corbusier peut donc être regardée à la lumière du sacré que la modernité a absorbée, réfléchie ou diffusée, depuis son édification en 1955 jusqu’à aujourd’hui.
Georges Sebbag
Notes
[1] Jules Monnerot, La Poésie moderne et le sacré, Gallimard, 1945, p. 157.
[2] Ibid., p. 72.
[3] Voir l’excellente anthologie de Denis Hollier, Le Collège de Sociologie, 1937-1939, Gallimard, 1995.
Références
« La modernité et le sacré », in Ronchamp l’exigence d’une rencontre, Le Corbusier et la Chapelle Notre-Dame du Haut, Fage éditions, Paris 2007.