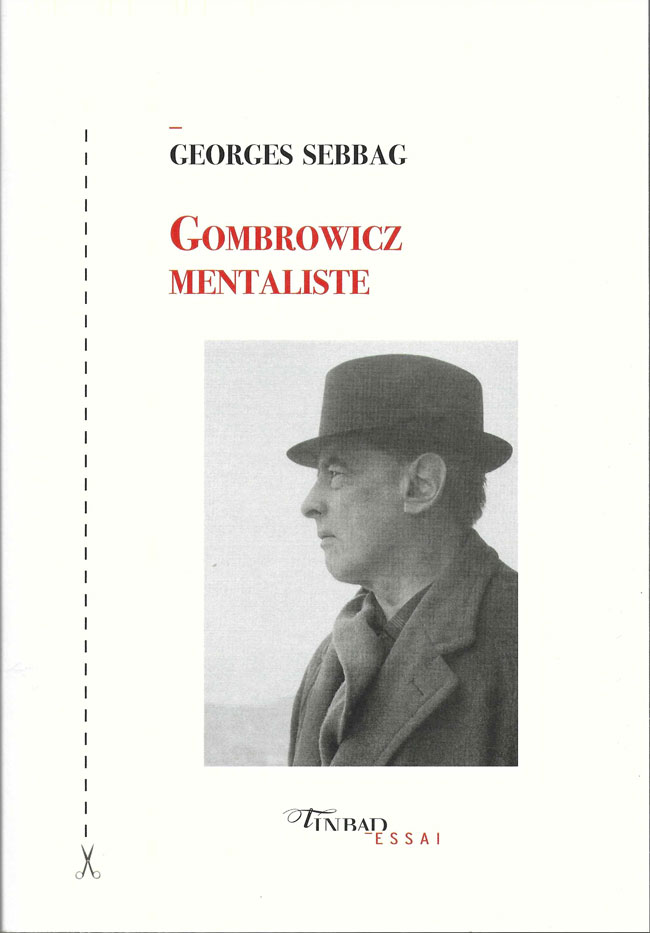
Gombrowicz et moi (1964-2021)
Étudiant en philosophie à la Sorbonne, j’ai publié en mai 1964, dans le n° 3 de la revue Aletheia, mon tout premier article intitulé « Raymond Roussel ou les impressions d’une double-vue ». J’y analysais l’œuvre de Roussel à travers les notions de « doublure » et de « cinéma intérieur ». En mars 1966, dans la revue Critique fondée par Georges Bataille, paraissait « Gombrowicz ou la mise en relation », où je recensais les ouvrages de Gombrowicz traduits alors en français : Ferdydurke, La Pornographie, Journal 1953-1956, Yvonne, princesse de Bourgogne et Le Mariage. Je m’aperçois aujourd’hui que j’aurais pu intervertir les titres des deux articles. Cela aurait donné « Raymond Roussel ou la mise en relation » (le Procédé, à un métagramme près, met bien en relation deux phrases homophones) et « Gombrowicz ou les impressions d’une double-vue » (Witold, mentaliste doué de voyance, manie par ailleurs la longue-vue).
Gombrowicz a séjourné au Centre Culturel de Royaumont du 28 mai au 3 septembre 1964. J’entamais alors la lecture de Ferdydurke. Aux Éditions de Minuit qui accueillaient la revue Aletheia, des rumeurs circulaient sur les joutes oratoires à l’abbaye de Royaumont entre Gombrowicz et le psychosociologue Georges Lapassade, auteur de L’Entrée dans la vie, essai sur l’inachèvement de l’homme. J’ai manqué de rencontrer l’écrivain polonais. En effet, je me suis rendu à Royaumont pour assister, du 4 au 8 juillet, au colloque « Nietzsche » animé par Gilles Deleuze, avec la participation notamment de Karl Löwith, Jean Wahl, Gabriel Marcel, Michel Foucault et Pierre Klossowski. J’espérais, mais en vain, croiser Gombrowicz, qui n’a pas dû quitter sa chambre. Le 8 juillet, comme par compensation, Gilles Deleuze, avec qui j’ai pu ainsi faire connaissance, m’a ramené en voiture à Paris.
En août 1967, comme nous passions, Monique (ma future épouse) et moi, nos vacances à Nice, nous avons pu faire un saut à Vence un après-midi, sachant que Gombrowicz y résidait. Comme nous n’avions aucune idée de son adresse, nous sommes entrés dans une galerie d’art du centre-ville (la galerie Alphonse Chave ?) et avons demandé si le nom de Gombrowicz ne figurait pas sur leurs listes d’invités. À l’issue d’une recherche rapide, on nous répondit par l’affirmative. Il habitait juste là, 36, place du Grand-Jardin. Nous allâmes frapper à sa porte, au deuxième étage. À la femme qui nous ouvrit, peut-être Maria Paczowska, je déclarai que je désirais interviewer Gombrowicz pour la revue surréaliste L’Archibras. Après qu’elle l’eut consulté, elle nous dit de revenir dans une heure. À notre retour, Gombrowicz nous accueillit aimablement ; nous nous installâmes dans une pièce lumineuse autour d’une table, notre hôte face à nous. J’avais préparé quelques questions. Je crois que je ne mesurais pas alors la brutalité de la première d’entre elles : « La mort, comment l’envisager ? » Gombrowicz, fort calme, me répondit dans un bon français, assez lentement pour que je pusse prendre des notes. Nous sommes restés une heure environ. Je lui ai parlé du groupe surréaliste auquel j’appartenais et lui ai annoncé que Monique et moi allions enseigner la philosophie dans un lycée, à la rentrée prochaine.

Je lui ai envoyé par la suite une copie de l’entretien sur lequel il n’a porté que d’infimes corrections. Il en a profité pour joindre à son envoi deux photographies prises par Bohdan Paczowski en Italie et à Vence. En mars 1968, sous la rubrique « Voix off », L’Archibras publie deux entretiens, l’un avec Claude Lévi-Strauss, l’autre avec Witold Gombrowicz. Mon interview de Gombrowicz est suivi et étayé par mon article « La raison errante », une recension fouillée de Cosmos, son dernier roman. Une photo illustre l’article. En juin 1965, à Chiavari, près de Gênes, Paczowski a pris en plongée et en diagonale Rita, Maria (son épouse) et Witold sur la terrasse d’une maison de location ; Rita en tee-shirt à larges rayures, les bras nus, dans un fauteuil ; Maria, dans un ensemble d’été à larges rayures, étendue sur une chaise longue ; Witold tout en blanc, les mains jointes, assis dans un fauteuil.
La deuxième photo, qui n’a pas été publiée, est troublante. On dirait une mise en scène saisie par l’objectif de Bohdan Paczowski. Dans une chambre de l’appartement de Vence, sur fond de porte-fenêtre donnant sur un balcon, au premier plan, dans la pénombre, deux personnes se font face à faible distance ; Witold paraît raide sur une chaise, avec des mains qui pendent entre ses jambes écartées ; Rita se tient droite aussi, bien calée dans un fauteuil et les pieds joints ; dans ce clair-obscur on devine tout juste l’identité des protagonistes, qui sont vus de profil ; on croit assister à une cérémonie hiératique où s’effectue un étrange transfert de pensées et de désirs.

En 1970, comme l’idée de réaliser un film me tarabustait, je pensai à une adaptation de Ferdydurke, d’autant plus que je venais de rencontrer Dominique Lambert qui allait tenir la caméra 16 mm et avec qui je me mis à travailler au scénario. J’ai associé au projet mes amis surréalistes et l’éditeur Éric Losfeld. De façon impromptue, Monique et moi, dans un centre commercial de Créteil, abordâmes une jeune fille qui a accepté de tenir le rôle de la lycéenne moderne. Deux séquences furent tournées. Celle où Jojo, entraîné par Pimko (interprété par le surréaliste tchèque Petr Kral) dans la maison de la famille Lejeune, rencontre Zuta, la lycéenne moderne. Celle où, alors que la mère et le père Lejeune, leur fille Zuta et Jojo déjeunent et échangent des propos, Jojo ingurgite une invraisemblable compote. Mais lors de notre troisième séquence, un malheureux branchement endommagea gravement le Nagra, l’appareil enregistreur de son. Le tournage de Ferdydurke stoppa net. En 1979, dans ses mémoires Endetté comme une mule ou la passion d’éditer, Éric Losfeld restitue l’ambiance de cette aventure : « Je suis intimement persuadé que j’aurais fait une grande carrière cinématographique, si Ferdydurke, d’après le roman de Gombrowicz, s’était terminé. Le film était réalisé par Georges Sebbag. Je tenais le rôle du père, ma femme était jouée par Mimi Parent, et l’affreux jojo était interprété par Alain Joubert. […] Revenons, voulez-vous, au tournage de Ferdydurke. Nous devions tourner une scène de repas, repas frugal puisque nous en étions au potage. Pour simuler le brouet, l’accessoiriste, ce sadique, avait imaginé de remplir les assiettes avec du vin et quelques morceaux de pain. Sebbag (Jojo [diminutif de mon prénom Georges] pour les acteurs), scrupuleux, fit une bonne dizaine de prises de vues ; dix assiettes de picrate bues à la cuillère, c’est atroce. Je ne le souhaite qu’à Jean Dutourd et Michel Droit, et cinq assiettes à René Barjavel. »
En janvier 1990, la Revue des Deux Mondes publie « Gombrowicz finaliste » avec la présentation suivante : « Vingt ans après la mort de Witold Gombrowicz, Georges Sebbag risque une synthèse de son œuvre. L’écrivain trans-Atlantique navigue entre deux mondes, entre la vieille Pologne et le jeune Argentine. Mais il est toujours rattrapé par le spectre visible de la forme. » Il faut dire que dans cet article j’ose deux ou trois hypothèses, dont celle-ci : aux trois Critiques de Kant, Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique et Critique de la faculté de juger, répondent trois romans de Gombrowicz, Ferdydurke, La Pornographie et Cosmos. J’y avance aussi le concept de narracteur.
C’est l’époque où je réfléchis sur le grand nombre et déclare sans ambages à l’instar de Claude Lévi-Strauss et Witold Gombrowicz que je préfère une humanité décroissante à une humanité prolifique.
J’ai écrit plusieurs essais sur la temporalité et le bouleversement des âges dans nos sociétés : Le Masochisme quotidien (1972), Le Temps sans fil (1984), La Morsure du présent (1994), Le Gâtisme volontaire (2000), Le Génie du troupeau (2003). La plupart de ces métamorphoses ou de ces renversements temporels sont à mettre en relation avec le modèle gombrowiczien des Verts et des Adultes.
Depuis le printemps 2007 où mon texte « Gombrowicz, un moi irréductible » a paru dans un hors-série de La Presse littéraire, j’ai lu et relu l’écrivain polono-argentin. Et c’est dans Les Envoûtés que j’ai découvert un Gombrowicz à la puissance n, un Witold forgé dans le plus pur métal mentaliste.
Georges Sebbag
Références
« Gombrowicz et moi (1964-2021) », chapitre II, Gombrowicz mentaliste, éd. Tinbad, 2021.



