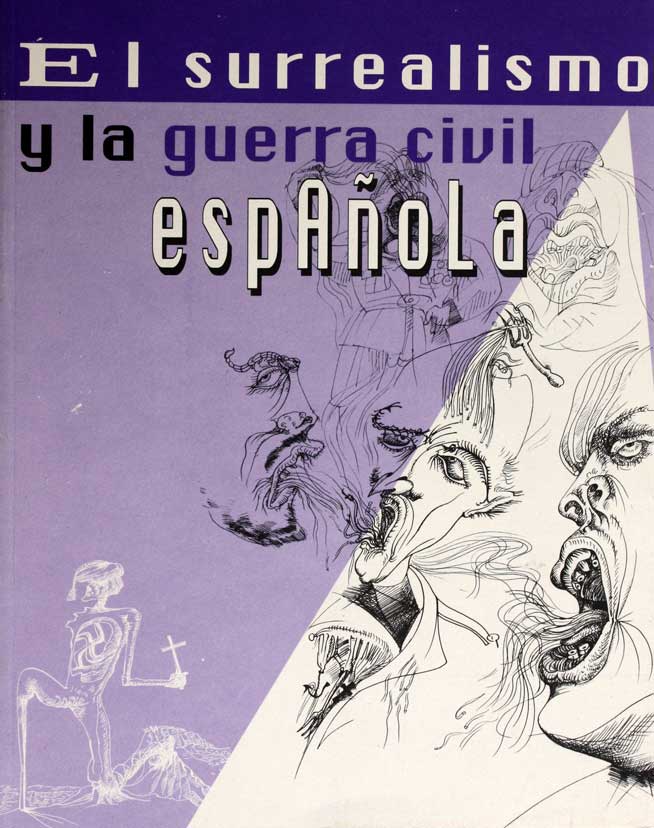 L’histoire de l’humanité présente et passée n’est pas une faribole. Même s’il n’en subsiste qu’un vaste champ de ruines, on reconnaît çà et là de solides blocs de réalité. Pourtant entre ces blocs les failles paraissent si profondes qu’on se perd en conjectures sur le sens des événements, le relevé des apparences ou la pertinence des énoncés. On n’a souvent d’autre solution que d’interroger les faits, de se poser des questions saugrenues, d’avancer sur le terrain miné de l’interprétation, bref de théoriser. C’est pourquoi nous nous demanderons comment Breton et ses amis surréalistes, Bataille et ses proches de la revue Acéphale, ont vécu la guerre d’Espagne, ou plutôt comment la guerre d’Espagne a traversé leur vie, leur vie réelle ou imaginaire. Nous ne redirons pas, après divers historiens et biographes, pour qui ils ont publiquement pris parti, ni comment ils ont compati à la tragédie ou se sont engagés dans le combat, car sur ce plan, les individus, qu’ils le veuillent ou non, sont emportés par un courant massif ou minoritaire de sentiments et d’opinions. Nous tenterons plutôt une confrontation entre trois durées, la durée historique de la guerre d’Espagne, la durée surréaliste, caractérisée selon nous par son automaticité, et la durée propre aux trois cercles batailliens de la revue Acéphale, du Collège de Sociologie et de la société secrète Acéphale. Comme nous postulons que ces durées de nature différente peuvent être mises sur un pied d’égalité, nous nous autoriserons à passer de l’une à l’autre, et donc à les comparer.
L’histoire de l’humanité présente et passée n’est pas une faribole. Même s’il n’en subsiste qu’un vaste champ de ruines, on reconnaît çà et là de solides blocs de réalité. Pourtant entre ces blocs les failles paraissent si profondes qu’on se perd en conjectures sur le sens des événements, le relevé des apparences ou la pertinence des énoncés. On n’a souvent d’autre solution que d’interroger les faits, de se poser des questions saugrenues, d’avancer sur le terrain miné de l’interprétation, bref de théoriser. C’est pourquoi nous nous demanderons comment Breton et ses amis surréalistes, Bataille et ses proches de la revue Acéphale, ont vécu la guerre d’Espagne, ou plutôt comment la guerre d’Espagne a traversé leur vie, leur vie réelle ou imaginaire. Nous ne redirons pas, après divers historiens et biographes, pour qui ils ont publiquement pris parti, ni comment ils ont compati à la tragédie ou se sont engagés dans le combat, car sur ce plan, les individus, qu’ils le veuillent ou non, sont emportés par un courant massif ou minoritaire de sentiments et d’opinions. Nous tenterons plutôt une confrontation entre trois durées, la durée historique de la guerre d’Espagne, la durée surréaliste, caractérisée selon nous par son automaticité, et la durée propre aux trois cercles batailliens de la revue Acéphale, du Collège de Sociologie et de la société secrète Acéphale. Comme nous postulons que ces durées de nature différente peuvent être mises sur un pied d’égalité, nous nous autoriserons à passer de l’une à l’autre, et donc à les comparer.
 Le lancement du mouvement surréaliste coïncide avec la fondation en décembre 1924 de La Révolution surréaliste. Tandis que sur la couverture du premier numéro les surréalistes rejouent la Révolution de 1789 à travers un photomontage des travaux de leur assemblée constituante ainsi légendé : « Il faut aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l’homme », ils affichent à l’intérieur de la revue leur goût pour la subversion, en publiant leurs rêves, en ouvrant une enquête sur le suicide et en célébrant l’anarchiste Germaine Berton dont le portrait est encadré de vingt-huit photos de surréalistes, y compris celles de Freud et de Picasso. De plus, dans le même numéro, au verso de la couverture barré par un mystérieux poisson nommé « Surréalisme », le public est invité à se rendre au Bureau central de recherches surréalistes : « Nous sommes à la veille d’une RÉVOLUTION. Vous pouvez y prendre part. » Se prépare alors une révolution spirituelle et non sociale. D’un côté, désespérés, les surréalistes se posent la question lancinante : « Le suicide est-il une solution ? » D’un autre côté, étant prêts à se jeter à l’eau, ils sont persuadés d’être à la veille d’une révolution. C’est le moment où André Breton, agitant le spectre du « Poisson soluble », confie aux lecteurs du Manifeste du surréalisme : « […] n’est-ce pas moi le poisson soluble, je suis né sous le signe des Poissons et l’homme est soluble dans sa pensée ! » Une des gloses de Michel Leiris publiées dans La Révolution surréaliste d’avril 1925 parvient même à concilier le rêve et la révolution : « Révolution – solution de tout rêve. »
Le lancement du mouvement surréaliste coïncide avec la fondation en décembre 1924 de La Révolution surréaliste. Tandis que sur la couverture du premier numéro les surréalistes rejouent la Révolution de 1789 à travers un photomontage des travaux de leur assemblée constituante ainsi légendé : « Il faut aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l’homme », ils affichent à l’intérieur de la revue leur goût pour la subversion, en publiant leurs rêves, en ouvrant une enquête sur le suicide et en célébrant l’anarchiste Germaine Berton dont le portrait est encadré de vingt-huit photos de surréalistes, y compris celles de Freud et de Picasso. De plus, dans le même numéro, au verso de la couverture barré par un mystérieux poisson nommé « Surréalisme », le public est invité à se rendre au Bureau central de recherches surréalistes : « Nous sommes à la veille d’une RÉVOLUTION. Vous pouvez y prendre part. » Se prépare alors une révolution spirituelle et non sociale. D’un côté, désespérés, les surréalistes se posent la question lancinante : « Le suicide est-il une solution ? » D’un autre côté, étant prêts à se jeter à l’eau, ils sont persuadés d’être à la veille d’une révolution. C’est le moment où André Breton, agitant le spectre du « Poisson soluble », confie aux lecteurs du Manifeste du surréalisme : « […] n’est-ce pas moi le poisson soluble, je suis né sous le signe des Poissons et l’homme est soluble dans sa pensée ! » Une des gloses de Michel Leiris publiées dans La Révolution surréaliste d’avril 1925 parvient même à concilier le rêve et la révolution : « Révolution – solution de tout rêve. »
D’octobre 1924 à avril 1925, durant la période d’activité publique puis privée du Bureau de recherches, le surréalisme, qui célèbre le rêve, convertit l’Occident en Orient, exalte le génie de chaque participant, brandit le pavillon noir de la révolte, crache sur le monde « livré à la desséchante raison », proclame la fin de l’ère chrétienne, ajoute foi à la Folie, ausculte et retourne les viscères de l’esprit, emprunte le chemin menant à l’illumination mystique ou rimbaldienne, le surréalisme donc, pris « d’une ardeur insurrectionnelle », accomplit en effet une révolution de l’esprit. Le titre de la revue, La Révolution surréaliste, n’est pas usurpé. Ou, comme le dit Artaud dans sa langue douloureuse et magnifique, le surréaliste qui « désespère de s’atteindre l’esprit », « est la seule Tête qui émerge dans le présent »1 .
Mais dès l’été, et surtout à l’automne de 1925, l’autre Révolution, sociale et politique, dogmatique et organisée, vient interférer avec la révolte anarchiste et l’illumination mystique. C’est qu’une vaste tentative de regroupement s’opère entre les membres des revues La Révolution surréaliste, Clarté, d’obédience marxiste, Philosophies, et ceux de la revue-tract bruxelloise Correspondance. Mais bientôt le groupement ne réunit plus que des surréalistes et des clartéistes. Les surréalistes font l’apprentissage de la discipline et de la clandestinité, du militantisme politique et de l’organisation bureaucratique. Cependant des réticences surgissent et la lassitude gagne. Fin novembre 1925, les travaux du comité directorial et des commissions sont suspendus. Les clartéistes pressent alors leurs camarades poètes, car ils entendent aboutir, sinon à la fusion des deux groupes, du moins à la création en commun d’une revue. C’est pourquoi, sur la couverture de Clarté de décembre 1925 – janvier 1926, est annoncé le sabordage de la revue : « Clarté disparaît La Guerre Civile lui succède ». Dans son long éditorial, Marcel Fourrier, qui retrace avec minutie l’historique de Clarté, en dit assez peu sur La Guerre Civile. Il voit dans la jonction des surréalistes et des rédacteurs de Clarté un « courant où se joignent pour la première fois des esprits venus à la révolution par les voies les plus diverses ». Après avoir remarqué que « la révolution s’est éloignée pour un long temps de le terre européenne », il assigne à la future revue au titre si provocant un objectif purement idéologique : « l’anéantissement […] de l’esprit bourgeois ». Ajoutons que dans le même numéro, les rédacteurs de Clarté, n’entendant pas passer pour des anarchistes, ont tenu à placarder à deux reprises l’annonce suivante : « LA GUERRE CIVILE au service de la révolution ». Sans doute voulaient-ils atténuer la violence du titre et donner des gages au parti communiste.
Pour sa part, La Révolution surréaliste du 1er mars 1926 associe dans un même placard la parution de La Guerre Civile, prévue pour avril, et l’ouverture, le 10 mars, de la Galerie Surréaliste au 16, rue Jacques-Callot, autrement dit dans les anciens locaux de la revue Clarté. Si, effectivement, mais seulement le 26 mars, la Galerie Surréaliste est inaugurée avec une exposition mêlant des objets océaniens et des tableaux de Man Ray, en revanche La Guerre Civile, dont le premier numéro a été pourtant préparé, ne verra jamais le jour. L’alliance de Clarté et de La Révolution surréaliste aura tourné court. Au moment exact où les surréalistes renoncent à leur alliance, naissent simultanément deux institutions surréalistes : la Galerie Surréaliste et les Éditions Surréalistes. Loin de composer avec les marxistes de Clarté, les surréalistes ont « hérité » du local de la rue Jacques-Callot et renforcé leur autonomie, leur identité, en exposant et en publiant sous leur propre label. En somme, avec l’ouverture de la Galerie Surréaliste et la non-parution de La Guerre Civile, l’invention poétique a surclassé le militantisme révolutionnaire.
De juillet 1936 à mai 1937, l’histoire de l’Espagne, ou tout au moins de la Catalogne, est placée sous le signe d’un balancement tragique, d’une hésitation fatale : Révolution ou Guerre civile ? Mais les mots sont terriblement trompeurs. Si révolution il y a, durant l’été et l’automne de 1936, la légalité est dans le camp de la révolution, le camp républicain. De plus, cette révolution égalitaire et anticléricale, de style libertaire, est assez peu comparable à la Révolution bourgeoise et politique de 1789 ou à la prise de pouvoir bolchevique de 1917. Et si guerre civile il y a, c’est moins un peuple qui est déchiré, qu’un État qui se désunit, qu’une société qui est en conflit ouvert avec ses deux institutions maîtresses, l’Armée et l’Église. Il faut noter qu’en France, pour qui se fie, comme c’est le cas du mouvement surréaliste en 1925, d’une part à la tradition violente des attentats anarchistes ou même de l’action syndicale, tradition remontant à la fin du XIXe siècle, d’autre part à la mémoire de la Commune de Paris de 1871, les notions de Guerre civile et de Révolution se mêlent inextricablement. Il faut ajouter que nos desesperados surréalistes ont parfois vécu dans leur chair la Grande Guerre 14-18 et ont fourbi leurs premières armes poétiques et théoriques en se frottant hardiment au public lors de la grande saison Dada.
Durant l’entre-deux-guerres, les surréalistes, comme la plupart des écrivains et des artistes, sont plutôt pacifistes. Ils s’opposent à la guerre, par exemple à la guerre coloniale du Rif, mais ils s’y opposent violemment. Comme Hegel ou Sorel, ils croient à la violence dans l’histoire. La guerre peut aussi accoucher d’une révolution. Cependant, pour le dire nettement, l’expérience du mouvement surréaliste est celle d’un échec cuisant. L’échec d’une jonction de la poésie et de la révolution. Non seulement les surréalistes n’ont pas participé, à l’exception de Mai 1968, à une révolte spontanée et généralisée, et en ce sens, comme l’a écrit André Thirion, ils ont été des révolutionnaires sans Révolution, mais quand ils sont entrés dans la voie étroite du marxisme et du soutien au pays de la Révolution, ils n’ont consenti à devenir ni les alliés des clartéistes ni les compagnons de route des communistes. Ils ont voulu préserver leur identité, leur domaine de recherches, leur autonomie. Durant une dizaine d’années, de la fin de 1926 à août 1935, les relations avec le parti communiste seront parfois cordiales, mais le plus souvent tendues. En adoptant en juillet 1930 comme titre de revue Le Surréalisme au service de la Révolution, André Breton et ses proches semblent vouloir se plier aux exigences de la révolution communiste. En réalité, ils ne se métamorphosent guère en militants politiques et ne se soumettent ni aux communistes français ni à l’Internationale communiste. Et en août 1935, la brochure Du temps que les surréalistes avaient raison signe une rupture définitive avec le communisme stalinien. C’est que la révolution surréaliste, poétique, imaginative et hasardée, le disputera toujours à l’autre révolution, sociale, politique et introuvable. Les surréalistes ont agité les esprits et changé les mœurs sans attendre le feu vert des révolutionnaires professionnels. Ils ont même fini par se heurter aux dogmes et aux pratiques criminelles des divers tenants de la Révolution. Ils ont déjoué le mythe selon lequel la révolution sociale serait un préalable à toute transformation individuelle et ils ne se sont pas laissé intimider par les organisateurs de révolution, simples aspirants à un transfert de pouvoir.
Quand, dans les premiers mois de la guerre d’Espagne, le courant égalitaire et libertaire semble triompher c’est comme si tout un décor surréaliste était planté sur une partie importante du pays, ou mieux encore, c’est comme si l’esprit de la plupart des Espagnols mais aussi l’apparence des villes et même des sierras changeaient brutalement de nature et se révélaient surréalistes, et cela pourtant dans une atmosphère lourde de guerre. Nous ne voulons pas dire que le thème surréaliste se réalise grandeur nature, à une très vaste échelle, mais qu’une durée historique comme celle de la guerre d’Espagne peut légitimement être rapprochée d’une autre aventure collective limitée à quelques dizaines de personnes et dont les enjeux sont essentiellement artistiques, éthiques ou humoristiques. En tout état de cause, il semble évident que les deux durées, également placées sous le signe de la Révolution et de la Guerre civile, connaissent des éclats et des vicissitudes analogues : à l’élan imaginatif et libertaire du départ succèdent d’âpres et mortels démêlés avec le parti communiste.
Durant la guerre d’Espagne, le groupe surréaliste animé par Breton est plutôt étriqué. Il ne fait plus sensation, comme à l’époque de La Révolution surréaliste. En revanche, sur le plan international, le surréalisme est étonnamment vivant. Il semble avoir essaimé de par le monde. Une masse de documents couvrant trois pages de Minotaure n° 10 le montre clairement. Outre la France, seize pays, à savoir l’Angleterre, la Belgique, le Danemark, la Grèce, l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, le Japon, le Pérou, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, l’URSS et la Yougoslavie, sont désormais touchés par l’idée surréaliste. En ce qui concerne l’Espagne, nous verrons que les îles Canaries méritent une mention spéciale. Mais, pour l’instant, situons-nous au début d’août 1936. Benjamin Péret vient d’arriver à Barcelone. Il est envoyé par le Parti Ouvrier Internationaliste, groupuscule d’obédience trotskiste. C’est l’enthousiasme immédiat. Le 11 août il écrit à Breton : « Si tu voyais Barcelone telle qu’elle est aujourd’hui, émaillée de barricades, décorée d’églises incendiées dont il ne reste plus que les quatre murs, tu serais comme moi, tu exulterais. […] Des églises incendiées ou privées de leurs cloches, on ne voit que ça en Catalogne, tout le long de l’affreux petit tortillard que j’avais emprunté pour aller de Puigcerda à Barcelone et qui m’a paru une promenade féerique.2 » Rappelons que cinq ans auparavant, les surréalistes, dans un tract incendiaire intitulé « Au Feu ! » exaltaient le déchaînement anticlérical en Espagne et voyaient dans l’incendie des églises le départ d’un embrasement révolutionnaire : « À partir du 10 mai 1931, à Madrid, Cordoue, Séville, Bilbao, Alicante, Malaga, Grenade, Valence, Algésiras, San Roque, la Linea, Cadix, Arcos de la Frontera, Huelva, Badajos, Jeres, Almeria, Murcia, Gijon, Teruel, Santander, La Corogne, Santa-Fé, etc., la foule a incendié les églises, les couvents, les universités religieuses, détruit les statues, les tableaux que ces édifices contenaient, dévasté les bureaux des journaux catholiques, chassé sous les huées les prêtres, les moines, les nonnes qui passent en hâte les frontières. […] Détruire par tous les moyens la religion, effacer jusqu’aux vestiges de ces monuments de ténèbres où se sont prosternés les hommes, anéantir les symboles qu’un prétexte artistique chercherait vainement à sauver de la grande fureur populaire, disperser la prêtraille et la persécuter dans ses refuges derniers, voilà ce que, dans leur compréhension directe des tâches révolutionnaires, ont entrepris d’elles-mêmes les foules de Madrid, Séville, Alicante, etc. Tout ce qui n’est pas la violence quand il s’agit de la religion, de l’épouvantail Dieu, des parasites de la prière, des professeurs de la résignation, est assimilable à la pactisation avec cette innombrable vermine du christianisme, qui doit être exterminée. […] Le front antireligieux est le front essentiel de l’étape actuelle de la Révolution espagnole. » Toutefois, en dépit de son lyrisme, la tonalité générale du tract reste politique et s’inscrit délibérément dans une ligne bolchevique ou léniniste.
Juste avant de manifester leur anticléricalisme, les surréalistes avaient exprimé leur anticolonialisme dans un tract intitulé « Ne visitez pas l’Exposition Coloniale ». Or, au sein de cette immense exposition qui se tenait à Vincennes, un incendie allait ravager, à la fin juin de 1931, le pavillon des Indes Néerlandaises qui abritait des collections d’art primitif provenant de Java, Bali, Bornéo, Sumatra, Nouvelle Guinée, etc. L’indignation des surréalistes fut à son comble. Ils rédigèrent aussitôt le tract « Premier bilan de l’Exposition Coloniale » dans lequel ils dénonçaient d’abord le rapt colonial d’objets inestimables puis leur consumation dans un décor hautement inflammable. Ils interprétaient ce sombre incendie « comme une sorte d’acte manqué de la part du capitalisme ». De plus, contre ceux « qui croiraient relever une contradiction gênante » entre leur soutien aux incendiaires espagnols et leur dénonciation des capitalistes pyromanes, ils déployaient, au nom des sciences marxiste et matérialiste, des trésors de dialectique : « […] si les fétiches de l’Insulinde ont pour nous une indiscutable valeur scientifique et qu’ils ont, de ce fait, perdu tout caractère sacré, par contre les fétiches d’inspiration catholique (tableaux de Valdes Leal, sculptures de Berrughete, troncs de la maison Bouasse-Lebel) ne sauraient être considérés ni du point de vue scientifique, ni du point de vue artistique, tant que la catholicisme aura pour lui les lois, les tribunaux, les prisons, les écoles et l’argent et jusqu’à ce qu’universellement les diverses représentations du Christ fassent modeste figure parmi les tikis et les totems. » D’un côté, ils défendaient à cor et à cri des œuvres dont ils étaient les premiers à reconnaître la haute valeur, d’un autre côté, subjugués par l’espoir révolutionnaire et emportés par leur lutte antireligieuse, ils pensaient pouvoir facilement trancher là-même où se dérobaient les limites de l’art et du sacré, du religieux et du politique.
Toujours dans sa lettre à Breton du 11 août 1936, Benjamin Péret, qui s’est rallié au POUM, en raison de son engagement trotskiste, décrit le rapport des forces politiques en présence : « Les anarchistes sont pratiquement les maîtres de la Catalogne et la seule force qu’ils aient en face d’eux est le POUM. Le rapport entre eux et nous est de 3 à 1 ce qui n’est pas excessif et dans les circonstances actuelles peut facilement changer. Nous avons 15 000 hommes armés et ils en ont 40 à 50 000. Les communistes qui ont fusionné avec trois ou quatre petits partis sont une force négligeable. Dans leur journal, ils ont déclaré vendredi qu’il ne s’agissait pas de la révolution prolétarienne mais de soutenir la république et que quiconque tenterait de faire la révolution les trouverait avec leurs milices en face de lui. Ils annoncent donc leur intention de saboter la révolution, mais je ne crois pas qu’ils en aient le pouvoir. » Le 26 août, depuis Valence cette fois-ci, Benjamin Péret qui s’est déplacé sur le front d’Aragon juge que la révolution, une révolution rampante à vrai dire, occupe bien le terrain : « J’ai vu au cours de ce voyage plus de 60 villages et fait plus de 1 000 kilomètres. Des sortes de soviets sont installées partout mais comme ils n’en portent pas le nom personne ne s’en rend compte et la Généralité de Catalogne a fort à faire pour maintenir les gens dans la cécité. […] Je compte rester dans ce magnifique pays plusieurs mois. » Le 5 septembre, de retour à Barcelone, Péret note un certain avachissement, « un tassement de la révolution ». Le 15 octobre, la même impression prédomine : « Politiquement l’élan révolutionnaire est tombé. Les petits bourgeois de la gauche catalane ont repris un terrain considérable et les partis ouvriers suivent derrière. » D’autre part, Péret confie à Breton : « En plus j’ai ici une histoire d’amour qui me retient jusqu’à ce que la jeune personne puisse m’accompagner à Paris, si bien que je ne peux rien dire sur mon retour. » Le 29 octobre, il dénonce « la politique de bluff, d’intrigues et de lâcheté de l’Internationale communiste. » Le 28 janvier 1937, l’information se veut plus alarmiste : « […] ici ça chauffe dur politiquement. Les staliniens ont maintenant contre eux les anarchistes. […] À mon sens, le choc est très proche. » La lettre du 7 mars, envoyée depuis Pina de Ebro, sur le front d’Aragon, indique une révision politique de Péret qui a décidé de se joindre à une milice anarchiste : le bataillon Nestor Makhno appartenant à la division Durruti. Même si sa nouvelle orientation était purement tactique, le fait est qu’il s’éloigne alors du POUM : « Ils voulaient bien accepter des gens à leur droite, mais pas à leur gauche. » Surtout, Péret juge la révolution au plus bas : « […] sous l’impulsion des staliniens la révolution suit son cours descendant qui s’il n’est pas rapidement enrayé mène tout droit à la contre-révolution violente. » Il laisse imaginer à Breton les manœuvres des communistes : « Je voudrais pouvoir te raconter ici toutes les canailleries des staliniens qui sabotent ouvertement la révolution avec l’appui enthousiaste évidemment des petits bourgeois de toutes nuances. Il y a tant de choses, tant de signes inquiétants au suprême degré et que je ne peux pas dire ici. » Fin avril 1937, Péret quitte l’Espagne pour Paris. Le 20 mai au matin, « dans un demi-sommeil traversé d’images confuses du front d’Aragon », il est réveillé par cette phrase : « L’œuf de Durruti éclora ». Il y voit l’éclosion prochaine d’une Révolution mais aussi d’un amour : « Celle que j’aimais [il s’agit de Remedios Varo] inclinait aux attitudes anarchistes et admirait Durruti. Elle n’était pas avec moi, elle n’était donc pas née à ma vie, mais j’espérais qu’elle s’y déciderait rapidement, qu’elle éclorait.3 »
Il est impossible de ne pas lire en lettres de feu, dans cette correspondance de Péret à Breton d’août 1936 à mars 1937, les mots de Révolution, de Guerre civile et de Contre-révolution. Auxquels ne manqueraient pas de s’ajouter ceux d’Amour et de Déchirement passionnel. Mais posons à présent la question qui nous paraît décisive : pourquoi le durée de la guerre d’Espagne, tellement exemplaire quant à l’improbable sinon à l’impossible jonction de la poésie et de la révolution, n’a-t-elle pas plus brillé dans le firmament surréaliste ? Certes les surréalistes, après avoir tiré un trait sur le stalinisme, ont publiquement dénoncé les procès de Moscou ainsi que les agissements de la contre-révolution à Barcelone. Mais Péret, en dépit de son engagement dans la division Durruti, avait-il pris la mesure de la flambée anarchiste en Espagne ? À la fin des années trente, ne s’est-il pas recroquevillé dans la coquille trotskiste, y entraînant son ami Breton ? Nos deux surréalistes, chez qui vibrait depuis si longtemps la fibre anarchiste, n’ont-ils pas trop considéré le clan trotskiste comme le camp des réprouvés et des persécutés ?
Pourquoi les surréalistes n’ont-ils pas creusé davantage la durée exemplaire de la guerre d’Espagne ? Après tout, Mary Low, née en Angleterre de parents australiens, et Juan Breá, né à Cuba, ces deux étoiles filantes du surréalisme, avaient ouvert la voie en participant activement à la révolution espagnole d’août à décembre 1936 puis en publiant l’année suivante à Londres Red spanish notebook, un témoignage concis et émouvant qui ne sera traduit en français qu’en 1997. Après tout, George Orwell, accompagné de sa femme, prenant pour ainsi dire la relève du couple Breá-Low, n’allait-il pas à son tour délivrer un témoignage capital, Homage to Catalonia, édité à Londres en 1938 ? Mais alors Benjamin Péret ne semble avoir tiré parti ni de sa propre expérience, ni du récit de ses amis Low et Breá, ni de l’ouvrage d’Orwell, pourtant si proche de ses préoccupations, mais qui ne sera traduit en français il est vrai qu’en 1955. En France, hormis les tracts et les déclarations politiques attendus, le groupe surréaliste n’avait-il pas son mot à dire au moment où paraissaient par exemple Ceux de Barcelone de Kaminski, L’Espoir de Malraux ou Les Grands cimetières sous la lune de Bernanos ?
Quelle est l’Espagne, imaginaire ou réelle, connue d’André Breton ? En novembre 1922, le dada-surréaliste Breton qui prononce à l’Ateneo de Barcelone une importante conférence, « Caractères de l’évolution moderne et ce qui en participe », préfère écourter son séjour, sa femme Simone qui l’accompagnait étant tombée malade. Fin août 1932, son séjour à Cadaquès chez Dalí sera abrégé par « les mouches, moustiques et cafards de toute espèce », comme il s’en plaint dans des lettres à Thirion et à Tzara. Mais lorsqu’en mai 1935 André et Jacqueline Breton ainsi que Benjamin Péret voyagent aux Canaries, le tableau n’est plus le même. Se déroule alors un long séjour enchanteur dans l’île de Tenerife, comme en témoigne un des plus beaux textes de Breton, « Le Château étoilé », publié d’abord en espagnol dans Sur d’avril 1936 puis dans Minotaure de juin 1936, avant d’être repris dans L’Amour fou. C’est une autre Espagne, totalement inattendue, que Breton découvre en visitant l’île volcanique de Tenerife et en rencontrant les poètes surréalistes canariens et le directeur de Gaceta de arte, Eduardo Westerdahl. Il a la révélation d’une insularité tournée vers le grand large. Il acquiert sans doute la conviction que le sublime de l’état de nature touche au plus près la beauté la plus moderne. On peut se demander si, après ce voyage inoubliable, la figure vive et familière des Canaries ne supplante pas chez Breton l’image plus brouillée de l’Espagne ou de la Catalogne, associée pourtant à des amis de longue date comme Picasso, Miró, Dalí ou Buñuel. Il va de soi que pendant la guerre d’Espagne Breton et Péret s’enquièrent du sort de leurs amis restés aux Canaries. Dans ses lettres du 15 et du 29 octobre 1936 Péret évoque leur situation et informe en particulier Breton de l’emprisonnement de Pedro García Cabrera. Mais un indice qui ne trompe pas souligne à quel point la pensée de Breton vagabonde du côté des Canaries. En septembre 1941, quand il confectionne à New York Volière, une anthologie de citations de ses propres textes couvrant, année après année, la période 1912-1941, il sélectionne pour l’année 1934, le poème de L’Air de l’eau qui dépeint par anticipation l’île de Tenerife, et pour l’année 1936, l’année de la révolution en Espagne, l’invocation au « Teide admirable », qui se situe à la fin du « Château étoilé ».
On sait que Breton s’explique, à la toute dernière page de L’Amour fou, sur sa non-participation physique à la guerre d’Espagne ; l’existence de sa toute petite fille l’a dissuadé d’aller se battre contre l’« ordre » ancien. Or Breton ne peut s’empêcher alors, en s’adressant à Écusette de Noireuil, de revisiter les rivages des Canaries : « J’aimais en vous tous les petits enfants des miliciens d’Espagne, pareils à ceux que j’avais vus courir nus dans les faubourgs de poivre de Santa Cruz de Tenerife. » On a le sentiment que tout ce qui aurait pu être magnifié par le surréalisme touchant la révolution éphémère en Espagne s’est déplacé ailleurs, vers des amis inaccessibles, dans un paradis désormais perdu, dans les parages du sublime Teide surplombant l’île de Tenerife. À ce compte, on comprend qu’il y ait eu fort peu d’allusions à la guerre d’Espagne dans Minotaure. De plus, s’il y eut un projet de Minotaure relatif à la guerre d’Espagne, il semble, comme l’indique une lettre d’Éluard à Gala du 6 janvier 1937, qu’il ait été envisagé par l’éditeur de la revue et non par les surréalistes : « Minotaure a l’air stagnant. Skira essaie d’avoir de l’argent de la Generalitat pour faire un numéro sur l’Art espagnol. Je ne crois pas que ça marchera. » En tout cas, la numéro en question ne verra pas le jour. Des tiraillements entre Éluard et Breton entretiennent, jusqu’à leur rupture définitive en novembre 1938, une relative neutralisation du champ politique. On l’observe dans Minotaure mais aussi dans le Dictionnaire abrégé du surréalisme qui semble avoir exclu toute définition évoquant de près ou de loin la Révolution. Rappelons que la publication dans L’Humanité du 17 décembre 1936 du poème anti-franquiste « Novembre 1936 » de Paul Éluard a jeté un froid dans le groupe surréaliste, d’autant plus qu’Éluard n’avait pas signé en septembre 1936 le tract condamnant le « Procès de Moscou ». On peut noter que dans cette déclaration collective les surréalistes substituaient au mot d’ordre douteux « Défense de l’URSS » celui de « Défense de l’Espagne révolutionnaire » en précisant bien que les éléments révolutionnaires de la CNT, de la FAI et du POUM étaient en butte aux manœuvres des staliniens.
Dans la dernière livraison de Minotaure de mai 1939 est encarté le texte de Breton « Souvenir du Mexique » abondamment illustré, avec en particulier une photo regroupant Breton, Rivera et Trotski. C’est comme si le voyage au Mexique renouait avec le voyage aux Canaries, avec « Le Château étoilé » publié trois ans auparavant dans Minotaure. C’est comme si la rencontre avec Trotski, d’ailleurs nullement mentionnée dans ce texte, soulignait l’impossibilité pour un André Breton, ou pour un Benjamin Péret, tous deux beaucoup trop proches des thèses trotskistes, de lire à nouveaux frais la signification de la Révolution ou de la Guerre civile en Espagne. Dans l’imaginaire de Breton, la durée irrésolue de la guerre d’Espagne semble à jamais suspendue entre le voyage aux Canaries et le voyage au Mexique. Durée magnétisant aussi d’autres voyages et d’autres durées.
Si Breton semble avoir esquivé la durée de la guerre d’Espagne, appréciable pourtant sous l’angle de l’amour et de la révolution, peut-on en dire de même de Georges Bataille, sans doute plus sensible à l’amour et à la mort ou, en d’autres termes, à la guerre civile ? On peut trouver un début de réponse à cette interrogation en consultant le Journal de Michel Leiris à la date du 19 juillet 1937, soit un an exactement après que tout eut basculé en Espagne : « La guerre d’Espagne qui continue de brûler, qu’on tâche de circonscrire sans qu’on puisse l’étouffer, comme le feu couvant dans la soute à charbon d’un paquebot pendant toute la durée d’une traversée.4 » Le sentiment de Leiris, partagé sans doute par son ami Bataille, est qu’on peut intérioriser et canaliser la guerre d’Espagne mais non l’affronter ouvertement et l’analyser. À vrai dire, pour Leiris, ce foyer d’incendie annonce un embrasement général. À plusieurs reprises, l’imminence de la guerre est notée dans le Journal. Ainsi, dès le 2 janvier 1936 : « 1936 : année cruciale ? année de la guerre ? » Puis en février-mars 1936 : « Peur de la mort. Mettons que la guerre éclate l’année prochaine (je touche du bois et baise trois fois mon bureau pour qu’elle n’éclate pas plutôt) […]. La guerre […] me fournit une base de représentation : je m’imagine mourant à la guerre (par gaz, obus ou de toute autre manière), je m’imagine souffrant et hurlant. » Ou encore le 16 décembre 1936 : « On attend la guerre pour 1937 comme les gens de 999 devaient l’attendre pour l’an 1000. / Toute ma vie aura gravité autour de deux guerres : celle à laquelle j’ai eu la chance d’échapper et celle qu’aujourd’hui j’attends. […] Mort de Lorca : destin sublime d’un sublime poète ; ce que précisément je crains ! […] Aujourd’hui, tout le monde attend la guerre, vit dans cela, s’en accommode ; on va, on vient comme si l’on n’y pensait pas […] En mettant les choses au mieux (peut-être au pis, si je suis mutilé), quelque jour j’écrirai sur une page entière de ce cahier (comme je l’ai fait pour le « Voyage en Afrique ») : GUERRE… — … Cela voudrait dire que je suis revenu et que, malgré tout, la vie continue… » L’obsession de la guerre se poursuit chez Leiris de nuit comme de jour. Coup sur coup, il note le 9 mars 1937 : « Rêvé que la guerre était annoncée comme infaillible pour le mois de novembre. Cassé un flacon de teinture d’iode au lever. » Et il enchaîne le 16 mars en dressant la liste de gens rencontrés l’espace d’une soirée pour y voir une fois de plus une préfiguration de la guerre : « Hier, soirée très “exposition” : pris l’apéritif aux Deux Magots avec Picasso, Shipman, Baron, Sidney Franklin le matador américain, Dora Maar, Pancho Picabia. Aperçu Miró avec sa femme et sa fille, Roux et Pauline, Vitrac, Janine et Raymond [Queneau], etc. Rencontré Fargue. Au dîner rencontré Giacometti qui dînait avec Derain et Balthus. Rencontré Al Brown qui dînait avec Schiaparelli et Cocteau. Aperçu Dos Passos. Allé après dîner chez Desnos. / Signe d’avant guerre ? »
Comme Leiris prépare son futur livre Tauromachies, qui sera illustré par un dessin d’André Masson, il note dans son Journal à la date du 20 mars-3 avril 1937 : « Séjour à Courval (Eure), chez Salacrou. Écrit vingt-six poèmes sur la tauromachie, pour un projet de livre en collaboration avec Masson. » Puis, fait assez exceptionnel, apparaissent dans le cahier, où Leiris consigne son Journal, deux documents collés. Il s’agit, d’une part, d’un placard publicitaire annonçant le spectacle de Jean-Louis Barrault, Numance de Cervantes, au Théâtre Antoine du 22 avril au 6 mai 1937, avec des décors et costumes d’André Masson, d’autre part, d’une brève présentation de Numance signée Robert Desnos : « Ce n’est pas seulement à la croisée des chemins qu’il y a des carrefours. Ces lieux de rendez-vous sont aussi marqués dans le temps. La petite République de Numance, détruite par Scipion Émilien en 133 avant notre ère, reçut en 1584 la visite de Cervantes. Et de cette visite, purement imaginative, jaillit l’un des plus beaux drames du théâtre espagnol et de tout le théâtre humain. / Aujourd’hui encore Numance est un lieu de rendez-vous. On y verra clairement un présage pour les événements actuels, non que je crois que l’histoire un perpétuel recommencement, mais parce que je crois à la persistance de l’esprit de liberté dans un lieu donné. […] » Ce n’est pas seulement par esprit de camaraderie que Leiris évoque Numance. Convergent là plusieurs Espagnes, celles de Cervantes, de la tauromachie, de la peinture de Masson et bien sûr celle de la guerre civile. De plus, la représentation de Numance marquera Leiris. En octobre 1941, il la citera parmi les quatre spectacles l’ayant ému profondément. Mais déjà le 10 avril 1938 il notait dans son Journal : « Rêve : en prévision de la guerre prochaine, une sorte de conseil de révision ou de tirage au sort pré mortuaire est imposé aux mobilisables ; il s’agit de distinguer ceux dont on laissera les cadavres tranquilles et ceux dont les cadavres seront utilisés pour les besoins de la guerre […]. Analogie : le cadavre fouetté de Numance […]. »
Pendant la guerre d’Espagne, outre qu’il est habité par le fantasme d’une mort violente, l’aficionado Michel Leiris est subjugué par Numance. En fait les hantises de Leiris peuvent nous éclairer sur les préoccupations de ses amis Masson et Bataille. Situons-nous en avril 1936 : l’histoire du collectif Contre-Attaque s’achève, l’histoire de la revue Acéphale et de la société secrète Acéphale commence. Nous aurons l’occasion de revenir sur les relations embarrassées de Bataille et de Breton. En avril 1936, Bataille séjourne chez André Masson à Tossa de Mar, pour la seconde fois. Mais son premier séjour en Espagne remonte à 1922. Cette année-là, de février à juin, il vécut à Madrid, envoyé à l’École des hautes études hispaniques, la future Casa Velásquez. En mai, lors d’une corrida, il assista à la mort du jeune torero Granero : « […] Granero renversé par le taureau et coincé contre la balustrade ; sur cette balustrade les cornes frappèrent trois coups à toute volée, au troisième coup une corne défonça l’œil droit et toute la tête. » Ce souvenir ineffaçable s’inscrira en 1928 dans Histoire de l’œil, édition comprenant huit lithographies d’André Masson. Revenons à Acéphale, élaboré pour l’essentiel à Tossa de Mar, le 29 avril 1936. On connaît les traits nets et agressifs de l’homme acéphale dessiné par André Masson : un corps vigoureux et nu, un cou tranché, un bras brandissant un poignard, l’autre main serrant un cœur enflammé ou une grenade, des tripes à découvert recelant un dédale, un crâne à l’emplacement du sexe. On connaît les formules percutantes et incendiaires ponctuant le premier numéro d’Acéphale : « Nous sommes farouchement religieux », « Ce que nous entreprenons est une guerre », « Un incendie extatique détruira les patries », « Quand le cœur humain deviendra feu et fer », « L’homme échappera à sa tête comme le condamné à sa prison ». Relisons la fin du texte-manifeste d’Acéphale, « La conjuration sacrée », où Bataille affronte avec André Masson son destin acéphale et mortel : « J’écris dans une petite maison froide d’un village de pêcheurs, un chien vient d’aboyer dans la nuit. Ma chambre est voisine de la cuisine où André Masson s’agite heureusement et chante […] Lorsqu’il y a quelques jours, j’étais avec Masson dans cette cuisine, assis, un verre de vin dans la main, alors que lui, se représentant tout à coup sa propre mort et la mort des siens, les yeux fixes, souffrant, criait presque qu’il fallait que la mort devienne une mort affectueuse et passionnée, criant sa haine pour un monde qui fait peser jusque sur la mort sa patte d’employé, je ne pouvais déjà plus douter que le sort et le tumulte infini de la vie humaine ne soient ouverts à ceux qui ne pouvaient plus exister comme des yeux crevés mais comme des voyants emportés par un rêve bouleversant qui ne peut pas leur appartenir. » Dépouillée de sa cérébralité, l’existence humaine peut frayer avec la mort, sans en être effrayée. De façon plus aiguë que jamais, au moment où se déclenche la guerre d’Espagne, Leiris et Masson, hallucinant leur propre mort, Georges Bataille et sa compagne Colette Peignot, assouvissant leurs désirs, les uns et les autres mêlant tout à la fois le fraternel et le macabre, la terre et le ciel, le charnel et le morbide, la nuit et le soleil, le feu et le fer, tous sont décidés à ne pas se dérober devant la liberté et la mort, devant l’amour et la vie.
Nietzsche est omniprésent dans Acéphale. Le Nietzsche de la mort de Dieu et du sens de la Terre. Le Nietzsche héraclitéen. Le Nietzsche Dionysos ou l’exubérance destructrice de la vie. Et c’est tout naturellement dans sa « Chronique nietzschéenne » de juillet 1937 que Bataille accorde une place de choix à la représentation de Numance5, à laquelle ont tant contribué ses amis André Masson et Jean-Louis Barrault. S’il ne manque pas de rattacher la tragédie de Cervantes à l’actualité de la guerre civile, Bataille s’approprie Numance ou encore le cri de guerre des assiégés désespérés « Numance ! Liberté ! » Il en fait une tragédie nietzschéenne : « Car dans l’agonie de Numance, à l’intérieur des murs et sous la paroi nue de la sierra ce qui est là est la Terre […] ». Il en fait une expérience bataillienne : « Et bien que cette Terre exhale la Fureur et la Rage, bien qu’elle apparaisse dans les cris des enfants égorgés par les pères, des épouses égorgées par les maris, bien que le pain qu’elle apporte à l’affamé soit trempé de sang, le sentiment qu’inspire sa présence n’est pas l’horreur. » Il en fait l’expérience d’un peuple qui agonise, mais d’une communauté sans chef, d’un peuple acéphale : « De même que les Romains commandés par l’implacable autorité d’un chef sont associés à la gloire du soleil, de même les Numantins SANS CHEF sont placés dans la région de la Nuit et de la Terre, dans la région hantée par les fantômes de la Mère-Tragédie. »
Numance n’est pas Antigone, ce n’est pas une tragédie de l’individu, c’est une tragédie collective comparable au siège de Massada, qui surviendra plus tard. De plus, la vérité existentielle de Numance étant religieuse, mythique ou sacrée, Numance ne relève ni de l’idée de patrie, même si cet idéal intervient dans sa dramaturgie, ni du fait d’armes, ni de l’événement politique. Dès lors Bataille s’emploie à réfuter minutieusement ces trois interprétations de Numance. Selon lui, la première reste extérieure à l’effroi de la tragédie ; la deuxième, celle d’un peuple en armes, souffre d’une rationalité étriquée et d’un déficit symbolique ; quant à la troisième, l’interprétation politique, qui confond Numance et la guerre d’Espagne, elle donne l’occasion à Bataille de développer une critique originale, somme toute nietzschéenne, portant d’une part sur le spectacle de Numance à Paris et d’autre part sur la guerre civile en Espagne.
Pour suivre Bataille, il faut comprendre que si Numance est acéphale, l’Espagne en pleine guerre civile ne l’est certainement pas. En premier lieu, Bataille récuse l’identification stricte des Républicains aux Numantins et des Fascistes aux Romains. Il ne perçoit dans cette combinaison qu’une grossière tromperie : « Il n’y a qu’illusion et facilité dans le fait d’aimer Numance parce qu’on y voit l’expression de la lutte actuelle. » L’Espagne républicaine, ou le front antifasciste, ou l’alliance des anarchistes, des gauchistes et des communistes, cela ne ressemble pas à la communauté profondément unie des Numantins : « le mouvement antifasciste, s’il est comparé à Numance, apparaît comme une cohue vide, comme une vaste décomposition d’hommes qui ne sont liés que par des refus. » Si les républicains ne sont qu’antifascistes, s’ils ne font que dire non, alors ils n’affirment rien, ils n’ont pas de volonté propre, ils ne s’inscrivent pas dans la puissance fatale de la vie. Bataille, qui se réfère implicitement à Nietzsche, découvre dans l’antifascisme, aux forces purement négatives et réactives, un simple avatar du nihilisme, « une négation agitée ».
Redisons-le, au printemps ou au début de l’été de 1937, pour Bataille, l’actualité de la guerre d’Espagne ne reflète en rien l’événement existentiel du siège de Numance ni la puissance mythique d’autoannihilation des assiégés. Car ce qu’il voit à l’œuvre dans la guerre civile espagnole c’est la passion politique moderne qui rend « impossible la formation d’une véritable communauté de cœur ». D’abord, Bataille s’en prend à la politique en épinglant les politiciens de tous bords, adeptes des compromis et des compromissions. Ensuite, les masses d’aujourd’hui acculées à la misère sont aussi mystifiées par l’opposition de l’antifascisme et du fascisme, alors que le « césarisme soviétique » ne vaut guère mieux que le « césarisme allemand », qu’elles sont abusées par la comédie des démocraties jouant un drôle de jeu avec les régimes totalitaires. Enfin, et là l’audace de Bataille est stupéfiante, se remémorant sans doute le long siège de Saragosse par les troupes napoléoniennes, Bataille affirme l’inanité ou l’absurdité d’une représentation de Numance dans Saragosse assiégé et en vient à refuser toute récupération politique du spectacle de Numance, aussi bien au théâtre Antoine qu’en Espagne, récupération propre à entretenir la confusion : « Numance, aujourd’hui, a été représentée non seulement à Paris, mais en Espagne, dans des églises brûlées, sans autre décor que les traces de l’incendie et sans autres acteurs que des miliciens rouges.6 » Le combat politique est étranger à la tragédie de Numance. C’est pourquoi le chroniqueur d’Acéphale ajoute : « Les thèmes fondamentaux d’une existence reculée, les thèmes mythologiques cruels et inaltérés qui sont développés par la tragédie, ne sont-ils pas, cependant, aussi étrangers à l’esprit politique qu’à l’esprit militaire ? » Bataille est raisonnablement et violemment convaincu qu’une vérité dionysiaque « ne peut pas être l’objet d’une propagande ».
En 1945, Bataille dirigera un cahier Actualité intitulé « L’Espagne libre », comprenant une préface d’Albert Camus et divers articles de Cassou, Quero-Morales, Lorca, Blanchot (sur L’Espoir de Malraux), etc. Le dossier, assez classique, paraît très loin de la revue Acéphale. Les deux contributions de Bataille portent sur deux œuvres emblématiques : Guernica de Picasso et Pour qui sonne le glas ? d’Ernest Hemingway. Or, examinant un passage du roman de Hemingway, Bataille confronte ce récit à ses propres souvenirs et au témoignage d’une photographie qu’il a sous les yeux. C’est l’épisode de la mort du torero Granero, une des scènes originaires d’Histoire de l’œil, qu’il nous fait revivre : « J’étais à l’opposé de la Plaza et, de toute la scène je n’ai connu les détails que dans les récits — ou les photographies — qu’on en publia. Mais ce jeune homme au vêtement étincelant, brusquement renversé, bousculé contre la barrière, le taureau, quelques secondes, s’acharnant à coups de cornes sur lui (les cornes à grande volée heurtant les planches en tirèrent des sons plats, macabres, et comme les trois coups de la mort) : il y eut, je ne sais à quel instant, dans l’arène où l’innombrable foule s’était levée, un silence accablé, cette entrée théâtrale, en pleine fête, au soleil, de la mort eut je ne sais quoi d’évident, d’attendu, d’intolérable. » À travers ce souvenir de 1922, rapporté en 1945, c’était aussi en quelque sorte la durée de la guerre civile que Bataille hallucinait.
La durée de la guerre d’Espagne n’est pas étrangère à la biographie et à l’écriture de Bataille. Alors qu’elle était dissociée de Numance en 1937, elle resurgit en 1945, associée à la figure brisée et à l’œil pendant du torero Granero. Les visions et l’odeur de la mort de 1922, remémorées en 1945, concernent non seulement la guerre d’Espagne mais toute l’œuvre de Bataille. En premier lieu, Histoire de l’œil de 1928. Mais aussi et surtout le récit de 1935 qui préfigure à la fois la guerre d’Espagne et la société secrète Acéphale, à savoir Le Bleu du ciel. Bataille a planté dès 1935 le décor de la guerre civile à Barcelone. Cependant, dans son récit, les convulsions de l’érotisme l’emportent sur les manigances révolutionnaires, qu’elles soient anarchistes, trotskistes ou communistes. Telle est la vérité de Bataille : dans l’étreinte de l’amour et de la mort, les dès pipés de la politique ne peuvent pas compter. D’ailleurs, l’état d’esprit du narrateur du Bleu du ciel, ouvrage en principe achevé en mai 1935 et publié en 1957, donne une idée du rôle de pur observateur que jouera Bataille pendant la guerre d’Espagne : « Je revins à Barcelone. […] Je détestais la curiosité qui m’engageait à participer, de très loin, à la guerre civile. […] Je comprenais qu’à Barcelone, j’étais en dehors des choses, alors qu’à Paris, j’étais au milieu. À Paris, je parlais avec tous ceux dont j’étais proche au cours d’une émeute. » N’oublions pas que le narrateur du Bleu du ciel se nomme Troppmann et sa maîtresse Dirty. Or Troppmann est un assassin célèbre du XIXe siècle, cité par Isidore Ducasse dans Poésies I : « La révolte des Troppmann, des Napoléon Ier, des Papavoine, des Byron, des Victor Noir et des Charlotte Corday sera contenue à distance de mon regard sévère. Ces grands criminels, à des titres si divers, je les écarte d’un geste. » Et quand, dans Poésies II, Ducasse évoque « un assassinat de huit personnes aux portes de la capitale », il renvoie à nouveau à Troppmann qui assassina les huit membres de la famille Kinck et en enterra plusieurs dans un terrain vague de Pantin.
Bien avant Troppmann-Bataille, Nietzsche s’était identifié à Prado et à Chambige, deux criminels qui défrayaient la chronique. Il en plaisantait dans sa dernière lettre, qui annonce aussi la folie du philosophe. Dans cet envoi de Turin, daté du 6 janvier 1889, Nietzsche écrivait au professeur Jacob Burckhardt : « Ne prenez pas l’affaire Prado trop au sérieux. (C’est moi qui suis Prado, je suis aussi le père de Prado, j’ose ajouter que je suis aussi Lesseps…) Je voudrais apporter à mes Parisiens, que j’aime, une nouvelle notion, — celle de l’honnête criminel. Je suis aussi Chambige, — également un honnête criminel. » On sait l’importance de Nietzsche dans Acéphale : « Réparation à Nietzsche » (21 janvier 1937), puis « Dionysos-Nietzsche » (juillet 1937), enfin « La folie de Nietzsche » (juin 1939), qui commémore l’effondrement de Nietzsche. Mais Bataille n’est pas le seul à s’intéresser aux grands criminels, à Nietzsche ou à Sade. D’une part, dès octobre 1930, Breton publie dans Le Surréalisme au service de la révolution la première traduction française de la dernière lettre de Nietzsche. D’autre part, Breton et Éluard, en novembre 1930, consacrent un chapitre de L’Immaculée Conception à cinq criminels célèbres : Troppmann, cité par Isidore Ducasse, la Brinvilliers, la marquise empoisonneuse, Vacher7, l’éventreur de bergères, dont le nom revient inévitablement puisque associé à celui de Jacques Vaché, Soleilland, qui tua une petite fille, et Haarman, le boucher de Hanovre. Si le titre du chapitre, « Il n’y a rien d’incompréhensible », a été emprunté à Ducasse, son contenu, comme dans la meilleure tradition ducassienne, est un incroyable détournement et retournement d’une chronique musicale de L’Intransigeant du 11 septembre 1930. Par exemple, tel passage : « Magda Tagliafero, Wladimir Horowitz, Joseph Szigeti, Milstein, Weingartner… Quelle philharmonique d’Europe ou d’outre-mer pourrait se vanter de réunir ces vedettes sur la même affiche ? » prend une autre tournure dans la version surréaliste : « Troppmann, la Brinvilliers, Vacher, Soleilland, Haarmann… Quelle fête de charité pourrait se vanter de réunir d’aussi grandes vedettes sur la même affiche ? » On peut lire aussi : « Troppmann rit, tout un terrain vague dans les yeux.8 »
En 1957, dans l’Avant-propos au Bleu du ciel, livre dédié à André Masson, Bataille nous dit avoir renoncé en 1935 à sa publication, doutant alors de la valeur du roman : « J’avais, dès 1936, décidé de n’y plus penser. / D’ailleurs, entre-temps, la guerre d’Espagne et la guerre mondiale avaient donné aux incidents historiques liés à la trame de ce roman un caractère d’insignifiance : devant la tragédie elle-même, quelle attention prêter à ses signes annonciateurs ? » Mais pourquoi avoir décidé, pendant la guerre d’Espagne, d’oublier un récit à moitié halluciné sur la révolution ou la guerre civile en Espagne ? En juillet 1937, Bataille ne jugeait-il pas que relevaient du tragique, non le cours de l’histoire, et en particulier la tournure politique de la guerre civile en Espagne, mais la communauté de cœur, la mort de Dieu, la communauté sans chef, la société secrète Acéphale, et pour tout dire la ville de Numance assiégée et ensanglantée ? Et pouvait-il alors publier sa version prémonitoire de la guerre d’Espagne, version subjective, traitant crûment du sexe et de la mort dans la lignée fantasmatique de l’œil exorbité du jeune torero Granero, esquissant aussi à l’avance sa relation amoureuse et semble-t-il sadomasochiste avec Colette Peignot, relation qui s’interrompra avec la mort de sa compagne le 7 novembre 1938 ? Avant même que n’éclate la guerre d’Espagne, Bataille portait en lui une autre guerre d’Espagne, érotique et tragique, nietzschéenne et sacrificielle, bouleversante et apolitique. Cependant, en 1957, Bataille inverse ou tout au moins atténue son évaluation première : les signes existentiels tragiques du Bleu du ciel deviennent insignifiants et la durée de la guerre d’Espagne jugée en son temps équivoque ou prosaïque est affectée du signe tragique.
Reprenons notre question initiale : la durée historique ou imaginaire de la guerre d’Espagne a-t-elle recoupé ou non la durée surréaliste de Breton et la durée acéphale de Bataille ? Nous avons vu que la réponse négative s’imposait. Pourtant, l’événement proprement historique de la guerre d’Espagne n’a été négligé ni par Breton ni par Bataille qui pouvaient s’informer auprès de Péret ou de Masson. Mais l’un, revenu enchanté des Canaries et en partance pour le Mexique où il sera sidéré par le pays et par Trotski, rate en quelque sorte la révolution en Catalogne ou en Espagne. Quant à l’autre, fasciné par la corrida et familier des bordels de Barcelone, il ne parvient pas, après avoir halluciné sa guerre d’Espagne au cours de certains épisodes d’Histoire de l’œil et du Bleu du ciel, à faire coexister, dans sa conception mythique et tragique de l’histoire, Numance et la guerre civile. De plus, et nous n’insisterons pas, Breton, avec Jacqueline Lamba, et Bataille, avec Colette Peignot, vivent un amour fou qui n’a rien de serein. Toutefois, les durées surréalistes de Breton, comme les durées acéphales de Bataille, resteraient incompréhensibles si elles étaient uniquement rapportées à leur individualité.
À l’instar du groupe surréaliste, la durée surréaliste est polycéphale. Car elle met en jeu des dyades (par exemple, Breton-Vaché), des triades (par exemple, Breton-Péret-Éluard), des tétrades, des pentades, etc. Le corps surréaliste, à l’image de certains photomontages, regroupe plusieurs têtes diversement associées. La communauté acéphale, pour sa part, réunit plusieurs corps sans qu’émerge une seule tête. Il faudrait suivre, tout au long des années trente, la désagrégation et le renouvellement du corps polycéphale surréaliste, et, parallèlement, la tentative tantôt patiente tantôt désespérée de constituer un cercle bataillien ou une communauté acéphale. On sait que le groupe Contre-Attaque signe la jonction des bretoniens et des batailliens, et qu’en avril 1936, lorsque Bataille séjourne chez Masson à Tossa de Mar, ce collectif monstrueux ou désaccordé éclate. Pourtant, jusqu’à l’avènement de la Seconde Guerre, Bataille n’aura de cesse de constituer une communauté acéphale. Il est impossible de suivre le mouvement brownien des petits groupes gravitant autour de Contre-Attaque, du Collège de sociologie ou des revues Minotaure, La Bête noire, Acéphale, Inquisitions, Verve. À titre d’échantillon, se côtoient, se font, se défont, les dyades Breton-Bataille, Breton-Éluard, Breton-Péret, Breton-Dalí, Bataille-Masson, les triades Bataille-Leiris-Masson, Breton-Heine-Mabille, Leiris-Vitrac-Queneau, Caillois-Aragon-Tzara, etc. C’est à se demander si ces rapprochements et éloignements, ces retrouvailles et ruptures, ces consécrations d’une fort longue amitié et ces redistributions de cartes, bref si ces attractions et répulsions qui agitent les proches de Bataille ou de Breton de 1935 à 1938, ne préfigurent pas les effusions et les désillusions propres à la guerre d’Espagne. Autrement dit, si ces brassages et ces clivages traversant le mouvement surréaliste et la communauté acéphale ne signalent pas des dénouements et des cassures de l’histoire européenne.
La revue Minotaure n° 9 du 15 octobre 1936 fait allusion à la guerre d’Espagne à travers deux planches en couleurs du tableau de Salvador Dalí ainsi légendé : Espagne, Prémonition de la guerre civile, et peut-être aussi à travers la planche en couleurs du Massacre des innocents de Nicolas Poussin. Or la toile de Dalí avait déjà été reproduite dans Minotaure n° 8 du 15 juin 1936, sans autre indication que l’année « 1936 ». À y regarder de plus près, cette livraison de Minotaure du 15 juin 1936 évoque bel et bien, mais par anticipation, la guerre d’Espagne. Remarquons que Dalí y est omniprésent avec la couverture du numéro, l’article « Le surréalisme spectral de l’éternel féminin préraphaélite », deux tableaux légendés : « 1936 » et « 1936 (non achevé) », et quatre dessins illustrant des poèmes d’Edward James. Notons par ailleurs qu’on peut créditer Dalí d’une autre prémonition, datant cette fois-ci de 1932, puisque le scénario de son film surréaliste Babaouo est précédé de l’annonce suivante : « (L’action de ce film se passe en 1934 dans n’importe quel pays d’Europe, pendant la guerre civile). » Pourtant ce n’est pas Dalí qui touche au cœur de l’Espagne. En fait, les contributions du trio Breton-Péret-Heine et du duo Bataille-Masson, en manifestant une relation forte ou viscérale à une certaine Espagne, nous permettront de mieux apprécier, après un tel coup d’éclat, le retrait relatif ou l’attitude d’expectative de Breton et de Bataille pendant la guerre d’Espagne.
Dans Minotaure de juin 1936, sont donnés à la suite, une double intervention de Breton et Péret sur la décalcomanie récemment découverte par le peintre canarien Óscar Domínguez9 , le texte majeur de Breton « Le Château étoilé » lié au pic du Teide de Tenerife et un dialogue hallucinant signé Maurice Heine, illustré d’images insoutenables de corps étripés et de cadavres calcinés. L’Espagne, le plus souvent via les Canaries, intervient à quelque degré dans la série Breton-Péret-Heine. Dans ce contexte, un extrait de Crimen, le récit aux accents maldororiens du poète canarien Agustín Espinosa, n’aurait certainement pas détonné. Quant à Bataille, dont c’est la première et la dernière apparition dans Minotaure, son intervention est indissociable de celle de Masson. D’abord, c’est sous le titre général « Montserrat » que leurs deux noms sont associés. Ensuite, Bataille précise que l’extase cosmique et religieuse relatée dans son texte « Le bleu du ciel »10 est du même ordre que l’expérience vécue par Masson à Montserrat et dont témoignent le poème « Du haut de Montserrat » ainsi que les tableaux Paysage aux prodiges et Aube à Montserrat, qui servent justement à illustrer les deux textes. Enfin, on constate que la fraternité de Masson et de Bataille, perceptible dans ce numéro de Minotaure, se place sous le signe d’un site d’Espagne, sous les cieux de Montserrat.
Autour du 28 novembre 1934, André et Rose Masson, égarés dans la montagne, vécurent une nuit tourmentée sur les hauteurs de Montserrat. Ils ne purent rejoindre le monastère qui les hébergeait qu’au petit matin. Pour André Masson, ce fut une nuit échevelée, contrastée et cosmique. Il était deux fois pris de vertige, entraîné vers le ravin et aspiré par le vide du ciel : Paysage aux prodiges et Aube à Montserrat en portent la marque. Du 8 au 30 mai 1935, Bataille séjourne chez Masson, où il achève son roman Le Bleu du ciel. Durant cette période, il tient aussi un journal intitulé « Les présages ». Dès le 10 mai, Masson l’entraîne à Montserrat : « André m’explique de plus en plus clairement sa nuit passée à Montserrat sur un rocher. Le paysage devient de plus en plus grandiose. J’explique à André ce que je pense de la terre et du ciel. Arrivée au-dessus du gigant encantado : à droite une sorte de rocher sanctuaire. Le sommet : la première fois que je vois la planète. La cathédrale de Manrèse aperçue par le télescope. Dîner à San Jeronimo. Au retour André m’explique de plus en plus clairement la nuit à Montserrat. La peur de la chute dans le ciel. L’ouverture du ciel : Dans l’église comme un fœtus. Je lui propose d’écrire le récit de notre voyage.11 » Le pèlerinage n’est pas terminé, puisque Bataille note le 11 mai : « André revient dans le cours de la journée sur la nuit de Montserrat. Nous nous exaltons ensemble. » Une indication du 17 mai n’est sans doute pas étrangère à la nuit de Montserrat : « Rêve de ciel étoilé sous les pieds. » Le 20 mai, Bataille observe le travail du peintre : « Masson fait les 4 esquisses / Montserrat (serpent) / Montserrat (phallus) / Montserrat (soleil) / Actéon ». Et enfin le 21 mai : « André commence Montserrat.12 »
C’est en mai 1935 que Masson et Bataille se rendent sur les hauteurs de Montserrat et que Jacqueline et André Breton entreprennent l’ascension du Teide à Tenerife. En juin 1936, Minotaure en rendra compte en publiant simultanément « Le Château étoilé » d’André Breton et « Montserrat » de Georges Bataille et André Masson. Tandis que du haut de Montserrat, Masson salue Héraclite, Paracelse et Zarathoustra, Breton, en vue du pic du Teide, se souvient des nuages chez Baudelaire et dans Hamlet mais aussi de l’invocation à l’Etna dans La Nouvelle Justine de Sade : « Un jour, examinant l’Etna, dont le sein vomissait des flammes, je désirais être ce célèbre volcan… » Curieusement, pendant l’été de 1937, Georges Bataille et Colette-Laure Peignot entreprennent l’ascension de l’Etna et semblent rééditer, en plus terrible, la nuit de Montserrat. Le 14 septembre 1939, Bataille en fera le récit : « Je suis allé hier sur la tombe de Laure et dès que j’ai passé ma porte la nuit était si noire que je me suis demandé s’il me serait possible de me diriger sur la route ; […] le souvenir de la montée de l’Etna me revint à l’esprit et me bouleversa : tout était aussi noir et aussi chargé de terreur sournoise pendant la nuit où Laure et moi nous avions gravi les pentes de l’Etna (cette montée à l’Etna eut pour nous un sens extrême ; […] l’arrivée à l’aube sur la crête du cratère immense et sans fond — nous étions épuisés et, en quelque sorte, exorbités par une solitude trop étrange, trop désastreuse : c’est le moment de déchirement où nous nous sommes penchés sur la blessure béante, sur la fêlure de l’astre où nous respirions. Le tableau de cendre et de flammes qu’André [Masson] a peint après que nous lui en avons parlé était près de Laure lorsqu’elle était morte, il est encore dans ma chambre. Au milieu du parcours, alors que nous étions entrés dans une région infernale, nous devinions également au loin le cratère du volcan à l’extrémité d’une longue vallée de lave et il était impossible d’imaginer quelque lieu où l’horrible instabilité des choses fût plus évidente, Laure fut prise tout à coup d’une angoisse telle que, folle, elle s’enfuit en courant droit devant elle : l’effroi et la désolation dans lesquels nous étions entrés l’avaient égarée).13 »
« Le bleu du ciel » donné dans Minotaure, outre qu’il annonce la publication à venir du roman Le Bleu du ciel, est fondateur à deux titres au moins. D’une part, Bataille affirme là que c’est grâce à la représentation maladive d’un œil ouvert au sommet de son propre crâne, autrement dit grâce à son œil pinéal, qu’il « accède tout à coup à une chute déchirante dans le vide du ciel. » D’autre part, l’expérience métaphysique du « Bleu du ciel » est présentée comme analogue à l’extase religieuse ressentie par Masson sur les hauteurs de Montserrat. Quant au « Château étoilé » de Breton donné dans le même numéro de Minotaure, on en connaît la formule finale, plus ésotérique que métaphysique : « À flanc d’abîme, construit en pierre philosophale, s’ouvre le château étoilé. » Deux sens dominent dans cette formule : le Château étoilé des environs de Prague se transporte sur les hauteurs du Teide, tel un chapiteau étoilé. S’y ajoute la question du déclenchement de la durée surréaliste. Car sans durée automatique, on ne peut pas déterminer de Point Sublime. En tout cas, on devine dans ce numéro de juin 1936 de réels motifs de rapprochement entre Bataille, Masson et Breton. C’est pourquoi, vis-à-vis de la durée de la guerre d’Espagne, Breton et Bataille adopteront une position symétrique. Pour l’avoir en partie anticipée, tous deux l’éluderont politiquement. Mais, l’un dans sa communauté acéphale et l’autre dans son groupe polycéphale, ils l’aborderont de plain-pied, dans la joie, l’extase et l’effroi.
Pour conclure, on pourrait exprimer autrement la relation de Breton ou de Bataille à la guerre d’Espagne en évoquant l’aventure de Minotaure et la figure d’André Masson. Contrairement à ce qu’on avance parfois, le titre « Minotaure » a été suggéré, non par Roger Vitrac, mais par Bataille, appuyé par Masson. Il y a là une volonté d’ancrage dans la mythologie ou, selon l’objet même du futur Collège de sociologie, dans le sacré. Rappelons à ce propos les rubriques de Minotaure, revue artistique et littéraire : « Arts plastiques — Poésie — Musique — Architecture — Ethnologie — Mythologie — Spectacles — Psychologie — Psychiatrie — Psychanalyse. » Certes l’histoire et la politique n’y ont pas leur place. Pourtant Pierre Mabille14, André Breton, Benjamin Péret, Maurice Heine, Georges Bataille et André Masson, beaucoup plus que Dalí, ont introduit subrepticement en juin 1936, l’équivalent existentiel, passionnel ou poétique de la guerre d’Espagne. En fait, si on admet comme André Masson, l’adversaire résolu de la revue concurrente La Bête noire, « le Pou du Minotaure », que l’histoire a une résonance mythique et que le mythe a un ressort historique, on s’aperçoit alors que la graveur de Mithra, Orphée, Le Crucifié, Minotaure, Osiris, l’auteur des cinq eaux-fortes de Sacrifices, qu’accompagne un texte de Bataille, détient une des clés de la guerre d’Espagne. Sa clé est d’ordre imaginaire. Elle apparaît dès la première livraison de Minotaure de juin 1933 avec Massacres, dessins d’André Masson sur cinq pleines pages. Elle resurgit dans « Espagne 1934-1936 », exposition tenue à la galerie Simon du 7 au 19 décembre 193615. Elle réapparaît dans le dessin illustrant Tauromachies de Michel Leiris, publié en août 1937. Elle est décelable dans le dessin « Mélancolie du Minotaure » occupant un double page de Minotaure de mai 1938. Puis en juillet 1938, dans les trois dessins du Miroir de la tauromachie de Leiris, unique livre paru sous le sigle « Acéphale ». Enfin en janvier 1939, dans les deux dessins illustrant les poèmes de Leiris Abanico para los toros. Car si de juin 1933 à mai 1939, Picasso, Roux, Derain, Borès, Duchamp, Miró, Dalí, Matisse, Magritte, Ernst, et pour finir, Masson lui-même, ont successivement donné en couverture leur image du Minotaure, entre-temps Masson a vécu en Espagne, a connu la nuit de Montserrat, a partagé son extase avec Bataille, son affection et ses colères, a renoué avec Breton à l’occasion de l’Exposition internationale du surréalisme de Londres, a contribué avec Bataille au choix de la tragédie de Numance dont il réalisera les décors et les costumes et dont il préservera la dimension mythique. C’est la durée de la guerre d’Espagne ou, si l’on préfère, sa réalité historique et son expression mythique, ses manifestations politiques et ses motifs  imaginaires, c’est bien la guerre d’Espagne, avant même son déclenchement, qui donne un contenu palpable au mythe ancien du Minotaure. Si l’on en croit Mabille, c’est encore elle qui révèle à l’échelle de la planète la vie et la mort des civilisations, le destin des égrégores. C’est toujours elle qui accompagne, au fur et à mesure de son déroulement, les soubresauts qui agitent la communauté acéphale des batailliens et le groupe polycéphale des bretoniens. Et cette durée qui a tenu à distance et Breton et Bataille, justement parce qu’elle a produit ce double effet, peut désormais être réinterprétée à partir du mythe bataillien ou à la lumière de l’imaginaire surréaliste.
imaginaires, c’est bien la guerre d’Espagne, avant même son déclenchement, qui donne un contenu palpable au mythe ancien du Minotaure. Si l’on en croit Mabille, c’est encore elle qui révèle à l’échelle de la planète la vie et la mort des civilisations, le destin des égrégores. C’est toujours elle qui accompagne, au fur et à mesure de son déroulement, les soubresauts qui agitent la communauté acéphale des batailliens et le groupe polycéphale des bretoniens. Et cette durée qui a tenu à distance et Breton et Bataille, justement parce qu’elle a produit ce double effet, peut désormais être réinterprétée à partir du mythe bataillien ou à la lumière de l’imaginaire surréaliste.
Georges Sebbag
Notes
1 La Révolution surréaliste n° 3, p. 31.
2 Les lettres de Péret à Breton sont recueillies dans Claude Courtot, Introduction à la lecture de Benjamin Péret, Le Terrain Vague, 1965.
3 Voir Cahiers G.L.M., 7 (mars 1938).
4 Michel Leiris, Journal, 1922-1989, éd. établie par Jean Jamin, Gallimard, 1992.
5 Après avoir assisté à la représentation de Numance, adapté par Jean-Louis Barrault, Bataille a emprunté à la Bibliothèque nationale le 15 mai 1937 : Cervantès, Numance, trad. La Beaumelle, Ladvocat, 1823. Et il a rendu l’ouvrage le 23 juin 1937. Voir, G. Bataille, Œuvres complètes, XII, Gallimard, p. 609.
6 Citant cette phrase en note, Michel Surya, propose le commentaire suivant : « Bataille, de nouveau, déporte les centres d’intérêts politiques. Des miliciens rouges jouant Numance dans des églises incendiées sont seuls à hauteur des mythes tragiques qui métamorphosent l’histoire » (Michel Surya, Georges Bataille, la mort à l’œuvre, Librairie Séguier, 1987, p. 248 ; Gallimard, 1992, p. 294). Il nous semble que le biographe de Bataille fait ici un contresens.
7 L’article de Maurice Heine, « Regards sur l’enfer anthropoclasique », publié dans Minotaure n° 8 du 15 juin 1936, est illustré de deux planches empruntées à l’ouvrage du Professeur A. Lacassagne, Vacher l’Éventreur et les crimes sadiques (Lyon, Storck, 1899). Dans cet article, M. Heine fait dialoguer les ombres du Marquis de Sade, du Comte de Mesanges, de Jack l’Éventreur, du Professeur Paul Brouardel et pour finir l’ombre de Maria de los Dolores Dominguez : « (C’est une jeune fille de dix-huit à vingt ans, pieds nus, vêtue en bergère des montagnes de Ségovie, qui se dresse, les yeux égarés, et pousse des cris épouvantables.) — Tiens, voilà le cœur de celui qui m’a empêchée d’être la plus heureuse des femmes ; de celui qui m’a privée de l’homme que j’adorais. C’est le cœur de mon père que je viens d’assassiner ; goûtes-en si tu veux, Juan Diaz !… »
8 À la dernière page du Bleu du ciel le narrateur Troppmann assiste à Francfort au spectacle « obscène » d’une fanfare d’enfants nazis : « Je les voyais, non loin de moi, envoûtés par le désir d’aller à la mort. Hallucinés par des champs illimités où, un jour, ils s’avanceraient, riant au soleil : ils laisseraient derrière eux les agonisants et les morts. […] Une hilarité me tournait la tête : j’avais à me découvrir en face de cette catastrophe une ironie noire, celle qui accompagne les spasmes dans les moments où personne ne peut se tenir de crier. » Le rire halluciné des enfants nazis et l’hilarité noire de Troppmann à la fin du Bleu du ciel amplifient sur un mode sinistre la description dans L’Immaculée Conception de criminels rendus aimables : « Vacher évoque la beauté des prostituées amoureuses, Haarmann mange, Soleilland joue, Troppmann rit, tout un terrain vague dans les yeux. » Bataille semble s’accorder avec Breton et Éluard sur le rire de Troppmann. Rappelons que l’intérêt pour le crime est patent dès le début du surréalisme. Citons en vrac : le premier message automatique « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre » entendu au début de 1919 (lié, selon nous, à la mort de Jacques Vaché et aux faits divers de l’Homme coupé en morceaux ou de la Femme coupée en morceaux), Les Chants de Maldoror, la figure de Sade, le jeu du « Cadavre exquis », les deux séries d’articles de Robert Desnos sur « Jack l’Éventreur » et « Vacher l’Éventreur » publiés dans Paris-Matinal du 29 janvier au 18 février 1928, etc. Bataille, de son côté, est fasciné par le sang, par exemple dès son séjour à Madrid. Mais d’où vient le nom de Troppmann ? Des Poésies de Ducasse. C’est évident, si on pense à Breton. Pour Bataille, il faut être d’autant plus circonspect que le nom de Troppmann intervient bien avant Le Bleu du ciel. En effet selon un passage du récit Le Petit, édité en 1943, Bataille avait écrit, avant même Histoire de l’œil, un livre intitulé W.-C. avec Troppmann comme nom d’auteur. Du manuscrit détruit de W.-C., il ne subsista qu’un chapitre, utilisé comme « Introduction » dans Le Bleu du ciel. La piste Ducasse vaut néanmoins pour Bataille. Résumons : vers 1926-1927 et au mois de mai de 1934, Bataille juge bon de s’appeler Troppmann. Or, curieusement, en 1925, Bataille emprunte à deux reprises à la Bibliothèque nationale Les Chants de Maldoror et Poésies : le 16 juin 1925 (ouvrages rendus le 18 juillet) et le 24 novembre 1925 (ouvrages rendus respectivement le 18 décembre et le 22 décembre). Il récidive en 1934. Le mois précédent son séjour à Tossa de Mar, où il écrira l’essentiel du Bleu du ciel, il emprunte les Œuvres complètes de Lautréamont le 15 avril 1935. Et il rend l’ouvrage le 26 avril. Voir à ce sujet « Emprunts de Georges Bataille à la B.N. (1922-1950) » dans G. Bataille, Œuvres complètes, XII, pp. 560, 562, 600.
9 Voir Emmanuel Guigon, « Al filo del abismo », dans le catalogue Sueños de tinta, Óscar Domínguez y la decalcomanía del deseo, CAAM, 1994. Voir aussi un beau document : le manuscrit de « Décalcomanie sans objet préconçu » d’André Breton ayant servi à l’imprimeur de Minotaure.
10 À l’exception d’un fragment, remanié, le texte de Bataille donné dans Minotaure sous le titre « Le bleu du ciel » ne sera pas repris en 1957 dans le roman Le Bleu du ciel. En revanche, dès 1943, Bataille a inséré l’essentiel du « Bleu du ciel », avec plusieurs corrections, dans L’Expérience intérieure. Et il l’a daté d’août 1934.
11 Georges Bataille, Œuvres complètes, II, « Les présages », pp. 266-270.
12 En novembre 1936, Kaminski se rend à Montserrat. Il commence par décrire le site, tout en évoquant Lohengrin : « […] une montagne isolée monte droit vers le ciel. Elle est sauvage et inaccessible, de tous côtés on voit des rochers nus entourer sa cime, comme un mur érigé par des mains de géants. Lorsque le soleil couchant l’illumine, ce mur se teinte d’un rouge sanglant et prend un aspect fantastique. Tel est le Montserrat, la montagne du Saint-Graal qui est entrée dans l’univers littéraire avec Wolfram d’Eschenbach et Richard Wagner. » Il constate ensuite que l’église est fermée et que le monastère est vide ; les deux cents bénédictins ont fui à l’étranger. Et il apprend enfin que Manuel Azaña, le président de la République, réside à Montserrat (H.E. Kaminski, Ceux de Barcelone, Denoël, 1937 ; Allia, 1986, pp. 133-135).
13 G. Bataille, Œuvres complètes, V, Notes, pp. 499-500.
14 Pierre Mabille ouvre Minotaure n° 8 avec « Notes sur le symbolisme ». De 1934 à 1939, il collabore à la revue. En 1938, il publie Égrégores ou la vie des civilisations. Le livre est dédié « aux combattants de l’Espagne révolutionnaire écrasés par le poids d’un monde de mort. Premiers vivants de la grande Légende où se fondra le neuve conscience des hommes. » Sur la bande de l’ouvrage est inscrit : « Mort de l’Occident ». Mabille invite à une lecture symbolique de l’événement politique : « La guerre d’Espagne constitue l’événement sensationnel qui servira de test pour apprécier les composantes diverses de la réalité d’aujourd’hui et de demain. C’est là un phénomène mystérieux. […] La valeur unique du débat espagnol vient du fait qu’il se présente avec une netteté presque symbolique. La lutte d’un peuple dépourvu jusqu’alors de toutes connaissances et de toutes techniques modernes, n’ayant de force que sa révolte et sa conscience contre l’union de toutes les internationales de l’oppression, de toutes les puissances européennes et mondiales (christianisme, capitalisme, pseudo-démocraties libérales) revêt un aspect homérique où l’on sent la naissance d’un mythe. […] j’affirme que nous avons assisté à l’origine d’un mythe immense. L’Espagne Révolutionnaire n’est pas l’expression totale du Bien, l’avenir estompera les faiblesses, mais elle contient le Bien. […] Si l’Espagne avait triomphé, l’Europe entière eût pu être sauvée. » (P. Mabille, Égrégores, Jean Flory, pp. 181-182).
15 Dans son compte rendu de l’exposition Masson, publié dans La Nouvelle revue française du 1er janvier 1937, Michel Leiris décrit d’abord le carton d’invitation : « Une tête de taureau au cou de laquelle plonge (non loin d’une banderille aux papillotes légères comme des flammes, et proche l’œil furieux sous le chaton des cornes sertissant un crâne) la verticalité péremptoire d’une épée, l’on peut croire qu’en marquant d’un si tragique signe inaugural le carton de ses invitations, André Masson a voulu condenser, comme en des armoiries, tout ce que l’Espagne fut pour lui de brûlant ces deux dernières années et tout ce qu’elle souffre aujourd’hui sous le glaive des soudards qui ne parviennent que très malaisément à l’estoquer. » Puis Leiris ne manque pas de citer les tableaux relatifs à Montserrat : « délire cosmique illuminant les nuits autour du monastère de Montserrat ». Enfin il insiste sur le thème mythique de la tauromachie, « ultime chance pour l’homme — s’il consent à y risquer jusqu’à ses os — de donner corps à un sacré. »
« Breton, Bataille et la guerre d’Espagne » ainsi que « Numance et la guerre d’Espagne » sont traduits en espagnol dans le catalogue El surrealismo y la guerra civil española, sous la direction d’Emmanuel Guigon, Musée de Teruel, octobre-décembre 1998.
« Breton, Bataille et la guerre d’Espagne » est publié dans une version un peu réduite dans Cahiers Bataille 1, éditions Les Cahiers, Franche-Comté, 2011. Cet article est accompagné, sous le titre « Bataille et moi », du texte suivant :
J’ai croisé le nom de Bataille dans mes années de lycée. Je lisais alors Nerval, Breton et les surréalistes. En 1962, dans un amphithéâtre de la Sorbonne, Henri Raymond, l’assistant malicieux de Georges Gurvitch, soumettait aux étudiants de philosophie une longue liste d’ouvrages, dont La Part maudite de Georges Bataille. Je sautai sur l’occasion et fis un exposé, avec notamment un parallèle entre consumation et consommation. À partir de 1964, je rencontrais André Breton et participais aux activités du groupe surréaliste. À la même époque, en raison de ma collaboration à la revue Aletheia, je hantais les couloirs des éditions de Minuit. Là, j’eus des échanges avec Denis Hollier qui distillait, comme dans le plus grand secret, quelques propos ou échos relatifs à Bataille. La renommée de Bataille grandissait, l’auteur de L’Érotisme, L’Abbé C ou L’Impossible paraissait autrement plus scandaleux que celui de Nadja et L’Amour fou.
Nietzsche était mon philosophe de chevet. Et il ne m’a jamais quitté. Mon attachement à Bataille vient sans doute de là. Tous deux tranchent dans le vif, l’un et l’autre sont des individus souverains. En fait, je tiens Bataille, et d’ailleurs Breton aussi, pour un philosophe d’un nouveau style. Un penseur délaissant les genres répertoriés, s’immisçant dans ses propres affaires, taraudant un secret qui ne sera pourtant pas révélé. Inventant sa propre forme. Appelant le dehors, lui ôtant ses oripeaux et le revêtant de sa plus belle nudité.
Bataille ne se limite pas à ses œuvres complètes. Il est inséparable des mondes alentour – amis et rivaux, événements et revues. J’ai le sentiment que pour raviver les traits de son beau visage qui tendent à s’estomper aujourd’hui comme hier, il faudrait retisser les nombreux liens que Bataille a entretenus avec des personnes connues comme avec des objets plus improbables. Dans une telle confrontation, on n’irait peut-être pas de surprise en surprise mais on découvrirait que l’auteur du Bleu du ciel ne s’enfermait pas dans le cercle de ses obsessions et même quand il le faisait cela pouvait jeter une lumière sur la société d’alors. Autre épreuve, autre confrontation nécessaire : voir comment de nos jours nous creusons notre sillon avec les notions et les visions de Georges Bataille.
Georges Sebbag




