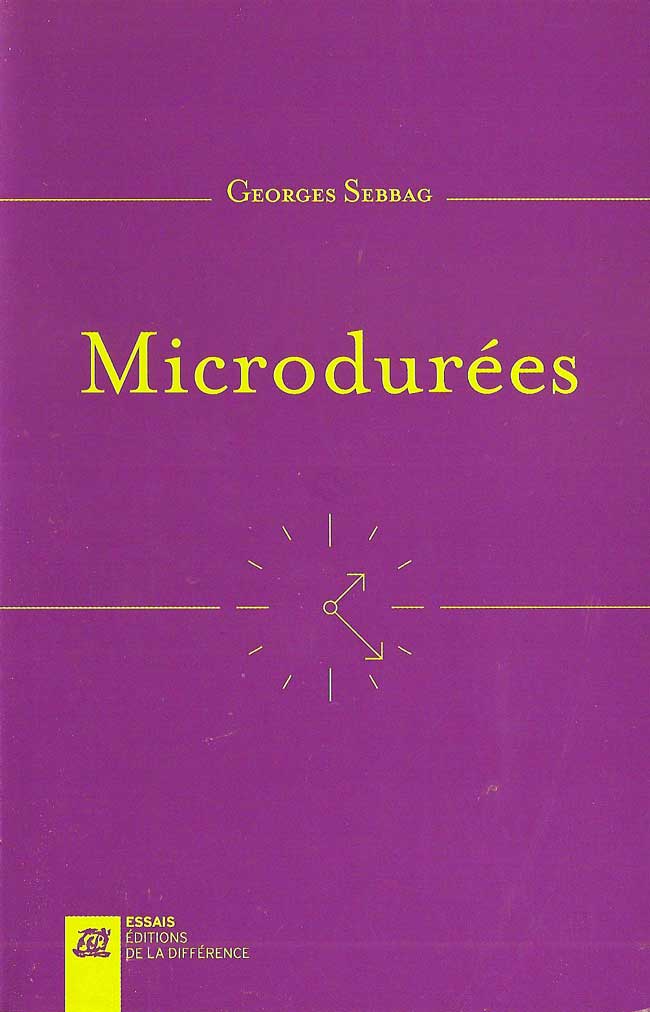
Des essaims de microdurées
Des microdurées à satiété s’offrent en pâture aux individus du grand nombre. Des individus en pagaille se donnent en pâture aux myriades de microdurées. De même que les microdurées sont dans l’air, imprègnent l’atmosphère et mettent de l’ambiance, les individus font nombre, saturent l’espace et infiltrent le temps. Après que la preuve a été administrée qu’on pouvait visionner des durées dans les salles obscures, on s’est ingénié à répandre des bris ou des éclats de temps, dehors et dedans, de jour comme de nuit. Cette fabrique de microdurées est maintenant à la portée de tous les esprits et de tous les portables. La publicité qui a beaucoup œuvré dans ce domaine, s’en est même fait une spécialité – affiche, logo, slogan, spot ou clip. Une spécialité que la démographie du grand nombre a vite adoptée et librement adaptée. Les top models ne sont pas les seuls à nous abreuver en spots en tout genre, les individus du grand nombre sont aussi devenus les hommes-sandwiches des microdurées. On a beau brasser les libertés, comme le droit de l’enfant et le droit à l’adoption, le droit au sexe et au logement, le droit à la poésie et à la philosophie, la liberté d’expression et la liberté de circulation, on n’est pas toujours assuré de pouvoir en user. En revanche, il nous est plus loisible de disposer des microdurées – éclats insignifiants, images fugitives, granulés de temps, paroles saisies au vol – que nous percevons, fabriquons ou enregistrons sans discontinuer. Et juste retour des choses, les microdurées bourdonnent aux oreilles des individus du grand nombre, qui n’entendent pas distinctement la voix de leurs semblables.
Notation et autoévaluation
En octobre 2008, on a montré du doigt les agences de notation qui avaient affirmé qu’il n’y avait rien à signaler, quand les banques étaient au bord de la faillite. Il a fallu une grande connivence entre les banques et les agences de notation pour que les contrôleurs n’y voient goutte. Le système éducatif français, basé quant à lui sur l’autoévaluation, ne reconnaît toujours pas qu’il est au bord de la banqueroute. Encore récemment, il persiste et signe et regarde comme des intrus le classement de Shanghai et les enquêtes internationales qui sont loin de lui accorder la première place. Voici un aspect de l’autoévaluation à la française, qui aboutit à des taux de réussite fantastiques au baccalauréat : lors des réunions d’harmonisation par discipline et lors des réunions de jury, on fait la chasse aux très mauvaises notes et aux moyennes des correcteurs les plus basses, considérant qu’elles doivent s’aligner sur l’honorable lot commun, mais on se garde surtout de faire de même pour les très bonnes notes ou les moyennes les plus hautes. C’est ainsi que grimpent d’année en année les notes attribuées aux élèves et les moyennes des correcteurs. Il y a comme un air de famille entre la prospérité des banques et les pétulants résultats des examens.
Brève et multiple
Une microdurée est un artefact temporel dont nous sommes le témoin, et éventuellement l’acteur et le spectateur. Artificielle, la microdurée s’apparente davantage à un montage rapide de plans cinématographiques qu’à un court laps de temps vécu. Au même titre que le temps filmique, la microdurée dure et ne s’évanouit pas comme le temps qui passe. La microdurée perdure doublement, parce qu’on peut la réactiver à tout moment et parce que le public universel s’en empare. La microdurée est une condensation temporelle intense et brève, une sorte d’expérience du temps en miniature. Certes chaque microdurée est unique, mais les microdurées singulières pullulent et éclosent à foison. Tandis que chaque microdurée chante en solo que la vie est brève et immortelle, le chœur innombrable des microdurées entonne la même ritournelle. Mais à ces microdurées matérielles viennent s’ajouter des microdurées subjectives et mentales. Car de même que nous pouvons nous repasser en pensée des microdurées artificielles, nous pouvons élaborer mentalement de nouvelles microdurées.
Un bel exemple de microdurée
On a pu entendre le 22 octobre 2008, relayé par les médias, un message posthume de sœur Emmanuelle, la riante et célèbre chiffonnière du Caire, qui venait de mourir deux jours auparavant quasi centenaire. Ce message bref, énoncé d’une voix enjouée et malicieuse, assurait aussi la promotion de son livre Les Confessions d’une religieuse, dont la sortie en librairie était prévue pour le 23 octobre : « Lorsque vous entendrez ce message, je ne serai plus là ! En racontant ma vie, toute ma vie, j’ai voulu témoigner que l’amour est plus fort que la mort. J’ai tout confessé le bien et le moins bien. Et je peux vous le dire, de là où je suis, la vie ne s’arrête jamais pour ceux qui savent aimer ! » Tout est microdurée dans ce message de sœur Emmanuel destiné à être diffusé après sa mort et à témoigner de l’existence d’une durée, car pour la religieuse « l’amour est plus fort que la mort » et « la vie ne s’arrête jamais pour ceux qui savent aimer ». Mais ce message atteste avant tout que « la vie ne s’arrête jamais » dans une microdurée.
La beauté convulsive
André Breton, dans L’Amour fou, a défini la « beauté convulsive » comme « érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle », décrivant ainsi les conditions d’apparition d’une durée automatique. Pour les surréalistes, le temps est secoué de convulsions. En effet, la nécessité n’excluant pas le hasard, le hasard peut croiser le désir. Soudain et simultanément, éros se révèle et la beauté voilée se dévoile. Cette coïncidence dans le temps du sujet et de l’objet du désir, cet instant explosif fixé à tout jamais, ces circonstances improbables et magiques, tout cela dépeint une durée automatique ou signale encore l’existence de durées magnétisées au gré du temps sans fil. Ces durées que les surréalistes ont vécues ou rêvées, la démocratie du grand nombre les a reproduites à nouveaux frais en fabriquant des microdurées aux pièces ou à la chaîne. À vrai dire, les individus du grand nombre n’ont pas eu à puiser dans le terreau surréaliste, ils se sont contentés de piller les bandes-annonces des films, les affiches ou les messages publicitaires et toutes ces musiques ou ces refrains qui nous trottent dans la tête.
Le tigre du Bengale
Une langue parlée ou écrite avance sur deux jambes, la grammaire et le vocabulaire. Privée de l’une de ses deux jambes, elle serait comme frappée de paralysie ou d’aphasie. Les images – dessins, peintures ou photographies – reposent sur deux principes, la ressemblance et l’invention. Privées de l’un des deux principes, les images restent toujours recevables. Pour être compris, les mots sont filtrés, tandis que les images sont reçues sans être nécessairement décodées. Les microdurées ne sont évidemment pas muettes, qui instillent à propos une parole ou une expression. Mais pour accaparer le plus grand nombre, les microdurées suivent la pente douce de l’image de préférence à l’escalier raide du langage. Cependant, une microdurée n’est pas du tout une image glacée ou figée, c’est un instant vivant de vérité – le feu de Bengale d’un tigre bondissant.
Événements et microdurées
Les historiens et les journalistes ont appelé événements toutes sortes de faits politiques, économiques, sociaux ou culturels, y compris les faits divers. Ces phénomènes collectifs et individuels, datés et observables, ne sont pas empiriques au sens strict du terme, car ils sont, pour une bonne part, construits par la pensée ou élaborés dans le cours du récit. Il n’empêche que, même s’ils sont difficiles à objectiver, les événements sont tenus pour des réalités significatives et marquantes de l’histoire d’une société. Ces indices temporels, dont l’historien dresse plus ou moins sérieusement l’inventaire, ont surtout pour vocation de surgir puis de disparaître. Les microdurées, en revanche, ne nous filent pas entre les doigts. Elles apparaissent et reparaissent, apparemment inchangées. Nous sentons-nous encore concernés par des événements qui ont du plomb dans l’aile ? Les individus du grand nombre se laissent emporter par un tourbillon de microdurées. Ils n’ont peut-être pas complètement perdu au change, ayant troqué contre des événements humains, trop humains, des cargaisons d’artefacts temporels flambant neufs.
Le prix Pulitzer refusé
Lors d’une conférence de presse, le 15 avril 1981, le directeur du Washington Post a annoncé que son journal se voyait obligé de refuser le prix Pulitzer attribué à sa collaboratrice Janet Cooke pour un article sur Jimmy, un petit héroïnomane de huit ans du ghetto noir de Washington, les faits invoqués dans l’article ayant été inventés de toutes pièces. Le directeur a présenté ses excuses au maire de Washington et a accepté la démission de la journaliste. Le 22 février 1982, le New York Times a reconnu avoir publié deux mois auparavant un faux reportage sur le Cambodge, dans lequel le journaliste indépendant Christopher Jones avait affirmé avoir retrouvé la trace de Pol Pot, l’ancien chef des Khmers rouges. Un journaliste du Village Voice avait pu déceler la supercherie en s’apercevant qu’une partie du reportage était un plagiat de La Voie royale, le roman d’André Malraux. On le voit, au cours de leur travail, il incombe aux journalistes et aux historiens de recourir à des sources fiables. Il en va autrement pour les microdurées, dont le but avoué est moins de traquer une réalité documentée que d’élaborer et de mettre en scène des éclats temporels sidérants ou séduisants.
Vidéo, photo, texto
Tandis que les microdurées ingèrent sans complexe les data du présent, l’art contemporain s’amuse à parodier feu le scandale Dada et à brandir divers fichiers ou documents paraphrasant le monde actuel. En fait, les aiguilles de l’art contemporain et celles des microdurées tournent en sens inverse. Autant les microdurées font flèche de tout bois et se laissent porter par la fiction, l’imagination ou même l’invraisemblance, autant l’art contemporain prend les choses à la lettre, a des réflexes véristes et ajoute foi aux procédés de simple reproduction ou aux objets en tant que tels. Les artistes d’aujourd’hui exposent des pelles et des seaux, des photos et des vidéos, ou des messages en langage texto, alors que le public universel ne les a pas attendus pour avoir une pratique des seaux, de la vidéo ou du texto. À peu de choses près, l’art contemporain ne fait que remplir ou desservir les rayons d’un vaste magasin de jouets mimant la réalité. Pendant ce temps, les individus du grand nombre s’empiffrent de microdurées fraîches ou confites.
Le cri primal des démographes
Sous un visage de bébé aux yeux bleus, « Non, la natalité ne se redresse pas ! / S.O.S. BÉBÉS / Le cri d’alarme des démographes », ce titre s’étale sur la couverture du Figaro magazine du 17 février 1996. Après l’annonce par l’Insee de vingt mille naissances supplémentaires en France en 1995, cinq spécialistes, pour la plupart démographes, estiment que décidément le compte n’y est pas. Pour eux, la vérité est qu’il faut absolument redresser la natalité. En tête du quintette, Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne, affirme dans son article « Crise des naissances, crise de l’emploi », que le chômage monte quand la natalité baisse : « Les enfants obligent la société à les accueillir, à satisfaire leurs besoins ; ils sont créateurs d’emplois. Et quand le déficit des naissances atteint comme en France 2 500 000 en vingt ans, c’est autant de personnes qui n’ont rien demandé ni aux fabricants de chaussures ou de vêtements d’enfants, ni aux fabricants d’équipements de chambres d’enfants, ni aux producteurs de lait… / Au contraire, il a fallu supprimer des emplois partout où les activités ont été touchées : chaussures, bonneterie, bâtiment ; sans oublier les fermetures d’école qui provoquent des dépenses accrues de transport scolaire, ou les subventions qu’il faut verser à des agriculteurs pour des consommateurs qui ne sont pas nés. » Plus il y a d’enfants, plus on crée d’emplois, tel est le credo nataliste, à l’heure où l’école pourtant n’a jamais accueilli autant d’enfants. On se dit, en entendant cette antienne, que l’Afrique ou le territoire de Gaza devraient être les champions du monde en bonneterie ou en laiterie et des modèles de plein emploi. Mais, comme le souligne Le Figaro magazine, en oubliant curieusement le Front national, tout le monde s’accorde de la gauche à la droite et de la droite à la gauche, sur une politique nataliste et familiale. Et de citer un propos du premier ministre Michel Rocard du 20 janvier 1989 : « La plupart des États d’Europe sont en train de se suicider, de se suicider par la démographie, sans même en avoir conscience. » Un autre de François Mitterrand dans sa Lettre à tous les Français du 8 avril 1988 : « Les générations nombreuses sont des générations créatrices. Or, nous sommes pauvres d’enfants dans une Europe plus pauvre encore. » Un autre encore de Jacques Chirac, du 17 février 1995, à la Porte de Versailles : « […] l’on ne peut se résigner à la chute de notre natalité, qui fait peser une lourde menace sur l’équilibre de nos comptes sociaux, et, à terme, sur le dynamisme de notre pays. » En résumé, il y a unanimité parmi les démographes et les politiques, tous prescripteurs de nouveau-nés. En 1996, en 1988, comme en 2011.
Petits cercles et brouhaha
Il n’y a de science que du général, disait Aristote. La science, en effet, est à la recherche de lois ou de formules universelles, et cela en accord avec la raison qui est en chacun de nous. Cependant, tout au long de l’histoire des sciences et de la philosophie, seuls quelques cercles restreints de savants et de penseurs ont participé à cette aventure et ont vivifié les savoirs. Le grand nombre n’a jamais pu juger directement ni de la valeur ni de la rigueur des connaissances en question. Les non-initiés ont salué avec déférence la science tant que l’école et les médias la vulgarisaient ou en donnaient une image flatteuse et tant que les innovations techniques leur facilitaient la vie. Mais les médias et l’école, qui ont à présent d’autres chats à fouetter, ne sont plus les hérauts de la science. Quant à la quincaillerie technique ou informatique actuelle, nul ne sait si elle sert ou si elle dessert. D’où deux configurations possibles pour la suite des opérations scientifiques et philosophiques. Ou bien une aristocratie des sciences et de la pensée, forte de ses connaissances synthétiques et de ses découvertes, réussira à se faire entendre de larges cercles de néophytes, en particulier parmi les enseignants, dans l’espoir de ne pas être coupée des individus du grand nombre. Ou bien, des bataillons d’apprentis chercheurs et d’apprentis penseurs, qui tantôt se fédéreront et tantôt se disputeront le terrain, amasseront à l’aveuglette un maigre butin, jusqu’à mettre en péril leur discipline et la transmission des savoirs. En fait, la seconde configuration est déjà à l’œuvre. Mêlés aux dizaines de milliers d’experts et de chercheurs patentés, les rares individualités perspicaces ou créatrices perçoivent de moins en moins leur voix dans cet immense brouhaha.
La déconfiture des sciences humaines
Les fort nombreux spécialistes en sciences de l’homme ont à ce point perdu le goût de l’objectivité ou le sens de la critique que, quand ils prononcent les expressions « sciences humaines » ou « sciences sociales », l’adjectif leur importe plus que le substantif. Les sciences humaines ne portent pas, selon eux, sur l’homme mais sur l’humanité ou la bonté inhérente aux femmes et aux hommes. Les sciences sociales n’ont pas pour objet la société mais la sociabilité et la solidarité entre les membres d’une société et entre tous les membres de la communauté universelle. À leurs yeux, les sciences de l’homme ne sont pas neutres mais morales, militantes et politiques. Les descriptions et les enquêtes, les statistiques et les évaluations ne tendent à rien d’autre qu’à souligner ce qui s’accorde avec ce message ou à indiquer les remèdes à appliquer de toute urgence quand la situation s’écarte un peu trop dangereusement des normes d’humanité ou de solidarité. Ce catéchisme imprimé sur des millions et des millions de pages provenant de dizaines et de dizaines de milliers de rapports ou d’ouvrages, baptisés pompeusement « travaux scientifiques », attend encore d’être dépouillé par un de ces logiciels à venir qui aura vite fait d’en faire le tour et d’en délivrer l’algorithme.
Un cortège de microdurées
Voilà des années que les lois mémorielles pressent les historiens de réécrire le passé et de regarder le présent à la lumière des idées obsessionnelles de génocide, de colonialisme ou d’esclavage (l’exploitation du prolétariat étant tenue de nos jours pour quantité négligeable). Si de nombreux historiens, lucides et fermes, essaient de mettre le holà aux injonctions extravagantes du moralisme victimaire, ils n’ont cependant pas conscience qu’ils subissent d’autres assauts beaucoup plus formidables. Les sondeurs d’archives ne voient pas que dans la vie courante ils sont submergés par des microdurées, qui se présentent en grande pompe et n’ont rien à cacher, quand les faits historiques pointent leur nez et aussitôt se dérobent. De même, habitués qu’ils sont à la constitution solide des phénomènes structurels ou à la réalité éclatante des phénomènes conjoncturels, les déchiffreurs de documents ne saisissent pas la nature fictive ou l’impertinente irréalité des microdurées. Enfin, suprême insolence pour des experts en datation, ces artefacts immatériels, ou presque, modélisent à ravir le processus temporel. Les historiens peuvent certes poursuivre leurs travaux, comme si de rien n’était, comme s’il ne s’était produit aucun changement de paradigme temporel. Le fait est qu’ils ne disposent plus de la boîte à outils adéquate pour appréhender le temps sans fil et son cortège de microdurées.
Je suis, j’existe dans la microdurée
Le temps innerve mes actions, mes paroles, mes pensées. La mémoire et l’imagination, qui me transportent dans le passé ou le futur, sont inséparables du temps. Plus encore, ma subjectivité et mon sentiment de l’existence sont inhérents au temps. Je suis, j’existe dans le temps. Le philosophe Bergson a ajouté à tout cela une précieuse indication : le temps ne me file pas entre les doigts, j’attends que le sucre fonde, mon intuition du temps est celle d’un temps qui dure. Cela a ouvert la voie aux durées filmiques des frères Lumière et de Hollywood. Et à présent, de manière plus démocratique et acrobatique, les individus du grand nombre fabriquent, émettent ou consomment des foultitudes de microdurées. Grâce à ces artefacts de l’immatériel, nous concevons, modelons et enregistrons à notre guise le réel et l’imaginaire, le sensible et l’intelligible, l’individuel et l’universel. Ces médiations temporelles ne sont pas spécialement des écrans de fumée, des spectacles affriolants ou des élaborations virtuelles qui s’interposent entre moi et autrui, entre le genre humain et la nature, ce sont les nouvelles formes d’approche de l’histoire collective et de l’existence personnelle.
« L’épouvantail de la mort »
Contrairement à l’événement, qui est décrit ou rapporté avec un minimum de sens commun ou de sens critique, la microdurée ne tient pas compte de l’idée de vérité et ne s’accorde pas non plus avec la réalité. Sa fabrication, à l’aide de divers équipements, appareils et outils, est inséparable d’une visée esthétique. La mise en œuvre technique se double d’une performance artistique. Lors de sa réception, la microdurée accapare l’attention et se voit ainsi délivrer un certificat d’existence. Il faut lever ici un doute. La microdurée ne se situe pas, comme le rêve, de l’autre côté du miroir, comme le roman, dans le registre de la fiction, comme le spectacle, sur la scène théâtrale, comme les nouvelles ou les reportages, dans l’espace journalistique ou médiatique, elle est un objet temporel à part entière qui conjoint le sujet et l’objet, la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas. Elle réalise à moindres frais le projet surréaliste de dépasser les antinomies factices de la pensée dualiste. André Breton, en effet, se demandait, dans le Second manifeste du surréalisme, comment se prémunir contre une série de représentations fantasmatiques concernant la mort, l’au-delà, le sommeil, l’avenir, le langage, le miroir ou l’argent : « L’épouvantail de la mort, les cafés chantants de l’au-delà, le naufrage de la plus belle raison dans le sommeil, l’écrasant rideau de l’avenir, les tours de Babel, les miroirs d’inconsistance, l’infranchissable mur d’argent éclaboussé de cervelle, ces images trop saisissantes de la catastrophe humaine ne sont peut-être que des images. » Il est possible que la découverte du hasard objectif et des durées automatiques ait alors permis aux surréalistes de traquer quelques idées douteuses. Mais aujourd’hui peut-on en dire de même pour les familiers des microdurées ? Il ne le semble pas. La fréquentation assidue des microdurées n’immunise pas contre les idées fumeuses, elle accroîtrait plutôt la propension à fantasmer, à délirer et à accueillir toutes sortes de contrevérités.
Le cinéma et les microdurées
Le public universel s’est approprié le temps artificiel dans les salles obscures. En visionnant des films au cours de séances d’une heure trente et plus, il a acquis la maîtrise de l’objet temporel, objet métaphysique par excellence. Toutefois, il ne lui est jamais venu à l’esprit de prendre cette matière temporelle pour du réel ou un ersatz de réel. Il a même plutôt compris qu’il y avait dans le montage des durées filmiques autant de transformations du réel que de variations sur le réel. En intuitionnant des durées filmiques, le spectateur universel ne replonge pas dans l’expérience ordinaire, réaliste ou familière, mais s’accapare l’ébauche, le profil ou la silhouette d’un monde reconstruit. Il découvre notamment l’existence d’une relation nécessaire entre le document de la fiction et la fiction du document. Car, de même qu’un film de fiction a une forte valeur documentaire, un film documentaire se nourrit autant de fictions que de frictions. Légataire des durées cinématographiques, l’individu du grand nombre est en principe immunisé contre la confusion des microdurées avec la réalité. Pourtant il lui arrive fréquemment de s’empêtrer et de prendre la réalité pour une microdurée et la microdurée pour de la réalité. Trois raisons au moins à cela : 1. l’individu du grand nombre passe beaucoup de temps à manier ou à réceptionner des microdurées, ce qui l’accoutume à penser qu’il nage en pleine réalité ; 2. la microdurée est devenue le mode d’approche privilégié du réel ; 3. les innombrables témoignages ou confidences enregistrés, sans compter la vidéosurveillance et le téléphone portable, finissent par convaincre que les microdurées sont des plages ou des archives de réalité alors qu’elles sont avant tout un artifice ou une reconstruction du réel.
La trinité triomphante
Depuis longtemps on mène la chasse aux préjugés et on considère l’école comme le terrain propice pour batailler sans relâche contre les stupides et insupportables préjugés. En France, de 1968 à 2011, deux générations entières sont passées par l’école ou même ont vécu à l’école. On aurait dû dès lors assister à l’extinction de la plupart des préjugés. S’il y avait eu des préjugés chez les enfants ou les adolescents qui se sont succédé depuis plus de quarante ans dans l’enceinte scolaire, il ne devrait plus y en avoir du tout, les enseignants ayant prescrit et administré aux chérubins ou à leurs copains les potions et remèdes adéquats. Pourtant aujourd’hui, nul ne semble vraiment satisfait du résultat. C’est pourquoi il semble qu’il faille mettre en doute la vieille idée selon laquelle l’école est le lieu où l’on combat et l’on réduit les préjugés pour lui préférer cette autre idée plus réaliste : l’école, au même titre que les médias, l’espace privé ou l’espace public, est un foyer intense de préjugés, voire même l’un des foyers les plus intenses de préjugés. Nous appellerons « délire » ou « préjugé » un sentiment persistant et un discours bien rôdé qui contrecarrent des réalités avérées. Voici une série de faits patents couvrant une période de cinquante ans : 1. encore relativement dominées par les hommes en 1960, les femmes sont en position relativement dominante en 2011 ; d’une part, elles maintiennent leur ancienne avance sur la gent masculine, en vivant plus longtemps, en se suicidant beaucoup moins et en n’encombrant pas les prisons ; d’autre part, tirant profit de leurs études, les filles sont plus diplômées que les garçons ; 2. pendant que l’antisémitisme se résorbait peu à peu, une immigration importante maghrébine et africaine, essentiellement musulmane, s’est d’autant plus développée que cela apportait aux nouveaux arrivants en France de substantiels avantages économiques et sociaux, avec en outre, cerise sur le gâteau, la possibilité de vivre dans un pays modérément xénophobe et marginalement raciste ; 3. la libération des mœurs a été telle durant cette période que l’avortement a été légalisé et que l’homosexualité a fait une entrée fracassante dans l’espace public et dans les médias. En résumé, ces cinquante dernières années ont vu prospérer la condition des femmes, ont vu affluer des immigrés dont la situation initiale s’est améliorée, ont vu une quasi-officialisation des pratiques sexuelles les plus diverses. Il est à remarquer qu’en occupant le devant de la scène, cette trinité triomphante – femmes, immigrés et homosexuels – a signalé à elle seule que le prolétariat n’était plus de saison, particulièrement aux yeux des médias, des partis de gauche et même des syndicats. En tout cas, durant cette période, si le prolétariat a de moins en moins compté c’est dans doute parce que le niveau de vie de la majorité des ouvriers, des employés ou des petits paysans est resté honorable ou stable et qu’il n’était surtout pas question de prêter attention aux autres prolétaires sombrant dans le chômage et vivant d’expédients. D’ailleurs plutôt que de manifester une quelconque solidarité avec les prolétaires les plus démunis, l’humanitarisme ambiant a fait le choix d’honorer les SDF, paumés parmi les paumés, à la personnalité déstructurée, qui pour la plupart, soit dit en passant, appartiennent au genre masculin et non féminin.
Le préjugé de l’école
Depuis les années 1980, toute la doxa scolaire tourne autour des droits de l’homme ou plus précisément porte au pinacle l’antiracisme. C’est là le principal préjugé ou le délire numéro un véhiculé par l’institution scolaire et universitaire. Alors que dans les faits l’antisémitisme était en voie de résorption et que le racisme demeurait résiduel en France, l’école a inventé de toutes pièces un diable ou un spectre raciste menaçant les bases de la société et la paix universelle. Or, grande sera la surprise de tous – parents, enseignants et élèves –, quand ils découvriront – phénomène encore impensable dans les années 1970 – que la violence pouvait éclater sur les lieux mêmes réservés à l’étude. Tandis que le chœur des enseignants prêchait l’antiracisme, le feu couvait à l’école. Pendant que le corps professoral entraînait des bataillons d’élèves sur la voie de la concorde, l’indiscipline s’installait dans les classes. Comment expliquer cette concomitance du prêche antiraciste et de la violence à l’école ? Les professeurs ont-ils répandu cet écran de fumée pour ne pas regarder en face les difficultés inhérentes à l’enseignement de masse ? En distinguant la cause antiraciste, objet de tous leurs soins, de l’acquisition des connaissances, objet devenu accessoire, ont-ils voulu se convaincre de la supériorité de la morale sur la littérature et les sciences ? Le problème est qu’entre-temps ils ont essuyé un double échec, tant sur le terrain moral que dans la transmission des savoirs. Au lieu d’instaurer la fraternité, ils ont laissé s’installer l’insécurité, tout particulièrement dans les zones d’éducation prioritaire. Quant au goût pour l’étude, chez la plupart des élèves, il arrive désormais bon dernier, loin derrière l’ostentation et la frime, la rivalité et la brutalité, la frénésie pour ce qui est immédiat et en vogue.
Le préjugé des médias
Rivalisant avec la croisade antiraciste de l’école, les médias et la publicité réunis se sont faits les champions de la libéralisation des mœurs. Alors que Mai 68 était déjà passé par-là, que le mariage se disloquait sous la double pression du divorce et du concubinage, que le sentiment national était battu en brèche, que la cellule familiale se rétrécissait, que les voyages en avion devenaient légion, que les produits importés faisaient la nique à ceux du terroir, que les psychanalystes ne reconnaissaient plus les névroses d’antan vu que le défoulement avait remplacé le refoulement, alors donc que le kit de l’expérimentation sexuelle ou bien du parfait drogué était mis à la portée de chacun, les médias se sont cru autorisés à parrainer la fête libertaire qui battait son plein et à proclamer qu’il y avait néanmoins de la répression dans l’air. Plus précisément, selon les médias, un vent mauvais s’acharnait sur les homosexuels, un œil mauvais les persécutait spécialement. Il est nécessaire de rappeler qu’après mai 1968 les homosexuels n’étaient pas en reste parmi ceux qui s’exerçaient à batifoler ou à jouir sans entrave, même si cette libération des corps et des désirs allait bientôt se heurter à la maladie du sida. En dépit de l’irrésistible ascension des homosexuels et de leur acceptation bon enfant dans presque tous les milieux de la société, voilà trente ans que les médias ont décrété une fois pour toutes qu’il était urgent de mener une traque permanente contre une homophobie inexistante. Et face à une homophobie virulente et récente, cela leur permet de repasser ce même disque usé sans remarquer qu’il s’agit d’un phénomène importé.
Le préjugé des hommes politiques
Voilà aussi trente ans que les hommes politiques sont raillés par l’opinion publique et bénéficient d’une image désastreuse. En réalité, le suffrage universel actuel ne se soucie guère de choisir entre la droite et la gauche, ni de séparer le bon grain de l’ivraie, ni de placer les meilleurs citoyens aux commandes du pays. Il importe peu aux électeurs de voter pour des caractères enjôleurs ou réservés, des personnalités machiavéliques ou rigolotes, des individus suffisants ou insignifiants. Le corps électoral a comme la prescience que tous les élus le représenteront également et qu’aucun ne fera vraiment l’affaire. Plongés dans un tel pétrin, les hommes politiques se sont alors dits que s’ils seraient moins moqués et gagneraient au moins un moment de répit s’ils avaient des femmes politiques à leurs côtés. D’où l’idée d’imposer la parité entre les hommes et les femmes lors des scrutins électoraux. La classe politique a réussi à répandre, ou plutôt à vendre, le préjugé grossier selon lequel les femmes seraient encore aujourd’hui privées de pouvoir dans une société dominée par des mâles. Un cadeau empoisonné que des femmes opportunistes ou féministes se sont empressées d’accepter.
Trois préjugés copiés et collés
Les délires se répandent vite pendant la grande marée des microdurées. Les enseignants français croient être les seuls inventeurs et détenteurs du brevet antiraciste. En fait, ils ont importé le produit des États-Unis, à l’époque où les Américains étaient encore loin d’avoir réglé leur problème racial. Les médias et les hommes politiques français pensent avoir fait œuvre originale, alors qu’ils se sont inspirés des gays américains et des féministes américaines pour fourbir leurs armes contre une soi-disant homophobie ou contre une prétendue discrimination à l’égard des femmes aspirant à tenir les rênes du pouvoir. L’amusant de l’histoire est que les trois préjugés, de l’école, des médias et des hommes politiques, ont été piqués aux Américains durant la longue période où les professeurs professaient un antiaméricanisme de choc, où les médias médisaient des États-Unis et où les hommes politiques dénonçaient l’Empire américain.
Georges Sebbag
Références
« Des essaims de microdurées » est le chapitre VIII de Microdurées, éditions de la Différence, 2012.