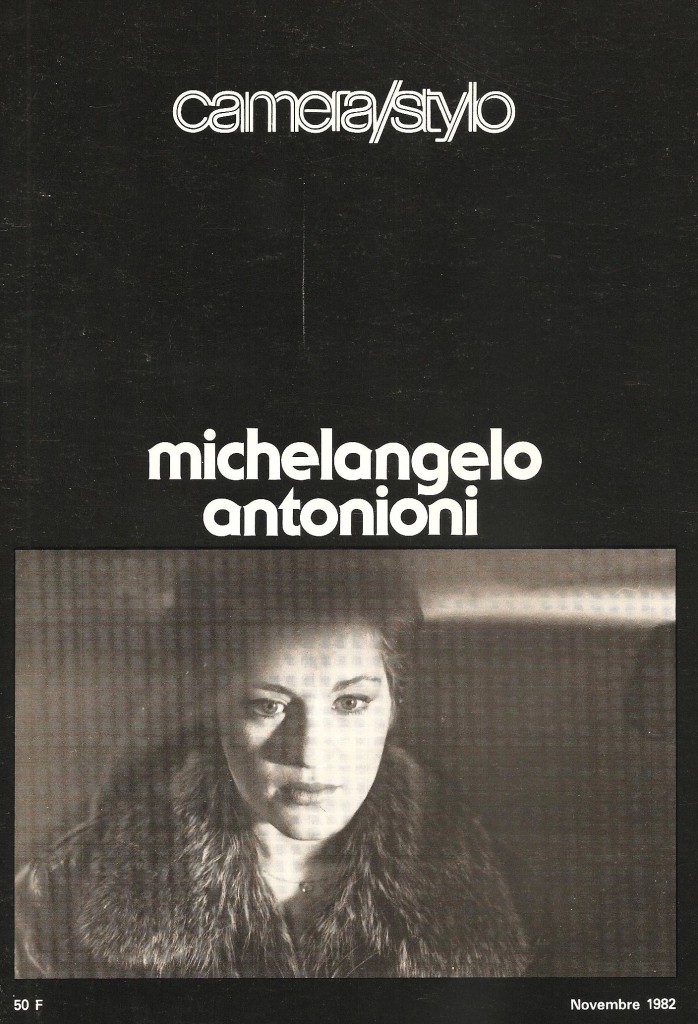
Michelangelo Antonioni est un peintre de l’indifférence dans Le Désert rouge. En sa méthodique exposition, les nuances du flou de l’indifférence convergent et nous enveloppent déjà de leur teneur trouble et dense ; le spectateur est invité, tenu à l’écart aussi, alors que les personnages du film traduisent à l’avance ce recul et cette belle fascination. La question fondamentale est posée : jusqu’à quel point est détaché de son œuvre, le réalisateur ? En effet, face à la systématique neutralité du spectateur et de l’acteur, la voix narratrice tend à s’effacer et plus exactement, dans le cadre cinématographique, une vision narrative s’impose – dont les caractères sont l’oubli, l’impersonnalité et la blancheur d’un silence.
Les natures mortes monochromes
Le gris du générique est une annonce inquiète, au travers des couches transparentes et indécises, des brumes entremêlant les machines industrieuses et les lancinants navires. Tel est le voile optique, filet jeté sur les choses et les gens ! Parce qu’il est possible d’avantager les premiers plans en confondant les arrière-mondes, d’enchaîner les fondus, de maintenir des écorces translucides et parfois de suggérer des espaces invisibles, les matières les plus apparentes reflètent l’univers équivoque de la surface et nous initient au jeu esthétique des plans infinis et recommencés. Le thème du voile dégagé, l’indifférence se colorie comme dans ces troublants jets de feu – crachats d’une haute cheminée – qui s’étiolent et se renouvellent sur le bleu uniforme du ciel. Viennent ensuite, dans un passage grisâtre, les capes de verre revêtues par des grévistes, imperméables de quatre sous posés en cloche – transparence et immanence des revêtements parallèles. En attente de pluie (élément suspendu, verticalité tranchante), Giuliana, axe de référence – du tournage aux détours du film –, pivot flottant comme un gyroscope, déséquilibre la notion d’héroïne, dès son apparition : le vert du manteau appelle l’impersonnel. Et lorsqu’elle se perd, aux abords des déchets d’artifice, du gris métallique du paysage, la terre et les feuillages disent le triste verdict, bientôt la monotone sentence : l’homme et la nature sont morts (Dieu étant bien loin derrière) ; parce que cela ne signifie ni l’anéantissement ni le noircissement des choses, mais le gris coloré de l’indifférence, une vie mortelle s’engage. En premier lieu, l’intrusion dans une usine signale le bleu, le vert plaqués sur d’immenses réservoirs, artifice poussé jusqu’au vernis : les tuyaux sont enduits d’une couche protectrice, et du coup l’esthétique enveloppante de la neutralité les touche ; du rouge jaune au gris-bleu, les monochromies s’installent en plans juxtaposés ou sédimentés. Que le rouge rouille émane d’une gigantesque cuve témoigne de l’imprégnation des couleurs, que l’on croyait plaquées : les structures d’extériorité deviennent vite naturelles. Si nous jetons un coup d’œil d’ensemble sur les bâtiments, aucun doute, le gris du béton domine. Un étrange spectacle s’offre à nous, de la fumée gagne peu à peu les tonneaux peints en rouge entreposés dans la cour, envahit démesurément le champ visuel, l’occupe entièrement : le flou de l’indifférence est entré en action jusqu’à ne plus former qu’un brouillard monochrome, en dissipant formes et contours grâce au gris de l’absence de vision (ou de la présence de toute vision possible) ; bref, la limite d’une esthétique de l’indifférence est atteinte : le flou, le voile, les reflets, les plans infinis se rejoignent en quelque sorte. Là, le ciel participe effectivement à cet évanouissement du paysage, à l’habile construction des masques, puisque, de la fumée au gris du ciel, une même couche s’interpose entre nous et le monde, et finit par constituer la seule réalité visible.

La boutique de Giuliana aux murs fraîchement peints est une interrogation sur la couleur : bleu ou vert ? En somme, une expérimentation des couches colorées accompagne l’expérience quotidienne de la coloration du réel. Et la rue où se trouve ce surprenant magasin, vide d’objets, avide de couleurs (comme s’il était destiné à ne jamais accueillir des formes étrangères à la géométrie plane et ascétique des murs, à ne jamais tolérer les tons provocants – débordant l’aquarelle enfantine) nous projette dans le lieu le plus monochrome qui soit, nous situe d’emblée dans la nature morte : les maisons, des deux côtés de l’étroite chaussée, semblent se rejoindre, tant est légère la mise en relief des surfaces ; un vert blanchâtre, témoin de l’écaillement des superficies (et de l’effritement plus intérieur), indique la pâle et douce monochromie de la rue déserte et fantomatique. Pourtant un élément bougé se manifeste : le vent tombe et avec lui une feuille de journal – épisode marqué d’abord par la force d’inertie du vent (autre souffle ou plan invisible), ensuite par l’insolite banalité du geste de Giuliana (plaquant le papier) : journal intime en même temps froissé et défroissé par le hasard, la distraite immobilité puis la marche capricieuse et impérative d’un homme et d’une femme qui s’échappent, glissent et volettent dans le vide absolu de la rue. La chaux a saisi au vif les murs, mais aussi l’étalage du marchand de quatre saisons, assis comme un peintre perdu dans le lointain d’un rêve et attentif à quelque tableau : une baguette à la main lui sert de pinceau. De toute évidence, les légumes ou les fruits (cela n’a déjà plus d’importance) qu’il vend représentent une belle nature morte, traitée à l’étincelante monochromie du blanchâtre ; inutile de faire appel à Cézanne ou à tel autre, il demeure qu’Antonioni a réservé dans cette fameuse rue un coin de nature morte où un autoportrait de peintre participe de cette vie immobile et silencieuse. Après la vision tranquille, les touches de l’indifférence se servent d’autres techniques. Ainsi, dans une scène de marché où le bruit brouille les significations, le procédé du voilement est employé : un simple flou enveloppe les passants, on évalue toutefois les différents niveaux d’importance (le poissonnier, Giuliana et Corrado, les autres : une stratification translucide). De même les zones homogènes d’un gazon vert pâle, les éclaboussures roses de fleurs en avant-plan, la porte en verre opaque posent progressivement les jalons d’un espace esthétique de l’indifférence. Faut-il s’en tenir à l’espace ? Nous le pensons ; pourtant les données d’une clinique de l’indifférence existent : Giuliana parle d’une femme qui voulait tout (nous reconnaissons là l’irrésolution dans le désir absolu), qui sentait le sol se dérober sous elle – de plus, impressions de glisser et de se noyer (le flottement et le glissement des plans psychologiques de l’indifférence entrent en jeu) –, et qui s’interrogeait quasi métaphysiquement sur son être (“qui suis-je ?” c’est un des symptômes du sentiment du vide) ; cette femme, c’est bien entendu Giuliana. Parce que l’indifférence signifie absence de sentiment, il est vain dans ce cas précis d’épiloguer sur la clinique. Et l’espace reprend ses droits, d’abord parce qu’il s’étale jusqu’à l’infini : nous sommes en pays de plaine et d’océan, la Nature est nivelée. Se dressent des constructions d’artifice, des grilles rouge minium et surtout des charpentes métalliques qui écoutent les étoiles – le ciel est un autre grand espace : la vision de ces charpentes chauffées à blanc sur le ciel gris blanchâtre est un signe unique d’une indifférence frappée dans le métal ; le terne éclat du métallique étend sa blancheur à la grisaille de la voûte céleste. Après cette apparition d’un décor à l’emporte-pièce et monochrome, la rase campagne nous accueille, avec ses eaux stagnantes : les résidus industriels amorcent une décomposition des éléments naturels ; le mari, la femme et le futur amant se promènent nonchalamment, comme s’ils ressentaient la lente dissolution de la nature, dont les espaces exigeraient alors une contemplation perpétuelle ; ils se tiennent parfois immobiles, leurs gestes sont ralentis : l’espace a un pouvoir de pétrification : c’est un des moments où ils se figent le plus aisément. Quand Corrado, questionné sur le thème de la politique, parle de sa croyance en le progrès (entre autres choses), une fois encore les données du langage ou de la psychologie des personnages nous paraissent vides : seul compte le spectacle esthétique des espaces indifférents.
Le vaisseau fantôme du vert paradis
L’apparition silencieuse et majestueuse d’un navire, à l’écran, nous plonge dans l’attente démesurée des indifférences : la brume recouvre l’alignement des arbres, un bateau glisse doucement en une forêt enchantée. Dans l’entrelacs du voilé et du glissement, bref dans ce flottement, se concentre l’indifférence, dont les plans parallèles sont déterminables (les arbres, la brume, le navire, et même les appels de sirène). Après les étangs glacés, nous rencontrons la baraque de Max, maquillée de peinture, comme environnée par la mer (guettée par l’océan, toute habitation semble une île). L’eau et la brume se rejoignent pour estomper et rendre incertaine la terre ferme. De plus, regardons de l’intérieur de la baraque la fenêtre : nous voyons passer, en un souple et souverain mouvement, un navire, sur la coque duquel luit un nom[1]. Ce tableau flou et huilé est complété par une fresque, cette fois contemplée de l’extérieur de la maison en bois : la tête de Giuliana s’imprime sur la fenêtre qui forme comme un cadre dans lequel est insérée une photographie (le visage de Giuliana semble tout de surface, coloré dans un grain flou de photo bougée ; en somme, le plan de son visage est réduit à une géométrie à deux dimensions, convenant parfaitement à la structure des carreaux de la fenêtre – plan parallèle et transparent) et qui fait partie du mur de planches extérieur ; la baraque, vue de dehors, s’étale comme une fresque dans laquelle Giuliana se masque et se démasque, en prêtant son visage et ses couleurs aux teintes d’artifice, déposées par l’homme et le temps sur cette cloison de bois : l’espace de l’indifférence a figé la figure humaine dans un beau voile aux tons monochromes. Mais, nous dira-t-on, pourquoi escamoter les scènes qui racontent la vie même des personnages ? C’est qu’il est dangereux de se fier à une contingence fragmentaire et superficielle : la parole et la conduite, en l’occurrence, manifestent un creux, que seules des élaborations inconscientes (comme les espaces indifférents que nous tentons de dévoiler) peuvent combler. Cependant il semble judicieux d’emprunter à la conversation entre Giuliana et Corrado la question sur laquelle nous butons continuellement : “regarder, quoi ?” Le regard glisse sur tout et ne s’attache à rien, comme si un écart absolu entre les couches de l’indifférence empêchait toute fixation. Dans le même ordre d’idée, le cri, signal du départ précipité, est à interpréter (une hypothèse : le cri rappelle celui poussé par le nouveau-né ; de ce fait, si on a crié – sinon le cri a été imaginé et nos explications s’orienteraient du côté des fantasmes –, c’est certainement à l’extérieur de la baraque ; cette dernière symbolisant le fœtus et l’océan, le milieu liquide – dans lequel il flotte –, le cri est ce qui, dehors, appelle à la vie, à une certaine angoisse, mais aussi accompagne notre indifférence, qui est cependant à mettre en relation avec l’atmosphère tiède et indifférenciée du milieu utérin. Une autre hypothèse : le cri ramasse le bruitage de notre civilisation ; il est notre bande sonore). Il est aussi essentiel que le cri de détresse poussé par l’homme supérieur et qui fait sortir de sa caverne Zarathoustra ; or, c’est le devin, prophète de la grande lassitude, c’est-à-dire de l’indifférence, qui fait écouter à Zarathoustra le cri ; qui crie ? L’homme supérieur (ou plutôt les hommes supérieurs) : il est de notre temps, il vit le nihilisme, il traduit éminemment les forces réactives. Le cri nietzschéen et le cri dans Le Désert rouge appartiennent à la même clameur qui dit le malheur et le déchirement, mais surtout nous désigne l’empire de l’indifférence : “le désert grandit : malheur à celui qui recèle un désert”[2]. L’indifférence totale ne crie plus, elle demeure muette : notre existence vogue entre le sentiment du vide et l’état de vide (qu’elle atteint rarement) ; encore en possession de la parole, traquée par le silence, Giuliana finit par se perdre dans le brouillard : premièrement les autres s’immobilisent devant elle, la brume efface leur image (Giuliana semble être à l’origine de ces disparitions, comme si son désir était tel) et deuxièmement elle s’enfuit dans l’espace illimité d’une terre ferme alliée à la mer, et dont le rivage ne doit pas constituer une coupure, mais un pont ou une jetée sur l’océan ; les êtres réduits par le regard angoissé de Giuliana à la fonction d’une image, d’un schème ou d’un support de l’indifférence (les couches parallèles) se diluent aussi dans le flottement et le flou de l’indifférence.
Que le fils de Giuliana remarque qu’une goutte ajoutée à une autre donne une espèce d’unité (1 + 1 = 2 ?), cela nous intéresse au plus haut point : la notion d’indifférencié n’est pas loin. C’est pourquoi nous nous contenterons d’élaguer les séquences et de retenir certains signes annonciateurs d’une sémiologie de l’indifférence (étape dans une typologie et une généalogie nietzschéennes). Qu’un des lieux privilégiés du Désert rouge soit une île flottante, voilà qui nous ramène dans le nulle part des espaces indifférents, dans ce bercement mythique d’une barque au milieu de l’océan ; si nous suivons Corrado dans son hangar désaffecté, nous sommes frappés par l’amoncellement de paniers vides : la répétition des objets est un symptôme de l’inerte, c’est-à-dire de l’infinie juxtaposition du même (et paradoxalement de la différence) ; l’inerte est alors un espace indifférent, ou, si l’on préfère, une objectivation, une réification. Les murs blancs sont à un certain endroit frappés d’une gouttière bleue – long rectangle de peinture qui se divise, après un panoramique, en deux branches : la peinture en bâtiment rejoint alors les placages optiques (agrandissement, uniformisation, trompe-l’œil) du pop art. Quand nous sortons du hangar, une répétition analogue (à la précédente) nous saisit : des cloches ou ballons de verre se succèdent ; l’espace de l’indifférence (ici, à travers la répétition) miroite dans de vertes enveloppes de verre. Jusque dans la maison de Giuliana, le glissement des couches parallèles est visible : les apparitions de navires à travers une fenêtre horizontalement oblongue, nous initient à un glissement de panorama ; la douceur de l’océan, la permanence des masses flottantes sont la garantie d’une présence fluide, propice à tous les frôlements des indifférences. Mais dans quel monde sommes-nous, sur cette plage rose où tout chante ? Le moderne a décollé, la Nature nous est restituée (si une telle Nature existe), bref nous sommes au paradis[3]. Une esthétique appropriée est alors utilisée ; la vie de la Nature, est-ce la mort de l’indifférence ? Nous ne le croyons pas, puisque, même dans la pureté cristalline du ciel, de la mer, des rochers adoucis, du sable de la plage, une certaine affirmation du contour et des zones monochromes parodie les techniques de l’esthétique indifférente. Les couleurs sont autrement naturelles dans ce paysage paradisiaque, mais la voix que l’on entend a déjà chanté durant le générique ; même lorsqu’on parle d’un au-delà de l’indifférence, un certain indifférencié demeure (à preuve, l’ultime image de cette séquence remplit de bleu l’écran, pendant que Giuliana parle du tout, du tout). Maintenant, pénétrons dans l’hôtel de Corrado, où fauteuils et murs sont d’un blanc phosphoreux et accablant, il y est dit : “on va, on vient, rien ne change, je suis pareil”. Délaissons cet aperçu clinique de l’indifférence, retenons deux détails : Giuliana s’enveloppe dans un drap, la chambre se métamorphose (envahie par un rose monochrome). Et jusqu’à la fin du film, en passant par l’épisode du délire devant un navire en cale sèche (Giuliana monologue, et devant un marin étranger qu’elle ne comprend pas, elle énonce une phrase douloureusement schizophrénique : “les corps sont séparés”), une indifférence des objets et des êtres, une réification, un déroulement des espaces nous remet en mémoire le monde des choses et des hommes ainsi que la trame cinématographique. En partie grâce à Bergson, nous savons que le processus filmique, objectivation et infinie répétition, bref pétrification dans l’espace de conduites vivantes, de langages animés, contient à un second degré l’indifférence (qui nous occupe). La forme cinématographique, telle une enveloppe ou un simulacre (cher à la théorie d’Épicure) est un voile transparent jeté sur les événements, sur l’histoire humaine, avant tout quand cette dernière tend à ressembler aux structures des choses, en inspirant une esthétique de l’indifférence, qui traduit en définitive et sans la moindre nuance dialectique une indifférence de l’esthétique. Nous avons dénombré çà et là les enveloppes, correspondant aux plans infinis et parallèles, aux couches de l’indifférence (avec la distance, l’écart absolu qui les sépare ; une violente ou une pâle monochromie les colore) ; nous avons distingué les natures mortes (l’indépendance laissée aux choses les constituait en monades) ; quant aux structures floues et transparentes, elles se diluaient, connaissaient le glissement et se résolvaient le plus souvent en flottement. Peut-être que cette esthétique de l’indifférence recoupe la vision de l’enfant, de sa naissance à un an environ : lumière diffuse et jeux d’ombre, absence de contraste due à un espace à deux dimensions ; en somme, le gris. Le Désert rouge rejoint les expériences psychologiques les plus ancrées en nous et reflète notre société, au sein de laquelle l’industrie cinématographique chérit deux notions essentielles : indifférence, esthétique.
Georges Sebbag
Notes
[1]. La vision flottante d’un bateau est redevable des régions indifférentes ; elle existe en particulier chez M. Blanchot : “et il lui semblait qu’il contemplait le vide dans l’intention absurde d’y trouver quelque secours. Pourtant un bateau sortit du brouillard, lentement d’abord puisqu’il disparaissait à intervalles réguliers dans des ténèbres qui ne consistaient que dans cette disparition, puis il surgit si près que Thomas aurait pu déchiffrer les inscriptions qui brillaient sur la coque s’il avait voulu s’en donner la peine. Était-ce parce que le bateau était vide ? Il le laissa s’éloigner avec autant d’indifférence que s’il avait distingué dans cette image une promesse illusoire et il continua de nager.” (Thomas l’obscur, Paris, 1941, p. 8.).
[2]. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, (trad. M. Betz), partie IV, “Parmi les filles du désert”.
[3]. Cf. Musil, L’Homme sans qualités, (trad. P. Jaccottet), Paris, 1958, t. IV, p. 458 : “le surhumain, c’est sans doute la grandeur de l’élan dans les contours, cette ample sûreté du trait ? Ou est-ce l’immense désert de cette couleur étrangère à la vie, le bleu sombre ? Ou le fait que nulle part la cloche du ciel n’est posée si directement au-dessus de la vie ? Ou est-ce l’air et l’eau, auxquels on ne pense jamais ? Ce sont de braves et ternes commissionnaires, d’habitude. Ici, chez eux, ils se dressaient soudain inapprochables, comme un couple royal.” Ce passage est tiré d’un paragraphe capital intitulé : le voyage au paradis. Bien qu’il y ait une esthétique propre au paradis, l’indifférence n’est pas forcément chassée de ce haut lieu. Au contraire, nous reconnaissons là certains procédés des espaces indifférents : monochromie, infinité, violence, recours aux éléments naturels.
Références
Georges Sebbag, « Michelangelo Antonioni, Le Désert rouge » (tiré de son D. E. S. de philosophie, De l’indifférence, mai 1965, chapitre III) est publié successivement dans :
Le Pli d’Étampes, n° 31, « Spécial Ciné-club », 8 janvier 1976.
Caméra/Stylo, n° 3, « Michelangelo Antonioni », novembre 1982.
Georges Sebbag, De l’indifférence, Sens & Tonka, 2002.