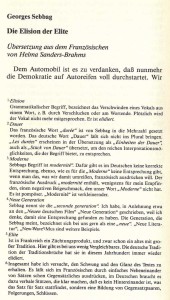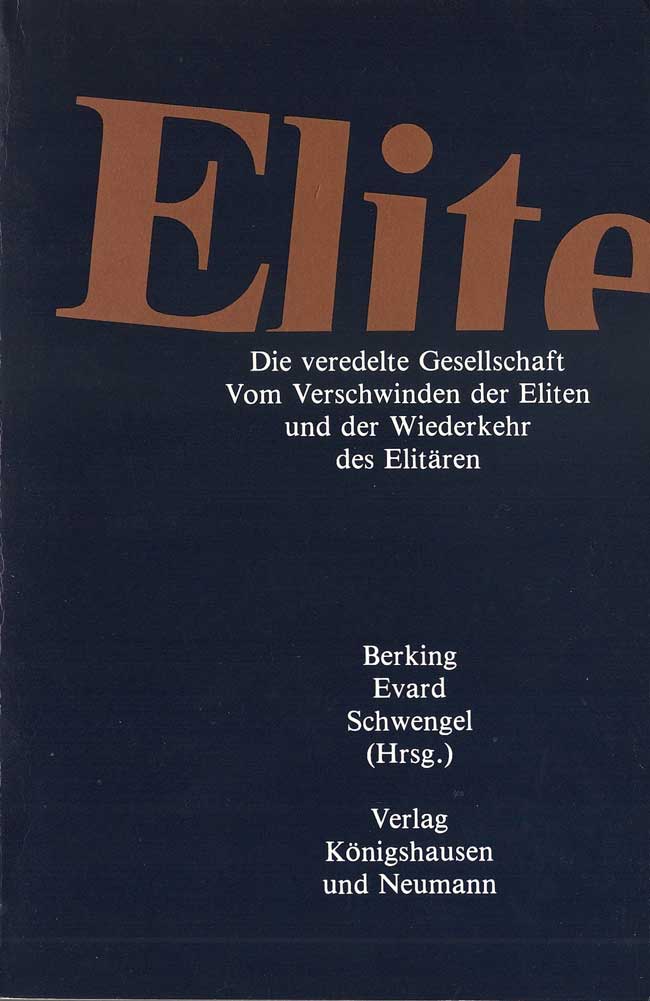
Grâce à l’automobile, la démocratie démarre sur les chapeaux de roue. En passant notre permis, nous nous initions à la modernité. Nous nous conformons à la géométrie orthogonale du territoire, nous nous adaptons aux rigueurs de la mécanique, nous franchissons hardiment le seuil de la technique. De surcroît, le pouvoir despotique d’arrêt de mort nous est accordé dès que nous nous mettons au volant. Contrairement à l’idée reçue, le citoyen n’est pas désarmé. Sa voiture piégée peut à tout moment attenter à sa propre vie et à celle des gens qui l’environnent. Désormais on ne vote pas avec sa tête ou avec ses pieds mais en circulant sur quatre roues. En France, la révolte de mai 68 s’est achevée en queue de poisson, un beau week-end de Pentecôte, quand les pompes enfin gorgées d’essence ont refoulé les différents protagonistes sur les routes, loin des villes.
Le dressage du citoyen se fait sur la route, l’autodiscipline passe par la discipline en auto.
Le conducteur ne s’abandonne pas à la contemplation du paysage : aucune forme pittoresque ne se détache de la nature morte et monochrome.
Il ne cède pas à la griserie de la vitesse, car toute jouissance est un frein. Constamment sur le qui-vive, il veille et surveille. Son appareil perceptif capte les moindres signaux, les filtre, les interprète dans l’instant. À partir de son habitacle, il multiplie les prises de vue sur le tableau de bord, les rétroviseurs, les côtés, l’avant, le lointain. Il panoramique, coupe brutalement le plan, intercale un flash, opère un mixage, dédouble la vision. Il met en scène son déplacement, réagit sans la moindre panique, monte méthodiquement les séquences de sa trajectoire. Surtout, il subit une épreuve de réalité ; il affronte les pressions du présent. Il faut cadrer l’image, ne pas sortir du champ. Comme il intervient en direct, l’automobiliste dilate à l’extrême son clip, sa microdurée et augmente ainsi sa marge de sécurité. Il essaie d’imaginer le moment d’après, d’anticiper le mouvement des véhicules, de pressentir certaines réactions. La survie est à ce prix.
Pour ceux qui sillonnent les routes, les distances se ramènent à peu de choses. La terre leur appartient, les kilomètres sont interchangeables. Aucun peuple, aucune classe sociale, aucune assemblée générale ne résiste aux migrations des corps ceinturés et des âmes aux aguets. En vadrouille ou en stationnement, dispersés ou embouteillés, les passagers en transit n’apprécient pas les lieux, ne provoquent pas de rencontre, ne goûtent pas à la parole. Ils fuient leurs semblables, le premier moteur les enfonce dans la solitude. Ils ne se rendent pas spécialement ici ou là ; ils ne désirent pas vivre en groupe, en communauté. Ils balayent perpétuellement l’espace pour se produire incidemment dans le temps.
La psychologie collective a fait long feu. L’automobile qui d’ordinaire transporte une ou deux personnes contribue au dépeuplement des nations, à la déconnexion des citoyens, à l’affadissement des passions. Comme d’autres vecteurs de destruction (avions, missiles), elle innerve et neutralise l’espace. Comme d’autres moyens de communication (radio, télévision), elle investit la perception et bannit la mémoire. Comme d’autres automates (électroménager, hi-fi), elle nous dispense des services d’autrui. Comme d’autres supports ludiques (sports, loto), elle maintient la règle du chacun pour soi. Comme d’autres images de marque (politique, religion), elle renouvelle ses modèles. Comme d’autres instances pédagogiques (école, famille), elle prend d’abord soin du corps. Comme d’autres formes de recherche (sciences, statistiques), elle découvre plutôt des banalités de base. Comme toute marchandise, elle évolue comme un poisson dans l’eau.
Cependant les véhicules ne savent plus où se mettre. On les voit partout. Comme la littérature ou la presse, ils ne font plus rêver.
La marée automobile submerge troupes et groupes. Il n’y a plus trace de foule, de masse, de nation, de peuple, de classe, de caste, de tribu, de meute. On a du mal à aligner d’un côté des chefs, des tyrans, des présidents, des experts et de l’autre des prolétaires, des citoyens, des exécutants.
Traditionnellement, l’élite s’exhibe ou se dérobe, se balade ou se terre. Qu’elle se fixe ou non dans une capitale, elle rayonne jusqu’aux confins du territoire. C’est une dévoreuse de sites agrestes, de zones stratégiques, de places publiques, de monuments à sa gloire. Or l’automobiliste aussi tient le pays à sa merci. Il est prêt à démarrer, à déflorer l’espace, à le disséquer sans retenue. Le rodéo automobile jette bas l’élite.
La caste sacerdotale ou guerrière officie en paix dans un champ clos ou non loin d’une ligne de démarcation. La classe marchande ou industrielle mène les ouvriers tambour battant sur les lieux de production. L’élite intellectuelle ou sportive homologue ses records et monte sur le podium. Ces trois cercles dirigeants ont une conception spatiale du pouvoir. Le commandement s’inscrit dans le seul ordre durable à leurs yeux, l’ordre des choses. La supériorité hiérarchique s’affiche sur le terrain.
Mais depuis, les réseaux routier, ferroviaire, électrique battent la campagne et les salles de cinéma s’enclavent dans la ville. La géographie passe la main à l’histoire. Les groupes se dissipent, les individus se libèrent des voisins, parents et amis. La continuité chronologique se brise – le temps perd son fil. La contiguïté spatiale se fige – l’étendue perd ses qualités sensibles. Le pouvoir flotte, ne sait où aller, s’absente définitivement.
Les individus, parfaitement masochistes, prennent d’assaut le ciné, l’auto, la télé, les vacances, les journaux. Le masochisme quotidien se renouvelle au gré de l’actualité. Nébuleuse anonyme, la société se définit par son indéfinition. Elle n’est ni nationale, ni religieuse, ni travailleuse, ni fraternelle, ni divisée. Difficile alors de dégager une structure, de repérer des symboles. Ni société globale à l’horizon, ni microsociologie en appartement. Bref, la société s’indiffère.
Les indifférents peuplent les hôpitaux (psychasthéniques et schizophrènes), hantent la scène politique (électeurs apolitiques), se pointent au travail (employés et ouvriers réifiés). Les espaces se mettent aussi de la partie (paysages monochromes, natures mortes, écrans récepteurs). Sans compter que l’indifférence fait corps avec elle-même (indifférence de l’indifférence, attrait du vide, voix de la neutralité, épousailles taoïstes).
La passion de l’indifférence résume l’indifférence de toutes les passions. Le dégoût est aussi plaisant que le plaisir qui est aussi déplaisant que le dégoût. Alors que dans les récits névrotiques, les passions romanesques, les motifs rivalisent avec les buts (l’essentiel étant qu’une table soit dressée, un paysage brossé, un contact charnel esquissé), chez l’indifférent au contraire, l’inactivité agissante, l’indécision permanente tiennent lieu d’épopée, de drame et d’entracte. L’indifférent s’empare des rumeurs insistantes, de l’occasion qui se présente. Il s’empresse de décrypter instantanément les flashes qui crépitent.
Comme il n’y a plus de différence substantielle – métaphysique, sexuelle, matérielle – entre toi et moi, je renonce à me torturer pour te prouver mon existence. L’autre n’est pas grand-chose et je n’ai pas une haute idée de moi. Le désert de l’indifférence s’étale sous nos pas.
L’individu baisse pavillon, le groupe est dénoyauté, la famille se disperse, l’amitié est comme une porte condamnée. On se dit que nul n’est irremplaçable et que les gagnants ne valent pas mieux que les perdants.
La modernité a cultivé la conquête, le progrès, la courbe ascendante, quitte à capituler devant la ruse ou la terreur. Or depuis deux décennies, presque tous les signes s’inversent. L’expansion économique s’interrompt, les découvertes scientifiques sont moins nombreuses, l’innovation technique stagne, la critique sociale n’est plus à la mode, la participation politique est fantomatique, les artistes rechignent à la besogne, les penseurs pensent à leur carrière, le cinéma est à bout de souffle, le désir se vide, on fuit la ville sans atterrir à la campagne. Les militaires perdent le moral depuis l’arrêt de la course aux armements.
On peut féliciter les élites d’avoir mené à bien l’aventure moderne. Elles ont entraîné les foules, éduqué les groupes, séduit les masses. Elles n’ont pas pris le pouvoir pour l’accaparer, elles ont émancipé l’humanité, servi le peuple en toute humilité.
La loi moderne confie les derniers aux premiers, les handicapés aux surdoués. Et la confiance règne. Les braves gens croient en l’intelligence de ceux qui guérissent, instruisent et décident. Sélectionnées rigoureusement, élues légalement, les élites partagent avec leurs administrés les idéaux égalitaires de la sainte démocratie.
Le capitalisme publicitaire réalise l’utopie ici et maintenant. La planète est bouclée, domestiquée, aseptisée. Les productions s’automatisent, la survie est assurée. Tout marche comme sur des roulettes. Le pouvoir qui traditionnellement exerçait un chantage à la pénurie perd un argument de poids. La plupart des décisions découlent de principes convenus, de programmes déjà conçus. L’autorité n’est pas attachée à une personne mais à une fonction, une profession. Si on s’adonne à la compétition, on s’y livre sur le terrain ou dans les tribunes.
On applaudit moins les vedettes qui passent que l’actualité qui les surpasse.
Les usagers de la technique sont les premiers servis car ils se servent eux-mêmes. L’automobiliste, le bricoleur, le client d’une grande surface, l’auditeur à l’écoute manipulent directement des objets ou des images. Ils obtiennent ce qu’ils désirent sans civilités superflues, à l’écart d’une hiérarchie, en l’absence d’autrui.
L’autodiscipline se généralise sans qu’intervienne la conscience morale ou civique. L’indifférent ne se soumet pas à une loi, il prend connaissance d’une réglementation technique qu’il applique strictement. C’est pourquoi il conduit prudemment, mange sobrement, s’informe régulièrement. Dans ce contexte, les personnes démunies, le mendiant ou l’analphabète, représentent un véritable danger public.
Actuellement, des centaines de millions d’états-majors se disputent les durées. Tout individu emporte dans sa serviette des provisions pour la journée et éventuellement de quoi se suicider.
Le spectateur moyen, l’homme sans particularités, le premier venu est à la fois juge et partie dans les affaires courantes ou extraordinaires du temps.
Nous sommes, c’est certain, définitivement seuls. Pourtant nous pataugeons gaiement dans le temps social.
La joyeuse, la triomphante modernité qui depuis des siècles s’est arrachée à la tradition est aujourd’hui au bout du rouleau. Si l’envie nous prenait de nous arracher à la modernité, ce serait peine perdue. En réitérant le geste inaugural de l’histoire moderne, nous afficherions piteusement notre filiation, nos antécédents. Nous rentrerions chez nous, au lieu de nous en aller. Nous sommes voués à couper les ponts pour rétablir aussitôt la communication. L’esprit moderne nous enferme dans son fantasme.
Mais cinq concepts au moins nous tiennent la dragée haute – la modernité, la seconde génération, l’élite, l’individu, la durée.
La modernité abhorre l’éternité. Elle invente dans un même mouvement l’histoire et l’oubli, la révolution et son spectacle, l’anticipation et la contre-anticipation, le jour et la fin du jour, la tension et la détente.
La seconde génération ne veut rien devoir à personne. Elle refuse la chronologie, maladie chronique de l’histoire. Quand elle commémore les destinées les plus obscures et les événements supposés marquants, elle le fait à sa façon, vite et pompeusement. Ses jours ne sont pas comptés mais rapetissés. Elle voit fuser les durées et se protège contre leurs retombées.
L’élite n’a aucune affinité avec une caste aristocratique ou un club de snobs. C’est une minorité sèchement sélectionnée regroupant des forts en thème, des arrivistes, des chanceux, des besogneux. On en fait partie quand on obtient la moyenne aux examens, un classement honorable aux championnats, 51 % des suffrages aux élections.
L’école démocratique légitime les élites bardées de diplômes. Toutefois un problème se pose. À 20 ans, tous les jeunes suivent une formation scolaire ou professionnelle et 25 % d’entre eux continuent leurs études jusqu’à 22 ans. Alors qu’en 1950 le destin élitaire se dessinait dès l’enfance, en 1985 l’incertitude demeure à 25 ou même à 30 ans. Des dizaines de milliers de postulants peuvent encore être repêchés ou recalés à cet âge. En promouvant une élite tardive nombreuse, la démocratie lui coupe l’herbe sous le pied.
Face à une classe moyenne envahissante, l’élite ne joue plus son rôle de minorité agissante.
L’individu se cache dans un trou. II n’est pas tenté par le sérieux de l’élite, les déboires d’autrui ou les avances de l’inconscient. II n’est pas touché par la fièvre guerrière, la ferveur religieuse, l’effervescence politique. II ne proclame pas ses sentiments ou ses vérités. Indifférent, il se tait. II sait qu’il n’est pas la mesure de toutes choses. Témoin d’une histoire qui se défait, il arpente le temple des durées.
L’individu, dans son coin, tâte de la durée. Il franchit un seuil en saturant l’espace, en gonflant un texte, en reproduisant indéfiniment une image. II perçoit alors nettement une durée, le temps d’une image.
Nous ne nous bagarrons plus pour une femme, un Dieu ou un territoire. L’égalité règne entre les hommes. Nous nous départageons en nous parant des dépouilles du temps. Le présent n’est plus inimaginable, il se réalise sous nos yeux.
Les grands hommes faisaient l’histoire, la foule obscure et solitaire plébiscite les durées matérialisées sur grand ou petit écran.
Les chefs servaient à éloigner les démons, la disette, la peste, les ennemis, l’angoisse. Avec la modernité, on change de décor, on jette aux oubliettes les sauveurs ou les tuteurs, on se spécialise dans le temps bref, on fabrique du faux jour.
La métaphysique est à l’ordre du jour. On intuitionne le temps, on pressent le moment d’après. La perception détrône la mémoire, l’imagination tord le cou à l’entendement.
La question métaphysique par excellence n’est pas celle de l’être, du langage ou de l’histoire mais de notre relation au présent pressant – un présent étourdissant, hors chronologie, médiatisé par des objets durables, des images artificielles et le vertigineux désir d’usagers sans désir.
Certes l’élite jouait avec le temps pour se maintenir au pouvoir. Elle s’adaptait aux circonstances, rusait avec le calendrier, temporisait, anticipait sur l’événement. Elle récrivait même l’histoire pour étendre sa renommée. Mais elle s’intéressait surtout au monde sensible. Elle distribuait les biens et rangeait les personnes. Il lui paraissait impossible de thésauriser les durées.
L’élite croyait au réel, s’arc-boutait à l’espace. Nous tournons en dérision le monde visible, en le simulant, l’imaginant, le déformant. Nous renvoyons la géométrie à ses clôtures. Nous dansons sur la corde raide du temps.
L’élite ne monte plus la garde autour de son secret. Elle n’est plus dans son assiette. La situation lui échappe. La psychologie n’est pas à l’honneur, on ne s’intéresse pas assez à autrui. Les sociétés corrompues rêvent de démocratie. Les experts se trompent régulièrement dans leurs prévisions. La planète roule d’étranges pensées. L’homme de la rue se préoccupe moins de santé ou de confort que de son inscription à l’ordre du jour.
L’élite peut se prendre en charge, se spécialiser, modifier ses statuts, réviser en baisse ses objectifs, changer de méthode, se ressourcer dans le peuple, rajeunir ses cadres, gonfler le nombre de diplômés, avoir une pédagogie libérale, se préparer une sortie honorable, servir l’Homme, amadouer les subordonnés, se cantonner dans un rôle technique ou bien se remettre en selle, crier au retour de l’élite, insister sur son ancienneté, frapper du poing sur la table. Dans les deux cas, elle est tenue de promouvoir son image de marque.
Autrement dit, l’élite ne détient pas le pouvoir, elle le sollicite. Elle tente de se faire entendre de l’équipage, comme un capitaine pendant un naufrage.
La terre tremble et le soleil ne tourne pas rond. La quotidienneté du jour ne nous tranquillise plus, l’anxiété et l’espoir ne nous stimulent plus, l’actualité ne nous étonne plus, la modernité ne nous flatte plus, l’amnésie ne nous amuse plus, la saisie de l’instant ne nous suffit plus, nous nous perdons en conjectures sur la signification des durées matérialisées. Le montage d’un film, le bracelet-montre, la radio en direct, la pub multimédia, l’image placardée, les colonnes d’un journal, la surveillance télé, la ville détruite, l’automobile conquérante, l’art décapité, la passion esseulée, la technique miniaturisée, les corps en forme, les maladies insidieuses, l’abaissement de l’âge de la retraite, l’école obligatoire, les voyages circulaires, la connivence militaire, l’inflation démographique, la génération célibataire, Israël dans le concert des nations, les travailleurs immigrés, la montée du présent, l’affaissement des décennies écoulées, les photos plus vraies que nature, l’abjectivité scientifique, l’acharnement à sauver Dieu, la double vie, la cotation des valeurs morales, la comédie politique, la défection des penseurs, le spectacle de la pitié, l’élision de l’élite révèlent que le temps est notre chair, l’unique matière de nos occupations. Nous ne descendons ni ne remontons le fleuve du temps, la chronologie n’a plus de sens. Nous nous enferrons dans la durée même. Une durée visible, tangible, audible, dépecée démocratiquement par chacun de nous.
Les castes militaires investissaient les lieux, délimitaient les territoires. Les grands hommes du passé caracolaient dans l’histoire. De leur vivant ils jouissaient du pouvoir et après leur mort de la gloire. Aujourd’hui n’importe quel imbécile heureux possède autant de puissance qu’un état-major, un prince et une star réunis. Affamé ou obèse, il s’empiffre de durées artificielles. Nous ne sommes pas tous des poètes mais nous percevons immanquablement des durées. La richesse, la renommée, la sexualité, le savoir sont déclassés par les durées.
Nous ne nous amusons pas le temps d’une récréation. Nous recréons inlassablement le temps.
Les durées matérielles sont à la portée de tous. On presse un bouton, on consulte un mode d’emploi. Initiation rapide. L’usager ploie sous les durées. Il n’a pas le temps de s’ennuyer.
L’élite est décontenancée par ce qui se passe. Elle ne voit pas où mettre son grain de sel, comment offrir ses services. Elle intervient habituellement en plein drame. Elle sépare le bon grain de l’ivraie, repousse à temps les bandits du rêve qui narguent le réel. Ou plutôt elle calme le jeu en banalisant les plaisirs et les peines. Elle-même réussit parce qu’elle a le triomphe modeste. Mais à présent, elle se sent lasse. Elle échafaude, manœuvre, complote en vain.
Elle s’aperçoit avec horreur qu’elle fait masse. Son corps s’hypertrophie. Elle recrute de nouveaux membres pour défendre ses positions. Des gens venus d’horizons divers se regroupent en une sorte de gang, de syndicat. Décideurs, chercheurs, vedettes, journalistes, patrons se mêlent pour unir leurs intérêts.
Pendant que ses subordonnés se dispersent, se préservent les uns des autres, l’élite se rassemble, met en spectacle sa connivence. Elle appelle à la solidarité en montrant l’exemple.
Le monde est à l’envers. Comme elle n’est plus irremplaçable, l’élite se découvre une vocation universelle.
Elle attrape alors la maladie du nombre. Les courbes démographiques lui donnent le tournis. Elle se demande si la population du globe qui a doublé depuis 1950 a voulu rendre hommage à son art de gouverner. Comment réagir devant un tel afflux de troupes ? Dispose-t-on facilement d’un auditoire aussi vaste ?
L’élite a beau jongler avec les chiffres, ils ne tombent jamais juste. Tantôt elle imagine dix milliards de travailleurs ou de touristes qui fraternisent sous sa houlette. Tantôt elle se contente d’un public réduit, d’une clientèle fidèle.
Et si elle avait le courage de son ambition, elle s’engagerait à libérer l’humanité des féodalités, des tyrannies locales. Elle pourrait enfin légiférer durablement et rigoureusement.
Prudente, l’élite hésite. Si elle se convertissait à la démocratie, elle sonderait en permanence le plus grand nombre. Si elle prenait parti pour la guerre exterminatrice, elle se couperait du commun des mortels, se constituerait en minorité infime, se désolerait dans son bunker.
Alors que les anciens rois savouraient l’obéissance de la multitude, s’enorgueillissaient de leurs sujets, s’échauffaient à leur ardeur, les gestionnaires modernes rencontrent leurs administrés sur des pages ou des écrans, des tableaux ou des graphiques et s’empêtrent dans des formules et des chiffres. L’élite ne distingue plus une équipe d’un rassemblement, un village d’une nation. N’ayant aucune notion des passions collectives, elle ne se représente que des ensembles vides. En fait, les peuples, les communautés, les masses l’ont abandonnée à son triste sort et se sont évanouis dans la nature.
À tout moment, la seconde frappe peut volatiliser les populations ambiantes, au grand dam de l’élite.
Les chercheurs, les chefs de service, les sportifs se tuent au travail ou à l’entraînement. C’est leur façon à eux d’occuper le temps. Ils s’abrutissent ou s’entêtent. Les rares fois où ils flânent dans les rues ou les magasins, personne ne les arrête.
Les enfants des prolétaires, ceux de la seconde génération, ne serrent plus des boulons. Ils veillent sur les durées. S’il leur arrive aux heures de grande écoute de tomber sur l’élite, ils ne lui réservent pas un accueil spécial. Ils jugent son intrusion, apprécient son jeu du moment. Le regardeur commande. Il dispose des diverses apparitions comme il l’entend.
L’écran démocratique ne privilégie pas un statut, ne restitue pas une hiérarchie, ne consacre pas une domination. Le dernier des hommes nous tire des larmes et le généralissime nous laisse de glace. Les durées contrecarrent le principe de réalité. Non seulement les rôles ne se distribuent pas en fonction de la position sociale mais un second rôle peut éclipser le rôle principal.
Les mass media raffolent de la dialectique. Avec la publicité ou le cinéma, le fictif semble réel et le réel paraît fictif. Désormais l’étonnant procédé qui consiste à renverser le monde ou à inverser les valeurs est mis à la disposition des spectateurs, des usagers, des travailleurs. Le tour d’esprit dialectique déborde les cercles de l’élite.
Les décideurs officiels ou officieux s’inquiètent. La dialectique médiatique n’arrange pas leurs affaires. Ils se sentent dépossédés de leur pensée. Ils sont imités, épiés, contrôlés. Leur image leur est immédiatement retournée. Exercent-ils encore le pouvoir ? Jouent-ils seulement un rôle dans l’hallucination des durées ? Ils ne savent que répondre.
Les clichés des romanciers, les plans des cinéastes, les instantanés des reporters contribuent à désacraliser la classe dirigeante. La fascination tombe quand un corps est photographié sous toutes les coutures. Alors que les anciennes castes (guerriers, prêtres, magistrats) magnifiaient le semblant pour renforcer leur prestige, les nouvelles élites, happées par la machine médiatique, paniquent à chacune de leurs apparitions. C’est pourquoi plutôt que d’occuper le devant de la scène et de payer de leur personne, elles confient leur image de marque aux professionnels de la communication. Elles n’entendent pas rivaliser avec les comédiens qui les parodient (Coluche, Yves Montand). Et pour brouiller définitivement les cartes, elles déclarent révolue l’ère de la représentation. Elles concèdent au tout venant le badge de la célébrité. Un quelconque zigoto peut tirer au loto la une des journaux.
L’élite arrête son char. Les voyageurs de l’histoire descendent. Elle n’est plus libre d’écrire un scénario et de le réaliser.
Les décideurs sont si peu décidés qu’ils chargent des scénaristes de les éclairer sur l’avenir. La prévision, la prospective, la politique-fiction qui tentent de simuler le futur dissimulent mal le pouvoir fictif de la politique. Les futurologues ne prophétisent pas, ils accommodent des surlendemains à consommer le jour même. Ils annoncent des catastrophes pour les empêcher de se produire. Personne ne réagit vraiment. Les scénarios, moins bien ficelés qu’au cinéma, n’emportent pas l’adhésion.
De même que les dynasties ne juraient que par le passé, l’élite contemporaine n’a que le futur à la bouche. Son ignorance crasse du présent, son absence de volonté ou d’imagination la poussent à piétiner des plates-bandes inexistantes, à résoudre des énigmes insolubles. Elle temporise comme elle peut.
Les milieux politiques sentent confusément qu’ils se mettent hors-jeu. Certes ils se réfèrent à l’histoire, défendent la modernité, renouvellent l’actualité. Ils ne savent toujours pas pourquoi le temps presse. Ils ne voient que les durées sifflent sur leurs têtes. Ils puisent leur dernière trouvaille stratégique dans le film La guerre des étoiles. Mais les faiseurs de durées ne les laissent pas dormir en paix. Jessica Lange, Sissy Spacek et Jane Fonda, après avoir interprété des rôles d’agricultrice dans Country, The River et The Dollmaker plaident la cause de l’agriculture devant la Chambre des représentants.
Depuis le début du siècle le génie n’a plus cours, selon Musil. En cette fin de siècle, c’est au tour des élites d’être privées d’emploi. Il n’y a plus de personnes distinguées ni de gens au pouvoir. D’ailleurs pourquoi s’embarrasserait-on d’un dirigeant quand les objets et les êtres s’autorégulent ? Des conducteurs disciplinés, des consommateurs aisés, des parents prévoyants, des citoyens atones, des usagers avisés n’ont pas besoin d’être encadrés, même symboliquement. Dans une démocratie apolitique et publicitaire, les élus n’exercent pas le pouvoir mais un métier comme un autre.
La technocratie est l’image vivante de l’élision de l’élite. Elle n’use pas de volonté propre, d’imagination personnelle. Bref, elle ne dirige pas. Elle travaille à plein temps, utilise un savoir, des compétences, des recettes. Elle ne relève pas d’un groupe de pression ou d’une classe sociale. Depuis longtemps, les milieux cohérents, tels que les communautés, les associations, les minorités sont réduits à presque rien. Les appareils qui subsistent, les syndicats par exemple, s’intègrent parfaitement aux structures étatiques. Le technocrate s’adresse à un usager standard, à un individu anonyme, autrement dit à lui-même.
L’élision de l’élite ne résulte pas d’un progrès moral ou d’une contestation sociale. Elle provient d’un changement de programme, d’une mutation métaphysique.
Les conditions d’impossibilité de l’élite sont réunies quand la modernité abolit le passé, quand les passions collectives s’éteignent, quand l’espace planétaire est saturé, quand on se plie à la discipline des transports, quand fleurissent les représentations de l’élite, quand les scénaristes du futur s’inspirent du cinéma, quand les citadins se démobilisent, quand la seconde génération rêve de génération spontanée, quand l’individu perçoit des durées matérialisées, quand le journal s’empare du jour, quand les durées brèves crépitent à chaque instant, quand la publicité est plébiscitée, quand les citations ne font plus autorité, quand on repousse unanimement l’horreur, quand la célébrité est jouée aux dés, quand on prête à Dieu de l’humour, quand la société permissive ne dégénère pas, quand on embellit la plus vile marchandise, quand on apprécie la légèreté des simulacres, quand nul n’est irremplaçable, quand le temps est taillé en pièces, quand le spectacle commence, quand la colère s’apaise, quand chacun médite, quand on s’arrache au monde pour épouser la durée.
L’élite actuelle réclame de hauts salaires, en échange de ses services. Elle veut qu’on la paye à son juste prix. Comme les prolétaires de jadis, elle se bat pour l’amélioration de ses conditions de travail et pour le maintien de son pouvoir d’achat. Elle est la digne héritière de la classe ouvrière. Alors que les villes sont brisées, les familles séparées, les âmes divisées, son esprit de corps ne faiblit pas. L’élite forme comme un îlot de socialité dans des contrées désolées. On est solidaire en son sein, on se serre les coudes, on fait du zèle, de la surenchère et des heures supplémentaires. Mais, et c’est un drame pour l’élite, sa mentalité collective ne lui sert de rien car elle est passée de mode. Cet archaïsme lui coûte cher, le pouvoir lui file entre les doigts.
L’élite, bon gré mal gré, se range à l’intérêt universel pour le temps synthétisé. Les individus dispersés dévorent la manne des durées brèves. Qu’ils feuillettent un magazine, qu’ils entament une conversation, qu’ils consultent un écran, qu’ils embrassent un proche, qu’ils exécutent une tâche, qu’ils s’endorment, qu’ils se rendent à leur travail, qu’ils répondent au téléphone, qu’ils se brossent les dents, qu’ils jardinent, qu’ils remplissent un caddie, ils contemplent ou élaborent des durées. Ils ne cochent pas les cases d’un agenda, ne macèrent pas dans la vie quotidienne. Ils ne suivent pas le fil d’une histoire, ne ressassent pas les épisodes d’un feuilleton interminable. Ils se saisissent à point nommé (ou à brûle-pourpoint) d’une durée artificielle aussi cassante que le verre, aussi brillante que l’acier, aussi transparente que l’air. La psychanalyse est impuissante à décrire la discontinuité de ces moments – nous ne puisons pas .simultanément dans deux sources pulsionnelles, nous ne désirons pas autrui, nous ne substituons pas une langue à une autre. La sociologie ne reconnaît plus les siens – nous n’appartenons pas à un groupe, nous ne nous dévisageons pas car nous nous ressemblons. Les philosophes n’y voient que du feu – nous ne ruminons plus nos pensées, notre attention est fâcheusement distraite.
L’économie marchande réifiait les travailleurs et les terrifiait. La démocratie publicitaire berce et duréifie ses spectateurs.
Si nous découpons instantanément des images-durées, si nous pressentons l’heure prochaine, si nous effectuons un doublage et dédoublons notre âge, si nous autopsions le jour à la photo-finish, c’est que les durées fusent. On nous tire dessus à bout portant.
Les élites ancien style (tyrannies ou dictatures préétatiques) organisent comme elles peuvent le chaos social. Elles comptent sur la guerre, la famine ou la surpopulation pour abrutir leur peuple, se présenter en sauveurs et acheminer quelque secours d’urgence.
Les élites élidées de la planète (Est, Ouest, pays pauvres) pensent toutes l’humain en termes statistiques. Cinq ou dix milliards de bâtonnets ne les effraient pas. En brisant des villes comme Le Caire ou Mexico, en aménageant des espaces concentrationnaires, elles assurent leurs vieux jours. Elles se proclament alors gardiennes des valeurs. Elles dispensent le Bien, la charité aux milliards d’assistés ou de nécessiteux. Elles préservent les milliards de gens bien portants du Mal et de l’apocalypse nucléaire.
Les élites religieuses, militaires, industrielles, politiques, intellectuelles, artistiques, journalistiques, sportives ont la nostalgie des groupes, des castes, des classes, des nations, des masses, du grand nombre. Elles ne veulent pas comprendre que la conquête de l’Ouest est terminée, que l’espace est saturé, que le moment est venu de s’intéresser aux durées. Elles continuent à chercher un débouché, un public, un marché. Elles rencontrent l’incrédulité et non la gloire.
Depuis que Dieu a modelé l’âme humaine, que l’individu se sert du libre arbitre, que les idées circulent aisément, que les communautés se disloquent, que les objets techniques deviennent autonomes, que les passions se raréfient, les individus ne font plus masse et les élites voient leur audience baisser.
C’est à se demander si l’élite a jamais existé. Bien sûr, on suppose qu’elle a dû sortir du lot pour interpréter les choses et gouverner les gens. Il a fallu qu’elle racle la matière et secoue les esprits. Elle s’est placée entre des forces adverses qu’elle a subjuguées ou qui l’ont terrassée.
À présent, la nature est domestiquée, les peuples paraissent assagis. Comme jadis les Dieux, les dompteurs peuvent rentrer dans l’ombre, leur mission accomplie.
Cependant ici et là des voix clament le retour de l’élite. Comme si l’élite se décrétait, comme si on soignait la maladie du jour avec des remèdes périmés.
Tant qu’elle palpait des objets ou des êtres, l’élite avait son mot à dire. Or elle sursaute dès que l’effleure la moindre durée.
Mis à part leur plan de carrière, les élites élidées n’ont aucune intuition du temps. Elles ne savent pas que l’intuition des durées artificielles a remplacé l’intelligence des choses et l’amour des personnes.
Elles ne savent pas qu’une durée enseuillée a autant d’impact qu’une révolution sociale ou une explosion atomique.
Elles ne savent pas que l’allongement de la vie, la prolongation de la scolarité, la mise en préretraite, la précocité sexuelle, l’étalement des vacances s’accompagnent d’un tassement de l’envie.
Elles ne savent pas que le présent n’a pas d’histoire et qu’à tout moment on récupère des durées matérialisées.
Elles ne savent pas que le grand nombre absorbe vite les produits les plus sophistiqués.
Elles ne savent pas que les spectateurs agissent et que les acteurs regardent.
Elles ne savent pas que la conduite automobile éclaircit la population et raye de la carte les dirigeants.
Elles ne savent pas que les anniversaires ne riment à rien quand le temps perd perd son fil.
Elles ne savent pas réduire leur mandat à un mois, une nuit, une minute.
Elles croient disposer d’une quantité phénoménale d’images, de marchandises ou de supporters.
Elles sont hantées par l’idée de se battre et les durées les en dissuadent.
L’élision de l’élite prend des allures de catastrophe. On s’affole, on a peur quand disparaissent la chronologie, la transmission du flambeau, le troupeau et son berger, la vérité d’hier. On rameute en vain les sentiments de pitié ou de respect.
L’histoire des héros, des peuples, des élites nombreuses est close. Avec la discontinuité des durées, le décalage des âges, l’effondrement du jour, la stratégie multimédia, le décollement des mots, on ne peut se fier à personne. On bute sur un seuil, on ne perce pas le mystère, on s’évanouit dans les sables.
La ferveur tombe, la fascination cesse. On recule devant les translations, les déplacements de sens. La traduction devient impossible.
Non ! un gai scepticisme n’envahit pas les consciences. Oui ! les durées nous éclairent distinctement. Non ! la répétition ne forge pas la croyance. Oui ! le savoir est désarticulé. Non ! les genres littéraires ne sortent pas indemnes de l’accident. Oui ! les médias dialectisent l’imaginaire. Non ! la signature n’est pas authentifiable. Oui ! l’article vaut pour le livre, l’affiche pour le film, le fragment pour l’œuvre. Non ! l’inconscient n’est pas borné. Oui ! l’écrivain lit entre les lignes de la main. Non ! les élites ne nous ôtent pas le pain de la bouche.
On ne se mesure pas à autrui mais à soi-même. On ne contemple pas les durées, les durées nous surveillent. On ne se commande pas, on s’obéit. On ne dit pas la vérité, on lâche le morceau. On ne palpe pas l’étoffe, on écorche la peau. On ne cherche pas le bonheur, on se tient à l’écart. On ne se suicide pas, on prolonge le coma. On ne s’éternise pas, on éternue. On ne se souvient pas, on se dédouble. On ne se regarde pas, on traverse le miroir. On n’enfreint pas la loi, on se fraye un passage. On ne s’emporte pas, on s’interrompt. On ne disparaît pas, on réapparaît.
L’élite est aussi docile qu’un simple citoyen. Elle consomme des cassettes comme tout le monde. Les durées artificielles la prennent au dépourvu. Exit l’élite.
Georges Sebbag
Références
« L’élision de l’élite », traduit en allemand in Die veredelte Gesellschaft, sous la direction de Berking/ Evard/ Schwengel, Königshausen & Neumann, 1988. La version française paraît dans La Morsure du présent, Jean-Michel Place, 1994.