Entretien de Georges Sebbag avec Masao Suzuki
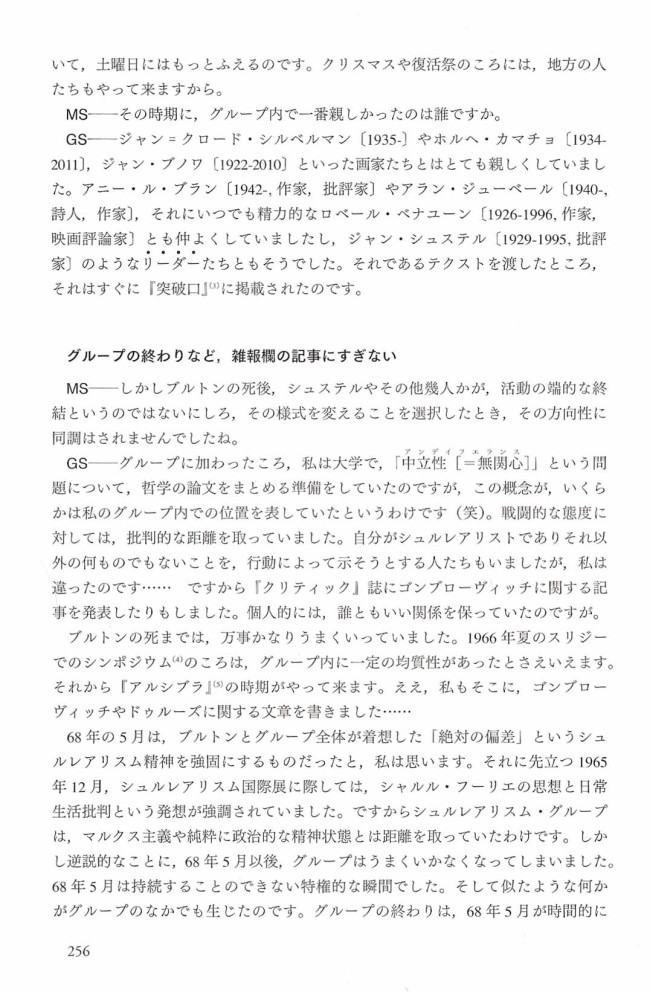
Contact avec le groupe
Masao Suzuki – Je suis très heureux de pouvoir présenter aux lecteurs japonais votre travail sur le surréalisme, qui est vraiment original en ce qu’il nous permet, non seulement de nous donner une vision historique bien nouvelle, mais aussi de retrouver le moyen de faire fonctionner à nouveau, de rendre effectives les découvertes ou inventions du surréalisme historique. Je crois que Le Point Sublime est une des publications les plus caractéristiques en ce sens.
Mais je voudrais profiter de cette occasion pour donner aux lecteurs une vue globale de votre itinéraire. Vous avez été membre du groupe surréaliste. Mais vous ne dites jamais, comme certains des anciens membres du groupe tendent à le dire, que vous connaissez le surréalisme parce que vous avez été surréaliste. Mais c’est paradoxalement pour cela que je voudrais savoir quelle a été votre relation avec d’autres surréalistes. Comment vous êtes-vous mis en contact avec le groupe ?
Georges Sebbag – Au début de mes études à la Sorbonne, j’avais pratiquement lu tous les textes importants d’André Breton, mais l’idée de rejoindre le groupe ne s’imposait pas à moi. C’est un ami qui m’a incité à contacter le groupe, parce que lui-même en tant que cinéphile avait déjà rencontré Gérard Legrand. Et un jour nous avons franchi le pas, nous avons écrit à André Breton.
Pour entrer dans le groupe, j’avais apporté une sorte de gage, un article sur Raymond Roussel que je venais de publier dans la revue Aletheia. C’était une façon claire d’indiquer mon intérêt pour le surréalisme. Et au café, on s’est très vite familiarisé avec la plupart des personnes qui étaient là. À cette époque, en 1964, j’habitais rue Saint-Martin, tout près de la place Beaubourg. Non loin de là, dans le quartier des Halles, la réunion du groupe se tenait au café La Promenade de Vénus. J’étais présent tous les jours ou presque, sauf le dimanche, à partir de 5 heures ou 5 heures 30. Breton était l’un des premiers à arriver ; il y avait au moins 10 ou 12 personnes. Le samedi, nous étions plus nombreux. À Noêl ou à Pâques, les gens de province venaient.
Masao Suzuki – À cette époque, avec qui étiez-vous surtout lié dans le groupe ?
Georges Sebbag – J’étais très ami avec les peintres comme Jean-Claude Silbermann, Camacho, Jean Benoît. J’étais également en bons termes avec Annie Le Brun, Alain Joubert, Robert Benayoun qui était très tonique, ainsi qu’avec les leaders comme Schuster. Et quand j’ai proposé un texte, il a tout de suite été publié dans La Brèche.
La fin du groupe, c’est un fait divers
Masao Suzuki – Mais après la mort de Breton, quand Schuster et d’autres ont décidé, sinon d’arrêter les activités, au moins d’en changer le mode, vous n’avez pas suivi…
Georges Sebbag – Au moment d’entrer dans le groupe, je travaillais à mon mémoire de philosophie sur l’ « indifférence ». Et cette notion indique un peu ma position dans le groupe (rire). J’avais une distance critique vis-à-vis du militantisme. Certains marquaient, par leur comportement, qu’ils étaient surréalistes et rien d’autre. Ce n’était pas mon cas… Ainsi j’ai pu publier un article sur Gombrowicz dans Critique. Personnellement, je me suis bien entendu avec tout le monde.
Jusqu’à la mort de Breton, les choses tournaient assez bien. Il y avait même une certaine homogénéité dans le groupe au moment du colloque de Cerisy, l’été de 1966. Vient ensuite la période de L’Archibras. Oui, j’y ai publié sur Gombrowicz et Gilles Deleuze…
Je trouve que Mai 68 vient confirmer l’esprit surréaliste de L’Écart absolu, conçu par Breton et tout le groupe. En décembre 1965, lors de cette Exposition internationale du surréalisme, s’affirmaient la pensée de Charles Fourier et une critique de la vie quotidienne ; le groupe surréaliste marquait ainsi ses distances avec le marxisme et un état d’esprit purement politique. Mais paradoxalement, après Mai 68, le groupe est tombé en panne. Mai 68 est un moment privilégié qui n’a pas pu durer. Quelque chose d’analogue s’est alors passé dans le groupe. Je crois que la fin du groupe coïncide avec le fait que Mai 68 n’a pas eu de prolongement dans le temps.
Il n’y avait plus alors de découverte ni d’invention dans le groupe, sans doute parce que nous n’avions pas assimilé ce qui venait de se passer. À l’issue de notre dispersion,Vincent Bounoure a lancé une enquête sur la fin du groupe. J’ai répondu : pour moi, la fin du groupe, c’est un fait divers.
Blanchot, Virilio, Perec
Masao Suzuki – Mais en Mai 68, vous avez eu peut-être d’autres rencontres ?
Georges Sebbag – Oui, bien sûr. J’ai rencontré par exemple Maurice Blanchot dans le comité d’action étudiants-écrivains. Blanchot ne parlait pas beaucoup. Dans Les Lettres nouvelles, je venais de publier un chapitre de mon mémoire sous le titre « Blanchot l’indifférent ». Au moment de notre rencontre, il connaissait mon article. Dans le comité, les séances étaient fréquentes. Et pour la revue Comité, j’ai écrit un texte, anonyme comme tous les autres articles. À cette époque j’ai commencé à enseigner la philosophie. Ce sera trois ans dans un lycée du Pas-de-Calais, deux à l’est de Paris, puis je suis arrivé à Étampes. Mais au cours de ces années, j’ai essayé de m’exprimer de diverses façons.
Masao Suzuki – Oui, en dehors du surréalisme, vous avez d’autres activités tels que l’entreprise de Quando.
Georges Sebbag – Quand je fonde Quando, je fais appel à à mes amis Marc Pierret et Jacques Bellefroid, rencontrés en mai 1968 au comité d’action. L’idée du temps s’est imposée davantage à moi à partir de 1973, d’où cette idée de Quando. L’année suivante, j’ai rencontré Paul Virilio puis Georges Perec. Ils m’ont fait participer à la revue Cause commune où j’ai publié deux textes. Je leur ai donc demandé de s’associer au projet, bien que Perec n’ait pas pu y contribuer pour des raisons circonstancielles.
Masao Suzuki – Je ne savais pas votre liaison avec Perec. Mais les axes de votre réflexion qui sont le langage et le temps sont également essentiels pour Perec.
Georges Sebbag – Oui, c’est ça. Il cite d’ailleurs mon premier livre Le Masochisme quotidien dans un de ses ouvrages. Je voulais, dès mon premier livre, creuser la notion de temporalité dans la vie quotidienne.
Le masochisme quotidien, c’est l’idée que la quotidienneté, cette temporalité quotidienne qui se renouvelle du matin au soir, est structurée par le masochisme. Sur un plan général, j’ai très tôt pensé qu’on devait abandonner tous les concepts de pouvoir et de domination. Ce n’est pas le sadisme qui domine d’en haut mais le masochisme qui domine d’en bas. Ainsi Quando souligne la nécessité de traiter la question du temps.
Masao Suzuki – Donc la notion du temps était toujours présente.
Georges Sebbag – Exactement. J’ai sollicité Joubert, Pierret et Virilio pour cet agenda collectif qui allait s’appeler Huit mois avec sursis où nous nous sommes amusés à anticiper huit mois de l’année 1978. À propos de l’anticipation du temps j’avais écrit un article en 1977 qui aurait dû paraître dans Traverses, la revue de Jean Baudrillard, mais que je publierai finalement dans La Morsure du présent. J’ai composé là un tableau-calendrier où il apparaît nettement que le temps chronologique allait bientôt s’effacer, qu’il allait céder la place à un temps sans fil. Dès 1977, j’avais perçu une remise en cause de l’ordre du temps, ce qui s’est amplement confirmé depuis.
Ainsi Le Temps sans fil est la description des expériences de modification du temps quotidien : il n’y a plus ni matin, ni midi, ni soir. On ne perçoit plus que les dernières lueurs du jour, au début des années 80. Cette compréhension de la temporalité m’a ensuite soutenu dans les recherches sur le surréalisme.
Cohérence des motifs, retour au surréalisme
Masao Suzuki – Je suis vraiment frappé par la cohérence de votre problématique en lisant tel passage du Masochisme quotidien :
Il n’est pas question ici de trouver la voie révolutionnaire ; la révolution du quotidien passera certes par la destruction du masochisme quotidien mais elle ne se fera pas à coups d’élucidations théoriques. Tout au plus la théorie peut démystifier et distraire. / La pensée active a besoin d’être découverte par l’acteur lui-même ; elle se propage aussi ; elle prévoit mais elle est à son tour surprise par son expérience. (Le Masochisme quotidien, p. 123).
Je pourrais dire que, mutatis mutandis, le « masochisme » est ce que vous appelez dans Le Point Sublime la « durée médiatisée ou matérialisée » et que la « pensée active » correspond à peu près à la « durée automatique ». Or quand vous employez l’expression « le temps sans fil », ça fait penser bien sûr à Breton, mais au courant des années 70…
Georges Sebbag – Non, je n’en étais pas conscient du tout à ce moment-là. C’est bien postérieurement que je me suis rendu compte du débat ouvert par Breton dans son Introduction au Discours sur le peu de réalité. Il n’y a pratiquement pas de référence au surréalisme dans Le Temps sans fil.
Masao Suzuki – Après L’Imprononçable jour de ma naissance, vous parlez ouvertement du surréalisme même dans vos ouvrages philosophiques. Comment et pourquoi avez-vous recommencé à travailler sur le surréalisme ?
Georges Sebbag – Un temps s’est passé… J’ai pris conscience que le mot « sans fil » existait dans le surréalisme et… ma petite découverte concernant la date de naissance de Breton – le 18 ou le 19 février – était un peu à l’origine du livre.
Masao Suzuki – Donc dans les années 70, vous n’avez pas anticipé sur une telle relation directe entre votre réflexion philosophique et la pensée de Breton ?
Georges Sebbag – Non, c’est peut-être parce que j’ai poursuivi mes propres recherches et je ne m’appuyais pas trop sur la pensée de Breton. Et depuis, les choses se sont encore développées. C’est seulement ces dernières années que j’ai perçu l’existence d’un véritable projet philosophique dans le surréalisme. Oui, Ferdinand Alquié, dont j’ai d’ailleurs suivi les cours, a parlé de la philosophie du surréalisme, mais dans un contexte très différent, un contexte quasi cartésien. Alquié a eu le mérite de dire que la philosophie du surréalisme n’était pas hégélienne.
L’Imprononçable jour : une nouvelle écriture
Masao Suzuki – À la période où vous avez recommencé à travailler sur le surréalisme, vous n’étiez pas tellement lié avec les gens comme Schuster ou José Pierre ?
Georges Sebbag – Pas tellement. Mais j’ai fait lire mon livre à Schuster et à Gérard Legrand qui a été intéressé par cette question des dates. Mais je ne les voyais pas souvent.
Masao Suzuki – Que pensez-vous de Legrand ? Il a été philosophe, lui aussi.
Georges Sebbag – Il m’a frappé surtout comme poète. Sur le plan philosophique, il y a un penchant hégélien mais il a aussi des audaces. Ce n’est pas un hégélien ordinaire. Il a été intéressé également par la réflexion que j’ai développée dans mon livre autour d’Alexandre Dumas.
Masao Suzuki – Oui, moi aussi j’ai été très impressionné par ces associations d’idées qui se développent autour des Trois mousquetaires. À la première lecture, je n’ai pas pensé que cet ouvrage avait été écrit par quelqu’un de formation philosophique. Vous n’avez jamais mis en avant la philosophie proprement dite dans cette série des Imprononçables.
Georges Sebbag – Il y a quelques éléments, mais c’est la forme qui compte.
Masao Suzuki – Oui, c’est un livre d’une forme très spéciale. Il n’est pas paginé.
Georges Sebbag – Non, ce n’est pas paginé. Il y a une part délibérée de fantaisie (rire)…
Masao Suzuki – Vous avez donc volontairement choisi une autre forme d’écriture. Il y avait une stratégie consciente ?
Georges Sebbag – Non, pas tout à fait. Le Dégoût, le sans goût, c’est déjà une écriture poétique, de temps en temps analytique. Le Temps sans fil est un peu plus analytique, mais il y a un souci d’écriture. Mais à partir de La Morsure du présent, cela a un peu changé, peut-être parce que j’ai commencé à publier dans Le Débat. J’y ai publié par exemple un texte sur la démographie, qui est très important pour moi. Si j’aborde un sujet tel que le mode de vie dans la société, je ne peux pas m’exprimer comme dans les Imprononçables.
En ce qui concerne Le Point Sublime, les textes de la seconde partie sont analytiques. Cela explique la réaction de Nelly Kaplan… Elle a lu bien sûr tout ce qui la concerne dans la première partie, mais la seconde partie l’a un peu étonnée… Je suis persuadé que les deux parties collent ensemble. Je tiens beaucoup à cette seconde partie où le développement plus explicatif renforce et éclaire la méthode mise en œuvre dans la première partie. À la fin du livre, je progresse dans l’investigation quand je parle de la lettre-collage de Breton à Aragon.
À partir de 1972, j’ai conduit une recherche un peu personnelle, un peu analytique, un peu philosophique. D’un autre côté, mon intérêt pour le surréalisme s’est à nouveau réveillé en 1985 quand j’ai commencé à écrire L’Imprononçable jour de ma naissance. La question est de savoir quand et comment la convergence entre ces deux préoccupations allait s’opérer. Je crois que cette convergence s’est réalisée dans Le Point Sublime.
Gilles Deleuze et la durée filmique
Masao Suzuki – Oui, Le Point Sublime montre bien cette convergence. Mais je pense que les lecteurs japonais seront intéressés par cette deuxième partie, également en raison de l’interprétation très personnelle du Cinéma de Gilles Deleuze.
Georges Sebbag – Ce passage, je l’avais publié dans une revue et je l’ai envoyé à Deleuze lui-même.
Masao Suzuki – Vous le connaissez depuis longtemps ?
Georges Sebbag – Oui, je l’avais rencontré au colloque de Royaumont sur Nietzsche en 1964. On a bien sympathisé, et après le colloque, Deleuze m’a ramené en voiture à Paris. C’est lui qui m’a indiqué d’appeler Mikel Dufrenne pour mon diplôme. Comme Dufrenne dirigeait la Revue d’esthétique, j’ai publié là un fragment de ma thèse. Plus tard, quand j’ai envoyé à Deleuze L’Imprononçable jour de sa mort, il m’a répondu avec une lettre très positive.
Masao Suzuki – Dans ce passage sur le cinéma, vous avez, disons, amicalement critiqué la pensée de Deleuze. Vous dites qu’il a, malgré tout, un peu finalisé l’histoire du cinéma, histoire qui va, selon Deleuze, de l’image-mouvement à l’image-temps. Vous dites plutôt l’image-durée.
Georges Sebbag – J’ai accordé énormément d’importance au cinéma. Là j’ai trouvé que ses deux livres faisaient une distinction trop chronologique. Ma critique est certes un peu générale, mais je crois que je touche là un point sensible… Je trouve qu’il y a déjà dans le cinéma un remaniement du temps. On n’a pas besoin de parler d’image-mouvement ni d’image-temps. On est déjà dans la construction d’éléments temporels. Le cinéaste ne fait rien d’autre que de fabriquer du temps ou de la durée.
Masao Suzuki – Vous pensez donc qu’il n’y a pas de rupture entre le cinéma d’avant-guerre et le cinéma d’après-guerre.
Georges Sebbag – En effet, et le cinéma qui m’impressionne vraiment, c’est d’ailleurs le cinéma muet, lequel me donne l’idée de durée.
Masao Suzuki – Vous parlez quand même d’une crise actuelle de l’image-temps. Je n’ai pas l’intention de dire que vous avez, vous aussi, finalisé l’histoire de l’image, mais vous ne parlez pas de l’image-durée en tant que quelque chose qui vient après l’image-temps ?
Georges Sebbag – Non, pour moi l’image-durée existe depuis le début. L’image-durée n’est pas la troisième.
Masao Suzuki – C’est entendu, mais vous n’imaginez pas que viendra un certain film qui nous fera voir d’une façon étonnante ce que c’est que l’image-durée.
Georges Sebbag – Non, le cinéma le plus banal pourra nous la donner. Mon idée est que le cinéma est la première expérience métaphysique à la portée de tout le monde. Donc la construction du temps filmique est différente de celle des durées médiatisées.
Fiction et/ou document
Masao Suzuki – Je voudrais vous poser une question un peu brutale. Dans votre travail sur le surréalisme, vous ne distinguez pas, ce me semble, les textes publiés, proprement littéraires, avec d’autres éléments divers laissés sous le forme de petites notes ou de certains signes qui se trouvent dans un coin des pages. Les textes ne sont considérés ni comme œuvres proprement dites ni comme documents purement historiques. Ce n’est donc ni une étude littéraire normale ni une étude historique pure et simple. Je voudrais vous demander donc : ce que vous faites, qu’est-ce que c’est ?
Georges Sebbag – On peut dire que c’est une approche poétique mais à la fois une recherche historique s’appuyant sur un certain nombre d’énoncés et de documents. J’espère en tout cas que les lecteurs peuvent suivre la démarche de mes recherches. S’il s’agit, par exemple, du « saut de Baou », on va voir peu à peu des éléments appartenant à des temporalités différentes se rejoindre : des cartes postales, le contenu des lettres de Breton, etc. J’aimerais bien que le lecteur découvre ce que j’ai découvert. C’est un genre qui peut s’apparenter au montage d’une exposition.
La chance que j’ai, c’est que j’ai ce soutien de documents. C’est finalement un peu ce que Breton a fait dans Nadja. Je crois qu’il dit : j’ai des documents photographiques ou autres, je ne décris pas la rue telle qu’elle est ni la place telle qu’elle est, puisque que le document en tient lieu. Oui, il y a un récit, mais un récit soutenu par des éléments graphiques ou plastiques.
Masao Suzuki – Il y a donc toujours un peu de mixage, un peu de mélange de différents niveaux.
Georges Sebbag – Oui, là encore je pense au cinéma qui fait appel à des éléments de sons et d’images.
Masao Suzuki – Moi je pense un peu à Michel Foucault qui, après tant de recherches historiques et documentaires très précis, dit que finalement ce qu’il fait est une espèce de fiction.
Georges Sebbag – Oui, je suis d’accord avec cette notion de fiction. Quand j’analyse le cinéma, un point essentiel que je mets en valeur, c’est la fiction du document et le document de la fiction. C’est un peu dialectique comme expression, mais (rire)… Je suis un acteur de ce documentaire. Ce que je mets en œuvre ce n’est pas un récit proprement historique des choses telles qu’elles sont arrivées, mais une recherche de ce que j’appelle durée automatique, un récit composé d’éléments qui n’ont jamais eu lieu, et que Deleuze pour sa part appelle événement pur, un événement qui n’a proprement pas lieu au sens ordinaire. Mon récit, qui est aussi un compre rendu, organise ces éléments et leur donne un sens.
Il ne s’agit pas d’une histoire positiviste ni hégélienne réclamant qu’on en fasse une synthèse au bon moment. Non, je pense qu’on est toujours décentré ; on n’a plus les éléments chronologiques qui nous permettent de dire exactement où on en est, mais il y a peut-être cet avantage que là je suis en contact avec des éléments intérieurs. Voilà la fiction telle que je la comprends.
Mais il est vrai que tout ça est très délicat, parce que je ne suis pas dans la position des surréalistes qui se comportent sans trop théoriser, par exemple celle de Breton qui, dans Nadja, met en jeu quelques « durées automatiques », tandis que je les reprends à une tout autre époque.
Masao Suzuki – Oui, c’est délicat, parce qu’il est toujours difficile ou impossible de savoir jusqu’à quel point Breton était conscient de ce qu’il faisait, de ces « durées » qu’il mettait en jeu.
Georges Sebbag – Il était peut-être un peu plus conscient qu’on ne le croit. On peut penser qu’en écrivant Nadja, Breton avait une certaine conscience des différentes temporalités qu’il voulait exposer. Il ne savait sans doute pas jusqu’où le conduirait sa pratique du hasard objectif. Mais il tenait à explorer ce terrain si favorable aux durées automatiques.
Masao Suzuki – Si je vous ai posé cette question, c’est que je pense que vous avez pu faire ce travail parce que Breton en était conscient d’une certaine façon. En principe on a le droit de chercher ces durées automatiques chez n’importe quel écrivain, mais vous avez dû commencer ces recherches tout de même à partir des textes de Breton. C’est sa particularité.
Georges Sebbag – Oui, ce mode de création est très fort chez Breton. Il était persuadé, je crois, de l’existence des « durées » qui se coagulent, se rencontrent, qui sont faites l’une pour l’autre.
Masao Suzuki – Je ne vais pas jusqu’à dire que Breton est plus important que Bataille ou Artaud, mais il y a ici quand même une spécificité du surréalisme.
Georges Sebbag – Oui, c’est décisif. L’originalité du surréalisme par rapport à ceux qui sont très proches se situe là. On ne peut entamer cette recherche qu’en partant de Breton. Il faut ajouter à cela l’importance du groupe. Tandis que moi, maintenant, je ne suis pas dans un groupe. Je suis isolé. Mon but n’est pas de réveiller aussi un groupe, mais de proposer des éléments qui permettent de comprendre toute cette dynamique dans son effectivité.
Projet philosophique du surréalisme
Masao Suzuki – Je voudrais parler d’un autre versant de votre travail sur le surréalisme. Vous avez publié il y a deux ans (en 2012) Potence avec paratonnerre. Vous dites là qu’il y a un projet vraiment philosophique dans le surréalisme. Il y a beaucoup de remarques très impressionnantes, mais par exemple vous remarquez que l’expression « le point suprême » vient d’un certain quiproquo provoqué par le livre de Michel Carrouges.
Georges Sebbag – Oui, vous avez bien relevé ce point. Et cela justifie d’ailleurs l’expression « le Point Sublime » que j’ai décidé d’employer en 1997. Le point suprême est une notion aussi hégélienne qu’ésotérique.
Masao Suzuki – Vous avez écarté les philosophes comme Hegel, Marx et… Freud aussi.
Georges Sebbag – Oui, ou plutôt je les ai remis à leur place.
Masao Suzuki – Une des grandes découvertes de ce livre est que le Hegel de Breton vient de Maurice Barrès.
Georges Sebbag – C’est étonnant que Barrès soit, pour Breton et Aragon, l’intercesseur en matière philosophique. Barrès s’est beaucoup étendu sur Kant et sur les philosophes du XIXe siècle tels que Hegel et Proudhon.
Masao Suzuki – Vous avez aussi souligné l’importance de la lecture de Berkeley pour Breton.
Georges Sebbag – Oui, et de Schelling aussi. Dans un tout autre contexte, la rencontre avec Jean Paulhan est une clef pour ce qui concerne la question du langage. J’ai aussi insisté sur la découverte vraiment décisive de Poésies d’Isidore Ducasse, qui est presque une déclaration philosophique. Il y a là une logique non seulement de la morale – même s’il s’agit là du retournement des maximes des moralistes – mais une logique de l’écriture. C’est un apport essentiel, qui me permet d’introduire la notion du « point d’indifférence » qui est une traduction pour moi d’un certain « point de l’esprit » du Second manifeste. Dès 1919, Breton et Aragon se demandent comment évaluer l’un et l’autre, Les Chants de Maldoror et Poésies. Ils ne disent pas que « l’un surmonte l’autre ». Il y a deux régimes parallèles qui leur apparaissent aussi nécessaires l’un que l’autre.
Masao Suzuki – Vous avez donc redécouvert la notion d’indifférence qui avait été le sujet de votre thèse.
Georges Sebbag – Oui, j’ai écrit mon diplôme, de l’automne 1964 au printemps 1965, c’est-à-dire au moment où j’étais vraiment dans le groupe. Mais à ce moment-là je n’ai pas tenu à m’exprimer sur ce sujet dans le groupe.
Foucault, Roussel, questionnement sur le langage
Masao Suzuki – Mais vous avez maintenant un autre projet de publication concernant, cette fois-ci, le surréalisme d’après la Seconde Guerre.
Georges Sebbag – J’aurais pu poursuivre et parler de ce qui s’est passé dans les années 40, 50 et 60. J’aurais pu évoquer des gens qui sont intervenus à cette époque : Georges Henein, Gérard Legrand… Mais au lieu de le faire, je me suis concentré sur le mouvement de pensée qui était à ce moment-là en train de naître ou de s’exprimer. J’ai décidé de limiter mon champ d’observation à deux penseurs : Michel Foucault et Gilles Deleuze. Mon hypothèse est que, étant donné le faible rayonnement du groupe surréaliste dans les années 50 et 60, on pourrait croire que les idées surréalistes étaient inexistantes chez Foucault et Deleuze. Or il n’en est rien.
Foucault était un militant communiste au début des années 50, mais il s’intéressait alors à la phénoménologie et à la psychanalyse. Rappelons-nous un de ses premiers textes, son Introduction au Rêve et l’existence de Binswanger. À l’instar des surréalistes, il ne se focalise pas sur l’interprétation du rêve. Mais l’essentiel est ailleurs : Foucault cite ici Breton, sans le nommer : « son infracassable noyau de nuit ». Une expression qu’il remet en valeur, à la mort de Breton, dans un fameux entretien qui ne se réduit pas à un hommage de circonstance.
Masao Suzuki – Donc au courant des années 60, chez Foucault…
Georges Sebbag – Oui, il y a chez Foucault un certain surréalisme, mais cela ne se manifeste qu’à partir de l’étude sur Raymond Roussel publiée en 1963. Cette compréhension de Roussel, ça va donner un pli à la pensée de Foucault.
Dans son livre sur Roussel, Foucault critique un peu, certes, l’interprétation initiatique que Breton donne de Roussel et se montre plus aimable pour Leiris, mais tout ça est secondaire. L’essentiel est qu’il s’exerce à penser et à écrire en lisant Roussel. Il se demande comment le langage peut être utilisé pour penser. Cela l’a amené à chercher – par quel procédé – il pouvait penser.
Masao Suzuki – Je comprends bien que le questionnement sur le langage existe au centre de la pensée de Foucault et que cette pensée a été déterminée par Roussel et aussi probablement par le surréalisme. Mais ce qui complique les choses, c’est que depuis les années 70, le questionnement bien poussé sur le langage s’appuyant sur les auteurs comme Roussel ou Mallarmé est donné comme opposé au surréalisme et surtout à l’écriture automatique, et cela tout d’abord par la génération de Tel Quel. Vous pensez donc que cette opposition n’existe pas ?
Georges Sebbag – Non, il n’y a pas là d’opposition. Je voudrais bien le montrer. Un personnage très important dans cette problématique, c’est, je crois, Maurice Blanchot et la façon dont il analyse l’écriture automatique. Blanchot cite une phrase très connue du premier Manifeste : « Fiez-vous au caractère inépuisable du murmure ». Et c’est aussi la phrase qu’on va retrouver tout le temps chez Michel Foucault. À partir de là, on voit bien que l’opposition dont vous venez de parler ne fonctionne pas. L’écriture automatique et le procédé ne sont que deux façons différentes de donner la primauté au langage.
Deleuze, Jarry, travail à deux
Masao Suzuki – Mais vous mettez en scène également Gilles Deleuze.
Georges Sebbag – Dans les années 80, Deleuze a écrit un article intitulé « Jarry, précurseur méconnu de Heidegger ». Mais dans les années 60, il avait déjà donné cette indication selon laquelle Jarry était un précurseur de Heidegger. J’ai été frappé par cette idée, et en quelque sorte je l’ai reprise pour écrire un chapitre : « Heidegger en futuriste et surréaliste ». Plusieurs éléments de L’Être et le temps sont amorcés par le futurisme. En ce qui concerne la relation de Heidegger avec le surréalisme, on peut remarquer par exemple que Matta a recours à l’expression « l’être au monde » qui est une traduction de Dasein. Un des ses tableaux de 1960 s’intitule Être hommonde. C’est seulement un exemple. Mais mon idée est qu’il y a, outre Jarry, des apports futuristes et surréalistes chez Heidegger. En outre, je trouve que la pensée de Jarry est à l’œuvre chez Deleuze. Dans Les Nuits et les jours, on trouve la notion de « Rhizomorhododendron » (Livre V, chapitre IV). Plusieurs notions de Jarry sont présentes, surtout dans Mille plateaux. Et si Deleuze s’intéresse à Jarry, il ne s’éloigne pas tellement du surréalisme.
J’ai dit dans ce livre que Foucault était la doublure de Roussel et que Foucault et Deleuze formaient un couple dans les années 60. Mais ce n’était pas officiel.
Masao Suzuki – Si vous parlez de Mille plateaux, quel a été l’apport de Guattari dans tout cela ?
Georges Sebbag – Guattari joue un peu le rôle de Philippe Soupault dans le surréalisme, n’est-ce pas ? Je plaisante, mais… Ce côté double de Deleuze-Guattari est essentiel pour le surréalisme. Il faut travailler à deux. Des gens qui pensent que leur pensée fonctionne à deux, ce sont des surréalistes à mes yeux. J’ai montré dans Potence avec paratonnerre que le projet philosophique surréaliste a été lancé par un duo, par Breton et Aragon, mais qu’il s’est plus ou moins figé quand Aragon est parti. Cette histoire a été relayée, à mon sens, par Foucault et Deleuze. C’est pour cela que j’ai choisi le titre Foucault-Deleuze, Nouvelles Impressions du Surréalisme.
Masao Suzuki – En revenant au Point Sublime pour finir, je voudrais bien remarquer qu’un des grands mérites de cet ouvrage ainsi que de toute cette série des Imprononçables est de nous donner la possiblité, si l’on peut dire, de partager ce travail à deux avec les surréalistes. Ce n’est pas un travail à deux comme celui de Breton et d’Aragon bien sûr, mais au moins quelque chose comme la relation que Breton a connue par rapport à Rimbaud. Je répète que c’est une façon de rendre les apports du surréalisme effectifs pour nous.
Georges Sebbag – Quand Breton découvre le Point Sublime et le torrent Baou il fait surgir Léonie Aubois d’Ashby ; il dressera un autel à l’héroïne du poème « Dévotion » de Rimbaud. Nelly Kaplan ressuscitera à son tour Léonie d’Ashby. On pourrait ajouter que Stanislas Rodanski, « l’avatar de Jacques Vaché », voit son parcours balisé par le Baou de Rimbaud et l’Astu de Nietzsche. Dans cette perspective du temps sans fil, vous à Tokyo et moi non loin de Paris, nous formons aussi un duo et franchissons les barrières. Nous contribuons à rendre effectifs et vivants les procédés, automatiques ou non, inventés par les surréalistes.
18-19 mars 2014, Authon la Plaine
Références
« Entretien de Georges Sebbag avec Masao Suzuki » est inédit en français. Traduit en japonais par Masao Suzuki, il figure en fin de volume de la version japonaise du Point Sublime parue en octobre 2016 aux éditions Susei-sha de Tokyo.