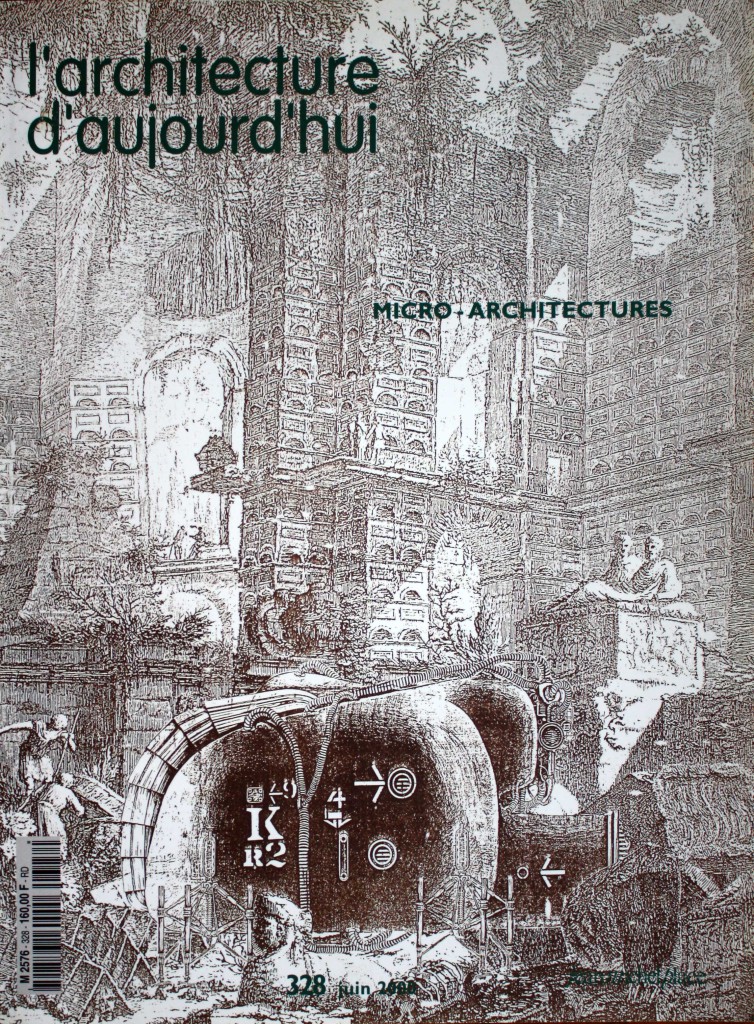
Au cœur de la déflagration, de la pire des destructions gît encore un abri, une niche ou un nid. Du Charlot soldat de la Grande Guerre, le spectateur garde en mémoire le Poilu en uniforme et en armes complètement assoupi au fond de sa cagna inondée.
Jacques Vaché, le dandy des tranchées, donne dans sa correspondance[1] une idée assez juste de ces résidences souterraines qu’une « marmite », un « cylindre » ou un « thé-tango » transforment soudain en concessions à perpétuité pour les hôtes de passage. Quand il veut rassurer sa maman, le jeune soldat Vaché vante l’installation de son cantonnement souterrain : « la tranchée est très bien installée, profonde avec des petits “gourbis” blindés très confortables. Il est dommage que je n’aie pas un appareil photog., je t’enverrais une image de la “villa 3-pommes” que j’habite » (24 juin 1915).
Le soldat dans la soue
À son père colonel, il narre les infortunes de la guerre : « Nous avons eu à reconstruire presque continuellement nos tranchées bouleversées par de monstrueuses torpilles […] J’ai été projeté avec les débris de mon gourbi et de mes affaires, et enterré » (28 juillet 1915). Peu de temps après, il déclare occuper en compagnie d’officiers « un vaste gourbi, ancienne retraite d’un colonel allemand », « le dernier mot du luxe de tranchée ». Il explique que l’ancien locataire « avait fait apporter tout un mobilier, avait fait tapisser, planchéier, plafonner sa chambre comme une chambre de bon hôtel » et précise même : « Et la traditionnelle pendule affectionnée des boches n’y manquait pas ! ».
Un mois plus tard, Vaché se retrouve en Champagne Pouilleuse, « dans le plus sale secteur de tout le front », entre Perthes et Beauséjour, dans la fameuse tranchée des Cadavres. Dès qu’il se replie « en 3e ligne, dans un somptueux gourbi blindé », il ne manque pas de décrire son « palais ». Il joint un dessin du mobilier (table, siège, étagère, lit-hamac) et donne un croquis montrant que sa « villa Beauséjour » est en fait une cagna recouverte de troncs de sapin et de tôle ondulée et enfouie sous deux mètres de terre.
Seule la distance ironique du dandy bombardé dans sa tranchée peut travestir un gourbi en palais, une cagna en villa. En avril 1917, Jacques Vaché séjourne dans un village en ruines. Cette fois il a élu domicile dans un « trou-à-cochon ». Il confie à sa mère : « Les boches n’ont pas laissé une chose qui ne soit broyée ou brûlée, arbres fruitiers, maisons, meubles, instruments agricoles, tout est saccagé – Je suis actuellement entre quatre petits murs de brique restés intacts, et que j’ai fait tant bien que mal couvrir par mon ordonnance – Je suppose que c’est une étable à cochon – Mais j’y ai travaillé hier, et c’est maintenant très présentable – tendu de couvertures propres, un vieux tapis par terre – un lit fabriqué et même un petit poêle ! – Mais une fois entré on est à peu près forcé de choisir entre sortir ou se mettre sur le lit – J’ai épinglé des dessins aux murs et les Anglais appellent mon logement “your little boudoir” – Malheureusement ça va recommencer à “barder” avant trois ou quatre jours – » Quand il s’adresse à André Breton, l’évocation de la singulière demeure est plus expéditive : « Je vous écris d’un ex-village, d’une très étroite étable-à-cochon tendue de couvertures – Je suis avec les soldats anglais – Ils ont avancé sur le parti ennemi beaucoup par ici – C’est très bruyant – Voilà. »
Mais ce sont deux lettres à l’infirmière et marraine de guerre Jeanne Derrien qui indiquent le mieux comment les contes, les jeux, les confitures de l’enfance réenchantent encore les lieux dévastés : « J’ai quitté la tente pour aller dans un autre ex-village – proprement brûlé et miné – sans parler des trous d’obus – Mais je ne suis pas dans ces horribles souterrains allemands et puants, à quelque trente mètres sous terre. J’ai trouvé un coin merveilleux – un ex-abri à cochon en brique – (comment n’est-il pas démoli ?) – c’est très confortable – je l’ai fait tapisser par mon ordonnance de couvertures et fait ajuster une manière de toiture – (celle qui abritait le sommeil du dit cochon était tout de même démolie) – C’est de là que j’écris ces lignes – C’est un peu petit, mais j’ai tout de même à côté de mon lit de camp, la place d’une MARMELADE AND JAM, avec, dessus, l’éternel carré de dentelle et les dessins favoris – well. » Comme s’il revisitait le conte des Trois petits cochons, Vaché n’habite-t-il pas la maison de briques du troisième petit cochon ? À la différence de la maison de paille et de la maison d’épines, mais aussi de tous les bâtiments humains, son abri-à-cochon n’est-il pas le seul a résister au souffle et aux frappes de tous les bombardements ? D’ailleurs c’est dans un langage quasi enfantin et animiste qu’il exprime son inquiétude : « Les canons tirent la nuit à perdre haleine, et j’attends incessamment les briques de mon boudoir (je vous écris toujours de mon trou-à-cochon) à prendre leur décision de tomber. »
Jacques Vaché rejoint un îlot de son enfance quand il aménage, dans un paysage désolé, sa villa Trois-Pommes ou son trou-à-cochon.
Le philosophe en son poêle
Le 10 novembre 1619, René Descartes lui-même, qui s’était engagé dans l’armée du duc de Bavière, isolé dans un village et enfermé dans un poêle, n’a-t-il pas eu, dans des conditions propices à une méditation et à un rêve, la révélation subite de l’unité de la science ?
C’est ce jour-là et cette nuit-là que s’imposèrent à lui, ainsi qu’il l’écrit au début de la seconde partie du Discours de la méthode, les fondements d’une philosophie nouvelle et la métaphore architecturale afférente à cette refondation : « J’étais alors en Allemagne, où l’occasion des guerres qui n’y sont pas encore finies m’avaient appelé ; et comme je retournais du couronnement de l’empereur vers l’armée, le commencement de l’hiver m’arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui me divertît, et n’ayant d’ailleurs, par bonheur, aucuns soins ni passions qui me troublassent, je demeurais tout le jour enfermé seul dans un poêle, où j’avais tout loisir de m’entretenir de mes pensées. Entre lesquelles, l’une des premières fut que je m’avisai de considérer, que souvent il n’y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces, et faits de la main de divers maîtres, qu’en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsi voit-on que les bâtiments qu’un seul architecte a entrepris et achevés, ont coutume d’être plus beaux et mieux ordonnés, que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder, en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d’autres fins. » Entré soldat dans une chambre de village chauffée par un poêle de faïence, le jeune Descartes en sortit le lendemain philosophe. Il fut d’autant plus assuré d’avoir découvert l’unité du corps des sciences et l’unité de la philosophie et de la sagesse qu’il eut trois songes consécutifs dans la nuit du 10 au 11 novembre qu’il interpréta en ce sens.
Le jeune Descartes en s’enfermant dans son poêle a pu dessiner la maquette de la philosophie moderne. Le soldat Vaché, quant à lui, a disposé de son trou-à-cochon comme d’une échappée sur son enfance et a sans doute fait montre d’une « désertion à l’intérieur de soi-même », pour reprendre l’expression qu’utilisera Breton dans l’Anthologie de l’humour noir.
L’enfant et la soucca
On pourrait ajouter à ces deux abris provisoires consacrés à la méditation ou à l’humour, un troisième abri possédant une forte charge symbolique. Je veux parler de la soucca de mon enfance à Marrakech, de la cabane ou de la hutte que mon père édifiait chaque année sur la terrasse du petit immeuble à un étage où nous résidions. La fête juive de Souccot, la fête des cabanes ou des tabernacles, intervient juste après le Jour de l’An et Kippour. Les Juifs pratiquants, en souvenir de l’Exode d’Égypte, en souvenir des Hébreux qui pendant quarante ans errèrent et campèrent dans le Sinaï, se doivent de confectionner une cabane où ils prendront leurs repas huit jours durant. Cette fête qui se situe au début d’octobre est aussi destinée à honorer les récoltes de l’année. À Marrakech, la soucca était montée en moins d’une demi-journée, l’armature de roseaux étant garnie de branches de palmier. Souvent on fixait sur les parois intérieures des tentures ou des tapis aux couleurs vives mais comme la consigne était de laisser passer la lumière du jour ou du ciel étoilé le toit supportait uniquement des branchages ou des produits de récolte. Un détail pittoresque : on suspendait à une paroi une chaise garnie d’un beau coussin, siège réservé au prophète Élie.
Pour un enfant des années cinquante, le fait de déplacer la table familiale hors de la salle à manger, pour l’installer en plein air sur une terrasse ou dans un patio, et qui plus est dans un environnement de branchages, représentait une formidable sortie du milieu domestique et urbain, un curieux vagabondage comparable en partie à l’expérience du camping, et surtout une étrange transfiguration de l’espace, une révélation soudaine d’une clôture en plein air, c’est-à-dire d’un lieu détaché du reste, presque arraché au monde. Et comme je jouais souvent sur cette terrasse d’où je pouvais contempler le rempart de la rue, toucher du doigt un gigantesque mûrier surgi de la cour d’un atelier d’emboutissage de bouteilles de Coca-Cola, m’étonner de la haute stature de la Koutoubia, ou plonger dans le bric-à-brac de l’artisan peintre Negrini, et comme j’avais en somme une certaine idée du plan de la ville, c’est à la soucca, à cette loge précaire en contact presque avec le ciel, à ce tapis volant si l’on veut, ou plutôt à ce campement, à ce chapiteau ambulant, c’est donc à la soucca clôturée sur elle-même et ouverte sur le ciel que je suis peut-être redevable de la conviction mienne que le temps habite l’espace.
L’émerveillement apporté par la soucca est comparable au saisissement du cinéma en plein air. La nuit, le cinéma en plein air inscrit ses images magiques dans le cosmos. La soucca à ciel ouvert accapare l’imaginaire, huit jours et huit nuits par an. Les deux servent de station au temps et de transition à l’espace. Dans un champ de ruines, Vaché fait aussi surgir le temps de l’espace : « […] et nous passons notre temps assez mélancoliquement sous une vague hutte de toile et de tôle ondulée où grésille l’averse, en écoutant Miss Phyllis Dare ou Fragson nasiller dans le gramophone ; l’eau passe un peu à travers un peu partout, et c’est bien amusant ! »
Georges Sebbag
Notes
[1] Jacques Vaché, Soixante-dix-neuf Lettres de guerre, Jean-Michel Place, 1989 ; Quarante-trois Lettres de guerre à Jeanne Derrien, Jean-Michel Place, 1991.
Références
« La cabane à ciel ouvert » paraît dans L’Architecture d’aujourd’hui, n° 328, juin 2000. En français et traduit en anglais.


