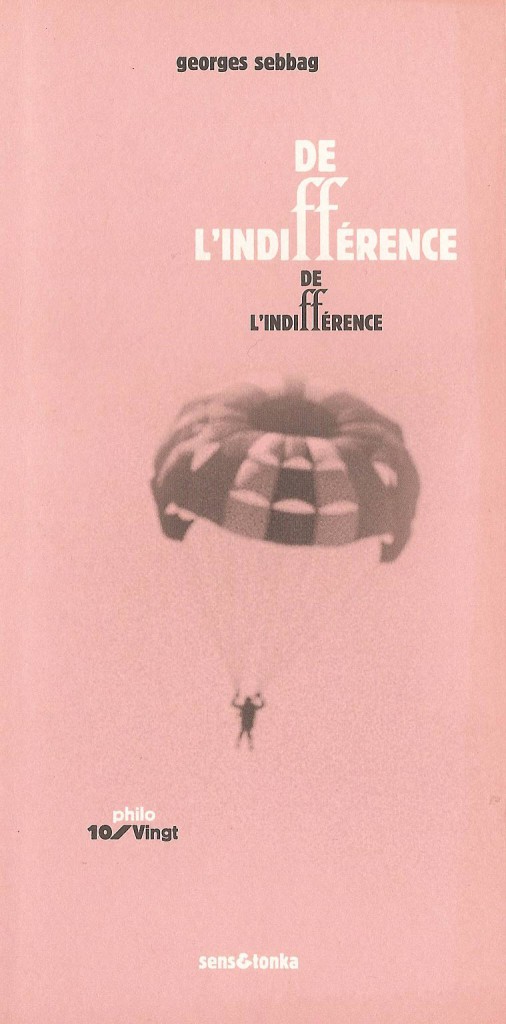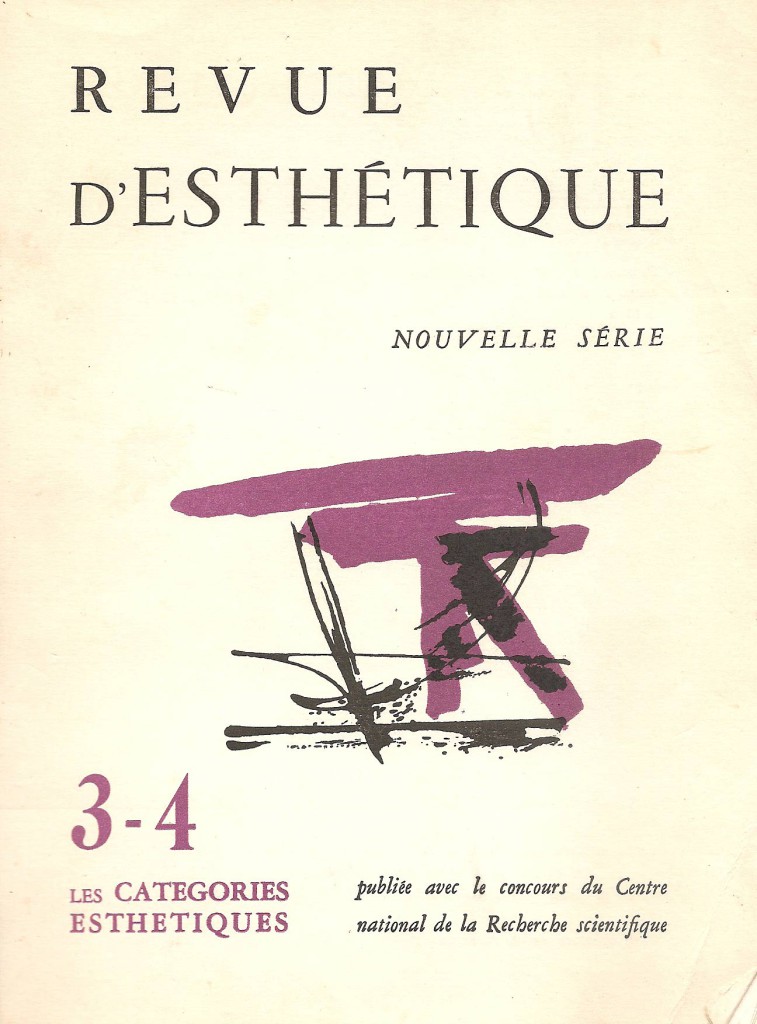
A) PAYSAGES
L’espace de l’indifférence est souvent le calque des paysages naturels. L’indifférent, homme sans qualités, n’habite nulle part et se fixe cependant en certains lieux.
Pétri d’irrésolution, d’irréalité, il n’est pas saisi par le démon de l’errance ; il ne s’attache pas à une terre particulière. D’où est-il ? “À force de vague et d’équivoque, il est d’ici, et il n’est pas d’ici”. Un détachement s’opère en lui ; la double-vue lui est acquise ; il régit à peine l’espace d’ombre qui se profile à l’infini ; il marque l’écart entre une représentation indécise et une autre non moins incertaine : “une ombre aux prises avec des simulacres, un somnambule qui se voit marcher, qui contemple ses mouvements sans en discerner la direction ni la raison”[1]. Désormais les divers rôles du moi se réfèrent aux étendues environnantes ; débarrassé du masque de l’acteur, l’homme de nulle part contemple un grandiose spectacle, l’infinité de la nature aux quatre éléments souverains : “l’immensité du désert est comme un gouffre pour l’esprit […] Le monde lui apparaît le théâtre d’une agitation vaine ; il n’aspire qu’à s’en retirer. Il s’enfonce dans le sable mouvant de l’indifférence et bientôt ne montre plus aux autres que le fantôme de son véritable moi”[2]. Poursuivre le jeu du spectateur détermine une confrontation en règle entre les êtres et le décor qui les entoure ; l’espace esquisse une de ses prétentions à gouverner l’intimité des hommes ; il déteint sur eux, sur les choses aussi, qui perdent leur cachet naturel. Le paysage de l’indifférence provoque un changement, en revêtant d’artifice les objets et les gens, qui n’abdiquent pas ; un compromis se dégage, l’automate imite la vie, de même que l’indifférent copie les grands espaces : “était-ce le fait de ces couleurs tristes, était-ce la lumière du soleil couchant, blême, faible, épuisée par la brume, les choses et les êtres avaient un tel air d’indifférence, d’insensibilité machinale, qu’on les aurait crus échappés d’un théâtre de marionnettes”[3]. Progresser dans l’esthétique de l’indifférence, c’est voir la réification s’accentuer ; l’espace s’enveloppe d’un double : procédé caractéristique ; les écorces s’additionnent et le noyau des choses se durcit : “à son approche, chaque arbre se couvrait d’un vêtement d’indifférence, chaque pierre se faisait pierre pour elle-même”[4]. Après le stade du calcul des couches spatiales, des masques réifiés et des apparences aussi troubles que l’ombre, l’éclatant flou de l’indifférence projette son soleil vacillant ; et le beau paysage est pris à son piège, s’éblouissant de lumière ; l’optique indifférente prend une photo bougée et indistinctement, objectivement le même espace flou modifie les traits des corps et des objets : “les êtres, les paysages se présentent “voilés” comme une plaque de photo ; il a pourtant tout fait pour les saisir en plein dans le vif, mais il ne garde d’eux qu’une impression confuse ; il ne sait pas les “cadrer”, il n’arrive pas à les prendre dans un bon éclairage”[5]. Le raté optique de l’indifférence est parfois provoqué par une excessive luminosité ; l’opacité de la chose est mise en doute ; sa transparence est visée ; à force d’élimination, le flou primordial s’installe dans l’espace du vide, qui est aussi le vide de l’espace.
Le processus d’évanouissement de la réalité humaine dans un paysage naturellement infini se déroule de même pour le vide ; d’abord au niveau du langage ; à la légère omniprésence de l’espace vide répond le creux de la parole : “la caractéristique de la chambre est son vide […] Mais, dès qu’il veut la décrire, elle est vide, et les mots dont il se sert ne recouvrent que le vide”[6]. La mainmise du paysage vide sur les êtres qui l’habitent est fatale ; comme avec le tranquille secours de la contemplation, la diversité s’étale dans le vide ; on rêve d’une personnalité diffuse : “le vide de ma tête se dissoudrait avec une infinie douceur dans le vide du panorama !”[7]. Si l’on pousse à l’extrême l’annihilation de l’espace, l’unité à la fois abstraite – l’indice à l’état pur – et concrète – une réelle décantation – du vide se manifeste ; ses signes sont la limpidité et la pureté virginales : “ au sommet la fine pointe de l’unité : là il n’y a plus rien que blanc sur blanc, neige, silence, air raréfié, vide incolore, virginité maximale ; une symphonie en blanc majeur ! Le pluriel s’effile en unité simplicissime”[8]. Mais le vide de l’indifférence demeure aux antipodes de la perfection ; il l’effleure, il ne s’y complaît jamais. Ainsi tout un tableau nocturne est peint grâce au scintillement des astres et des fleurs ; afin que l’on mesure l’impossible vide de la nuit, la voie lactée est sollicitée ; et l’embrasement du jardin ne sera jamais visible : “on avait inventé les fleurs qui étaient à la fois colorées et parfumées, les étoiles qui brillaient et donnaient des présages pour que le jardin et la nuit fussent désespérément vides, irrespirables et invisibles”[9]. Néanmoins si le vide échappe à la pleine lumière de midi et de minuit, il favorise un lieu où le voile de la virtualité suspend la durée des êtres ; l’espace retenu – non oublié – exprime l’attente, et par conséquent la mise en place d’un intervalle absolu, dont l’infinité ne saurait être appréhendée. Le vide, s’il se cantonne dans les écarts, comme pour mieux faire ressortir sa distance indéterminée, devient un lieu de jonction et de séparation : “entre eux, comme ce lieu avec son grand air fixe, la retenue des choses en leur état latent”[10]. En fin de compte, le vide conduit aussi bien dans l’illimité que dans une limite riche d’indétermination ; il se décolore, laisse quelquefois une trame transparente, stimule les horizons frappés de lumière ou d’obscurité ; bref, le vide de l’espace peut engendrer l’équivoque, la perfection, voire le surnaturel à travers les immensités homogènes ou les intervalles hétérogènes. La matière devient un nulle part dans lequel l’imagination vogue d’abord (d’une façon vague), puis construit le plus étonnant édifice (idéalement, s’entend), enfin repose en sûreté, comme si une harmonie divine commandait cela (le sacré couronne le vide, cet au-delà de la matière) : “il chercha à nager non plus dans la goutte d’eau, mais dans une région vague, idéale, qui était ici et non pas là, quelque chose comme un lieu sacré où il se serait trouvé dans la matière même au-delà de la matière. Il avait la pensée secrète que ce lieu était si bien approprié qu’il lui suffisait d’être là pour être ; c’était comme un creux imaginaire où il s’enfonçait parce que, avant qu’il y fût, son empreinte réelle y était déjà marquée”[11]. Le vide de la matière n’est autre qu’un des éléments naturels sur lequel l’indifférence a en quelque sorte prise, l’eau.
Sur l’eau, le flottement de l’indéterminé est à son aise. Le vide est une introduction aux paysages de l’océan, au glissement d’un volumineux solide sur la vague (comme s’il était lesté de tout poids) ; une vision majestueuse et exemplaire s’impose, avec un aperçu brumeux (apparition et disparition lentes) et un éclat soudain (surgissement d’une surface nette et étincelante). Le vide suscite les divers procédés qui décrivent l’espace de l’eau, et l’indifférence se reflète dans le miroitement des images réelles ou surréelles : “il lui semblait qu’il contemplait le vide dans l’intention absurde d’y trouver quelque secours. Pourtant un bateau sortit du brouillard, lentement d’abord puisqu’il disparaissait à intervalles réguliers dans des ténèbres qui ne consistaient que dans cette disparition, puis il surgit si près que Thomas aurait pu déchiffrer les inscriptions qui brillaient sur la coque s’il avait voulu s’en donner la peine. Était-ce parce que le bateau était vide ? Il le laissa s’éloigner avec autant d’indifférence que s’il avait distingué dans cette image une promesse illusoire et il continua de nager”[12]. Une liaison presque intellectuelle existe entre le vide et l’eau : l’eau fait le vide. Une des plus importantes visions de l’indifférence est alors donnée, étant entendu que l’océan recèle un gigantesque vide : à la faveur de la nuit, l’homme de 1’indifférence se confond naturellement avec les deux surfaces indéfinies – mer et ciel –, et se laisse bercer dans une barque plate par la sourde puissance de l’océan. Suspendu dans le vide de l’eau, contemplant la limite de l’horizon, endormi dans un radeau qui glisse sur un plan illimité, l’indifférent se sent en pays de connaissance et pour cette raison s’égare dans cet espace à perte de vue – espace de nulle part peut-être : “le caractère illusoire des choses fut encore confirmé en moi par le voisinage et la fréquentation assidue de la mer. Une mer qui avait un flux et un reflux, toujours mobile comme elle l’est en Bretagne où elle découvre dans certaines baies une étendue que l’œil a peine à embrasser. Quel vide ! Des rochers, de la boue, de l’eau. […] Puisque tout est remis en question chaque jour, rien n’existe. Je m’imaginais la nuit sur une barque. Aucun point de repère. Perdu, irrémédiablement perdu ; et je n’avais pas d’étoiles. Il en résultait une quasi parfaite indifférence, une apathie sereine – l’état du dormeur éveillé”[13]. Le vide et l’eau portent en eux l’espace de l’indifférence, mais dans les paysages envisagés jusqu’à présent on hésite entre des lieux vagues, flous, idéaux, irréels ou absolument tranchés. L’indifférent considère avec des yeux neufs la nature ou simplement le visible ; or, l’équivoque des paysages demeure : est-ce que les surfaces infinies se mélangent, se séparent violemment ou engendrent un flottement ? On peut insister sur l’élément liquide, propre à donner naissance aux confusions en question : on survole l’eau, on glisse sur l’eau et on plonge dans l’eau. Pourtant l’équivocité de l’eau n’explique pas la sorte d’ubiquité qui a envahi l’espace indifférent. Dans la confrontation de deux plans infinis, y a-t-il juxtaposition, interpénétration ou évaporation (comme le moi de l’indifférent qui s’évanouit) ? En tous les cas, comparer les deux surfaces conduit au cœur du problème : “l’étendue de la mer se confondait avec une de ces landes désertes où le passant finit par douter de sa propre existence”[14]. De même si l’on s’arrête à l’acte de nager, on baigne dans une extrême indifférenciation : le corps parodie l’eau ; s’en distingue-t-il ? S’agit-il d’une fusion totale, partielle ou d’un flottement ? On peut choisir l’une de ces solutions (les options analogiques ayant été rejetées) ; la vision esthétique indifférente offre donc un tableau piégé, à l’interprétation malaisée : “il laissa son bras flotter doucement à la surface, comme s’il avait nagé avec un corps fluide, identique à l’eau où il pénétrait”[15]. Complexité d’autant plus réelle qu’interfère la notion de vide : le vide de l’eau confronté avec les différents plans de glissement, de pénétration, de dispersion situe le problème de l’espace indifférent à son juste niveau, comme si une fluidité et une métamorphose essentielles s’en emparaient ; l’imagination a d’ailleurs son mot à dire, mais les visions et les impressions sont là, vivaces : “tout ce qu’il pouvait se représenter, c’est qu’il poursuivait, en nageant, une sorte de rêverie dans laquelle il se confondait avec la mer ; l’ivresse de sortir de lui-même, de glisser dans le vide, de se disperser dans la pensée de l’eau lui faisait oublier l’impression pénible contre laquelle il luttait”[16]. Devant tant de difficultés, il est une extraordinaire vision rapportée par Musil, qui semble résumer les diverses positions pour en tirer la leçon. Le scintillement comme autre expression du flou de l’indifférence fait une entrée fracassante ; grâce aux reflets d’un infini miroir – la surface d’un lac – l’homme est ébloui, et une prodigieuse séparation – entre la terre ferme et la surface des eaux – s’imprime en lui ; on passe par diverses propriétés spatiales : la franche séparation, la fusion et une résultante, le flottement. Quant au seul flottement, il prend ici l’aspect d’une obscure scintillation et s’apparente au flou de l’indifférence : “c’est comme quand on laisse le regard errer sur une grande étendue d’eau miroitante : tout est si lumineux que l’œil ne croit saisir que de l’obscurité, et sur la rive, de l’autre côté, les choses paraissent n’être plus sur terre, mais flotter dans l’air avec une netteté exceptionnelle et subtile, presque douloureuse, presque troublante. On s’exalte et on sombre à la fois dans cette impression. On est lié à tout et on ne peut rien approcher. Tu es de ce côté-ci, le monde de ce côté-là, toi plus que subjectif, lui plus qu’objectif, mais tous deux presque péniblement nets ; et ce qui sépare et lie ces deux éléments d’ordinaire entremêlés, c’est une sombre scintillation, un débordement et une extinction, un échange de vibrations. Vous flottez comme le poisson dans l’eau ou l’oiseau dans l’air, mais il n’y a ni rive ni rameau, plus rien que ce flottement”[17]. Un rapprochement s’impose entre Musil et Blanchot, au moins en ce qui concerne le poisson dans l’eau (vision qui voisine le mythique), sans parler de leurs communes considérations sur l’espace de l’indifférence : “il nagea encore comme s’il était devenu le poisson intérieur de sa propre mer”[18]. Pour des paysages plus familiers, le flottement prend la consistance d’un épais brouillard ; la fonction de l’indifférence consiste à brouiller le contour des choses ; les teintes ternes dominent : “la même indifférence effrayante qui avait pesé l’après-midi durant sur tout le paysage rampait maintenant du fond de la plaine, et derrière elle, telle une traînée de bave, le brouillard semblait coller aux jachères et aux champs de betteraves couleur de plomb”[19]. Après cet inquiétant et sombre flou de l’indifférence, le paysage s’éclaircit et sa teneur simplement géométrique entre en ligne de compte, les plans infinis dans leur distinction et dans leur parallélisme ressurgissent, quoique indéfinissables : “seules seront respectées et vénérées les forêts, l’horizon, toutes les étendues d’eau, en un mot “l’indéfinissable” d’un paysage”[20]. Si l’on prend parti pour la nette séparation, on retombe curieusement dans l’optique du vide, favorable à une singulière translucidité, dont l’étrangeté remet en mémoire les jeux de construction de l’imagination ; les plans infinis chevauchent ; la réalité s’inscrit sur un fond invisible et vide ; l’espace de la coupure et des étendues illimitées frappent l’esprit (comme la peinture frottée de Max Ernst, La Ville entière) car une qualité d’insolite, d’oubli et de démarcation évoque le parallélisme des couches spatiales de l’indifférence : “et pourtant, il reste le même ici comme ailleurs, c’est-à-dire précisément un espace invisible et vide dans lequel la réalité se dresse comme une petite ville de jeu de construction abandonnée par l’imagination”[21]. Mis à part les plans d’artifice dont l’abstraction – ou la poésie – peut dérouter, il suffit de se raccrocher à une description banale du paysage de l’indifférence pour que soit montrée du doigt la séparation existant entre les divers pans de la réalité ; le vide, le silence pétrifient l’espace : “les maisons étaient mortes, les platanes muets, l’air immobile ; un ciel de plomb pesait sur les toits ; dans toute la longueur de la rue, ni ombre ni lumière, rien qu’une soif aride, une attente d’orage”[22]. La question reste en suspens : la coupure – voire la différence absolue – doit-elle prendre l’avantage sur un mélange sans âme ? Si l’intervalle entre les vastes espaces est mis en relief, une vision particulièrement nouvelle, surhumaine même, donne aux étendues d’air et d’eau l’empreinte monochrome d’un bleu royal par exemple. La noblesse du contour et de l’aride espace composent une franche nature, des visions tranchées, homogènes et impérieuses : “le surhumain, c’est sans doute la grandeur de l’élan dans les contours, cette ample sûreté du trait ? Ou est-ce l’immense désert de cette couleur étrangère à la vie ? Le bleu sombre ? Ou le fait que nulle part la cloche du ciel n’est posée si directement au-dessus de la vie ? Ou est-ce l’air et l’eau, auxquels on ne pense jamais ? Ce sont de braves et ternes commissionnaires, d’habitude. Ici, chez eux, ils se dressaient soudain, inapprochables, comme un couple royal”[23]. À l’opposé de ces plans incisifs, brutalement colorés (dont la tendre homogénéité est cependant un gage d’adoucissement), existe la fusion. L’interpénétration des espaces ne se fait pas seulement en raison du milieu fluide, puisque la contemplation amène incidemment un effacement progressif du paysage ; le désintéressement vis-à-vis de l’espace est terriblement ambigu : un détachement a lieu qui distancie les étendues infinies, accentue leur parallélisme (comme dans le cas précédent de l’intervalle absolu et de la netteté des couleurs) et peut aussi bien rapprocher les régions écartées que les confondre. Toutefois ces procédés se rejoignent si l’on songe au propre évanouissement de l’espace, à la constitution d’un vide : bref, le désintéressé (l’indifférence esthétique) peut être comparé à une opération mentale dont la fonction d’abstraction est aussi prompte que celle de concrétisation : l’espace créé possède l’ubiquité de l’imaginaire Aux antipodes des couches spatiales de l’indifférence s’élabore une compénétration des différences, dont le dernier degré ressemble au vide indifférencié : “je veux étreindre ce paysage, me confondre en lui, l’anéantir en moi. Et après quelques heures de contemplation et d’amour, les traits s’effacent, la lumière faiblit, la brume monte jusqu’à moi. Rien n’est plus”[24]. Les paysages, envisagés tout au long de l’indifférence de l’espace, sont essentiellement de deux types ; d’une part, ils paraissent figés, leur écorce se double indéfiniment, une impression d’irréel se dégage de ces ensembles quasi géométriques ou à tendance abstraite : la séparation est leur lot, un écart distribue ces plans infinis et parallèles, violemment teintés (bien que des couleurs homogènes adoucissent parfois leur éclat) ; d’autre part, ils participent d’un flou (dont à la longue on décèle une hétérogénéité ou même un décalage multiplié jusqu’à la dispersion), bénéficient de la fluidité de fusions possibles, et paradoxalement s’ils entretiennent une confusion visant une unicité c’est à cause d’un débordement pluriel, indéfini : le brouillard n’empêche pas que ces espaces imaginaires s’étiolent, se vident de toute substance, l’air et l’eau se déversant alors dans le gouffre du vide ; les deux types de paysages ne permettent guère des définitions rigoureuses ou pures et de ce fait il faut évoquer le flottement de l’espace qui semble être l’émanation des deux espèces de paysages en question. Le vague, l’indéfini rassemblent aussi bien les espaces uniques, doubles que multiples, parallèles qu’obliques, éclatants que ternes, concentrés que dispersés, de glissement que de fusion ; le flottement de l’indéterminé se fond dans le flou de l’indifférence et de singuliers paysages frappent alors l’imagination ou l’esprit de l’homme indifférent et pourtant presque intéressé par l’esthétique des espaces qui fuient, s’immobilisent ou s’évanouissent à son approche. Une vie secrète anime les éléments naturels ; leur ordonnance comme leur négligé, leur rigueur comme leur hasard appellent une diversité infinie de paysages indifférents. La nature vit, et pourtant l’indifférence fait silence sur son déroulement intérieur ; les images de la nature vibrent comme en un cinéma intérieur, comme en une nature morte, comme en un paysage dont la sévérité écarte le trouble-fête, exige l’indifférence.
B) LA NATURE MORTE
Le passage du paysage à la nature morte est relativement aisé. D’abord, la grande nature aux passages indifférents contient une petite nature, qu’on dit morte. Les choses qui peuplent la petite nature morte comprennent à la limite l’homme, qui se débat entre les immenses espaces et les objets minuscules, à portée de la main. L’homme, articulation entre ces deux faces du monde, se fige de même que les choses familières ont pris le pli de la nature environnante, aux paysages meurtris par l’indifférence. L’homme à l’indifférence ressemble à un tableau représentant les choses (qui n’ont pas fini de copier les grands paysages indifférents) dans leur singularité, isolées de toute sublime référence – insolites –, repliées sur elles-mêmes (ne songeant nullement à dépasser le cadre qu’elles se sont fixé). Ainsi, la nature morte peut déjà prétendre envahir le genre humain : “s’il décrit un personnage, il en fera une peinture comme celle d’une nature morte, fixe, pétrifiée. Les muscles n’y bougeront pas, les yeux seront immobiles, légèrement hagards. La bouche sera toujours ouverte, non pour la parole mais pour le cri”[25]. Ensuite, dériver la nature morte du paysage procure une déduction, un passage efficient entre deux natures séparées seulement par une différence de degré ; avec la contemplation d’une immensité plane surgissent des objets – des natures mortes – qui s’inscrivent sur le fond primitif, parfois à un point tel que la nature morte annihile ou plutôt neutralise le paysage ; elle se dresse alors fraîche – comme un dernier arrivant – et l’horizon en déroute n’est qu’un paravent décidé à la montrer dans son ultime nudité ; le spectateur indifférent abandonne le panorama pour un petit théâtre intérieur ; en somme, le va-et-vient Nature-nature morte rentre dans le champ d’une vision plurielle et précisée de l’indifférent en mal de beaux spectacles : “mais, sous les yeux, on n’a que le désert sans réponse de la mer, et tout ce qui, sur le rivage, garde un sens, se perd dans l’émotion uniforme du spectacle infini. Agathe pensa que toutes les vraies natures mortes pouvaient éveiller cette tristesse inépuisable et bienheureuse. Plus on les considère longtemps, plus nettement il apparaît que les objets qui y sont peints semblent debout sur le rivage coloré de la vie, les yeux remplis d’immensité et la langue paralysée”[26]. L’envergure cosmique de la nature morte (qui se rattache plus ou moins directement aux grands espaces) est indéniable ; se resitue, dans cette direction et d’une manière mythique, l’origine de la nature morte : “au fond, toutes les natures mortes représentent le monde au sixième jour de la Création, quand Dieu et le monde étaient encore en tête-à-tête, sans les hommes !”[27]. L’espèce humaine est un mince feuillet intercalé entre la Nature et la nature morte ; elle tient un rôle mineur, celui de l’absence ; elle ressurgit comme un souvenir latent, mais sans laisser de traces ; l’homme est suggéré, il est l’éternel absent, alors que les natures se reposent ; Blanchot rejoint Musil, à l’aube du septième jour, et décrit à sa façon la paisible attente de toute nature mi-morte mi-insensée, de toute nature indifférente et un rien indifférenciée : “pour la première fois, sans attendre le septième jour, le repos naissait, et il naissait d’autre chose que la fatigue. Ce qui donnait à la ville sa quiétude, ce n’était plus le sommeil et l’approche de la mort, c’était un état où la mort n’avait plus de sens. Le monde qui jusqu’ici n’avait dormi que dans l’épuisement et la détresse, se reposait parce qu’il ne lui manquait rien “[28]. Si l’homme s’exclut de ces natures c’est parce qu’il en participe au plus haut degré : il s’aperçoit que ce qui fait son humanité n’a pas de sens, qu’il collabore au contraire aux natures – indifférentes à l’humanité, à l’inhumanité. Dans ces conditions s’il lui reste à révéler sa différente indifférence, c’est à la nature morte qu’il doit songer ; Ulrich, l’homme sans qualités et Agathe, sa sœur – son double – se sentent paralysés par l’étrange souffle de la nature morte ; n’est-il pas redoutable de trop bien diriger ses intuitions et pensées ? Ne faut-il pas résister à la découverte, la proscrire ? “Interroger à fond l’art étrange de la nature morte, une bizarre analogie avec leur propre vie les en empêchait tous deux”[29]. Une fois surmonté le vide de la surprenante vérité, l’homme et la femme sans qualités sont inconsciemment poussés vers la nature morte, et comme avec nonchalance, ils lui associent tout ce qui peut concerner l’indifférence du monde : “c’est pourquoi involontairement, sans même accepter une définition qui eût pu les guider, ils tournaient leur curiosité vers tout ce qui pouvait avoir une parenté avec l’essence de la nature morte”[30]. L’intérêt de la nature morte étant assuré, il s’agit d’en dégager les traits dans le domaine pictural. Chaque objet se présente dans sa sévère solitude, comme si un verdict de mort s’abattait sur la nature. La disposition de l’ensemble des choses représentées se fait surtout en un ordre dispersé, c’est-à-dire que chaque nature est là pour elle-même, sans le souci d’éclipser la voisine. Ce remarquable isolement institue à la fois la séparation des monades et leur infini déploiement. Le plan d’un objet est cependant en correspondance avec les autres plans, comme si un parallélisme global indiquait en même temps 1’attrait et la répulsion entre ces divers univers, dont les marques de distance soulignent sans doute une cohésion, une solidarité. Que la nature morte tire quelque peu de sa substance des paysages cosmiques, cela est évident : “n’a-t-il pas suspendu un coing et un chou pour les faire tourner et briller comme des planètes dans une nuit sans limites ?”[31]. Mais dans la construction intime des choses laissées à elles-mêmes, l’emploi de formes, de fonds, de tons, d’une part tranchés d’autre part étalés, est seul capable de figurer la vie en tant qu’elle est déposée dans l’objet mais aussi la mort en tant qu’elle est vue, hors de l’objet. Peut-être qu’alors cette vie en instance de mort, ou cette mort vivante telle qu’on désire à tout prix l’observer dans les natures inanimées, nécessite un espace essentiel dans lequel par exemple se fait l’obscurité, quoique la pâleur des lueurs naturelles ou artificielles soit aussi rendue dans le plein jour. L’étalement, l’uniformité, l’intimité des vies silencieuses, exigent une homogénéité, une sûreté du trait et de la surface : la monochromie est de rigueur, comme dans les nombreux paysages de l’indifférence ; si la vie et la mort se distribuent çà et là, elles déterminent des régions d’un seul ton ainsi que le passage à la fois naturel et déchirant d’un état à l’autre, bref une peinture qui ne manque ni d’unité ni de nuances : “La recherche de la monochromie domine l’école hollandaise, entre 1625 et 1640, non seulement dans le genre qui nous occupe mais aussi dans le paysage. Claesz emploie une tonalité uniforme jaunâtre ou brunâtre. Heda la nuance légèrement de gris cendré. À cette dominante il sait soumettre tous les objets. Avec une finesse et un goût inépuisables il multiplie les modulations des gris-vert, des gris-beige, des gris-blanc qu’il réchauffe discrètement d’un rose ou d’un brun”[32]. Toute nature reposée implique un ciel de monochromie et en chaque recoin prend place la différence monochrome, car la monochromie de l’indifférence sait reconnaître en son sein les cantons différentiels, répétitifs mais forcément monochromes ; le flou de l’indifférence admet la diversité, le chevauchement, la juxtaposition des flaques monochromes ; le problème de la séparation, de la fusion et du flottement est ici provisoirement mis de côté, si l’on admet que les trois processus en question interviennent dans les variations du brouillard monochrome : “les brumes de la Hollande ont d’autre part appris aux peintres à discerner les moindres gradations de valeurs, base de la peinture monochrome”[33]. Le paysage et la nature morte ne finissent pas d’évoquer une esthétique indifférente où les fonds prennent des proportions infinies – à la limite, le vide y transparaît ; les natures immobiles sont assemblées et articulées, l’espace de la tranquillité atteint une densité qui ne fait pas oublier la légèreté des voiles mortuaires travestissant la vie des choses : “autour de ses objets Heda a réussi à suggérer un espace illimité, au milieu duquel ils se chargent d’une tranquille pesanteur. Ainsi, isolés dans un néant transparent, ils représentent la solide durée de la matière qui rassure l’esprit. Leur groupement n’est pas laissé au hasard ; toutes les formes se touchent l’une l’autre, s’enchaînent en un ensemble ferme et rythmé”[34]. La composition des natures mortes (on organise parfois leur dispersion) rappelle la disposition géométrique des couches de l’indifférence ; là encore des plans infinis et parallèles se font face sans vraiment se mêler, tout en se touchant. Les diverses structures spatiales gravitent autour de la nature morte – ou de ses cellules, garantie de la survie ; l’objet représente à lui seul une monade, un espace infini et horizontal – dont la perception est aisée ; cependant est suggérée la présence d’espaces invisibles : le vide et sa transparence accompagnent presque toutes les natures mortes quand on pense que par exemple l’un des objets disposés sur une table ne manque pas de déborder ; une nouvelle dimension est introduite ; l’attrait du vide et de l’indifférence joue un grand rôle mais surtout, les espaces ont pris en considération le statut de l’objet paisible, fantomatique, infini, monochrome et translucide ; les couches spatiales de l’indifférence sont avant tout visibles dans la nature morte même si leur incertitude n’a pas complètement démasqué les reflets invisibles d’une vie qui ne sait plus si la mort de Dieu, de l’Homme et de la Nature la touche, la marque et lui insuffle un dernier quelque chose, une indifférence.
La monochromie de la nature morte valorise une couleur, laquelle ? Une couleur de base, composite, irréelle, sombre, voire résiduelle semble réunir les caractéristiques les plus violemment neutres d’une peinture de l’indifférence ; une vertu d’abstraction, proprement philosophique, s’en empare ; que voit-on ? on ne saurait le dire, toutefois il faut que les couleurs aient passé les épreuves de l’eau, de l’air, du feu et de la terre : “Clarisse elle-même […] avait vécu le brusque noircissement du monde : ce n’était pas une couleur réelle, mais une couleur indescriptible ; et plus tard, cette “couleur philosophique” du monde, ainsi que Clarisse la nomma, fut une sorte de terre brûlée”[35]. Parce que cette couleur unique donne à réfléchir, il faut croire que sa raison est de ramasser les autres couleurs, de les évoquer ; couleur de la philosophie, le gris fait penser à toutes les couleurs : “le gris la couleur la plus philosophique, la couleur de la méditation, a dû convenir à l’esprit puritain”[36]. La nature morte ne s’arrête pas à une ascèse abstraite, elle se déploie dans le magnifique apparat d’une couleur multiple, tout en se réservant le moment d’une disparition brutale, d’un effacement qui ne laisserait transparaître qu’un restant de gris et d’indifférence : “elle avait à créer avec ce qu’il y avait en elle de plus éclatant et de plus riche, de plus frivole aussi, son indigence absolue, I’instant privilégié où toutes les couleurs de son arc-en-ciel se fondraient en un gris invisible”[37]. Or selon Paul Klee le mouvement perpétuel de la couleur passe par le gris, véritable condensé spectral ; même si l’on ne s’attache guère aux explications données, on ne peut ignorer l’importance du gris philosophique, du gris esthétique de l’indifférence : “il faut faire appel au concept de gris, au point gris, point fatidique entre ce qui devient et ce qui meurt”[38]. Les propriétés du gris sont alors infinies, et l’on comprend que soit engendrée toute une peinture de l’indifférence qui en dernier ressort ne fait qu’expliciter les prémisses théoriques retraçant l’origine de la vision esthétique : “ce point est gris, parce qu’il n’est ni blanc ni noir ou parce qu’il est blanc tout autant que noir. Il est gris parce qu’il n’est ni en haut ni en bas ou parce qu’il est en haut autant qu’en bas. Gris parce qu’il n’est ni chaud ni froid. Gris parce que point non-dimensionnel, point entre les dimensions et à leur intersection, au croisement des chemins”[39]. Au-delà d’une reconnaissance de l’indifférence dans le gris, il convient de ne pas oublier le cadre général de cette esthétique : flottement de l’indéterminé, étrangeté de la réification, couches spatiales et flou de l’indifférence.

- Allan d’Arcangelo, l’autoroute américaine
Allan d’Arcangelo est un paysagiste de la nature morte. I1 a parfaitement figuré les autoroutes américaines ; dans ses tableaux tout au plus trois plans (monades, natures mortes) nous retiennent : la route (centre optique visant l’infini), la Nature environnante (subdivisée en ciel et panorama d’arbres en rase campagne) et les œuvres d’artifice, signes de l’homme (panneaux en premier plan et parfois un pont de pierre qui semble rejoindre le paysage naturel). Pourtant la nature est morte et par conséquent le paysage aussi. Comment retracer la mort de la nature ? Comment suggérer le règne de l’indifférence ? Comment assumer l’étrangeté des choses, qui ne disent plus une chaude surréalité ou une froide objectivité mais une vertigineuse neutralité ? Nous venons de parler de trois plans infinis, or l’autoroute, pourtant centrale, peut aisément s’évanouir dans la nuit et le lointain, à moins qu’on ne veuille la conserver – puisqu’elle est à la frontière entre l’homme et la Nature ; elle divise le monde – ses pointillés en témoignent – en deux camps : La Nature (arbres et ciel) et les objets d’artifice déposés par l’homme (enseignes, ponts ; l’autoroute aurait tendance à appartenir à ce second groupe). Chaque camp, en dernière analyse, se révèle perdant (ou gagnant) dans la mesure ou une identité souveraine traverse l’univers ; pour l’instant constatons que les signaux (code de la route ou publicité) nous masquent le paysage ; leur luminosité, leur artificialité, leur chatoiement mettent en avant les derniers reflets accrocheurs de l’écriture humaine ; une sombre technicité pèse sur ces marques de l’homme absent ; elle dénote une brillance vouée aux colorations indifférentes qui ont envahi les paysages naturels ; ces derniers en effet, ont une présence mortellement simple : la monochromie du ciel et du découpage d’arbres est accablante ; le bleu plaqué du ciel est un exemple parfait d’une abstraction spatiale : plan infini, horizontal et homogène ; de même le vert foncé du paysage nous procure l’ombre (la doublure) de la Nature, découpée allégoriquement sur le fond d’une autre couche d’indifférence ; le ciel et les découpages d’arbres sont vus comme des entités abstraites, réduites au minimum de la monochromie. Les surfaces éclatantes de l’artifice participent aussi de cette indifférence du paysage ou des natures mortes, ce qui donne une unité monochrome à l’ensemble du tableau. Les couleurs sont souvent complémentaires ; les surfaces se détachent pour mieux se confondre dans la neutralité du tout. Parfois une même réalité est figurée sous quatre points de vue différents : carte routière, photographie d’une route de montagne, copie de la photo en noir, blanc et bleu, dessin de la copie (comme vue dans un miroir) en gris et blanc ; ces quatre figurations mettent en jeu des doublures (c’est-à-dire des répétitions plus ou moins exactes) et une abstraction, au travail réducteur (ainsi, les couleurs disparaissent pour aboutir au gris). Pour comprendre l’intérêt que nous portons à Allan d’Arcangelo, il faut voir que l’autoroute américaine exalte, quasi métaphysiquement, l’état culturel contemporain : la Nature (la bordure d’arbres, le ciel) est l’ombre éclatante de ce qu’elle est ou pourrait être (on croit le deviner, tout au moins) puisque son infinité est à peine esquissée dans d’arbitraires, symboliques ou abstraites limites (le découpage des bas-côtés de la route est conventionnel) ou rendue théorique (dans l’implacable monochromie du ciel) ; l’autoroute qui a violé ou transgressé la Nature, continue son chemin monotone, à perte de vue mais là encore abstraitement comme si le goût de l’aventure se réduisait à une perspective géométrique sans lendemain, et qu’une douce contemplation chromatique liait les espaces de nature et d’artifice : la plage de la coupure (c’est-à-dire l’autoroute, dont les deux parallèles se rejoignent presque, à l’infini) est bien là pour dénuder les vastes contrées vierges de la campagne et une juxtaposition (une indifférence) met en relation les mornes surfaces de la civilisation et de la préhistoire. À l’ère du nivellement, l’ombre de la Nature se dresse et le ciel se confine dans un azur. La Nature déflorée, l’homme absent, le spectacle violemment uniformisé, une plate indifférence se laisse voir dans tout paysage : une couche de minium ou de cadmium suscite cette étrangeté de la réification. L’indifférencié est atteint dans le paysage de nuit qui présente en premier plan un panneau publicitaire (sur lequel est inscrite une marque d’essence) : un violet sombre monochrome recouvre la chaussée, les arbres et le ciel ; seul résiste à la propagation du violet le panneau lumineux et indicateur, dernier signe – monétaire – de l’humanité absente. L’art de notre époque, sans les partis pris romantique, classique, réaliste ou même surréaliste, se cantonne dans un exposé mi-engageant mi-dégagé de l’impersonnalité générale comme si un pinceau neutre étalait des surfaces à travers lesquelles la passion et l’individu s’effacent au profit d’une absence nuancée de sentiments et d’un état social déterminé ; alors la sûreté des traits, les masques mais aussi le flou des voiles, la transparence des vernis figurent – avec le secours des travaux réducteurs de l’abstraction – une absence de discours, une équivalence dans la signification, bref l’indépendance de l’œuvre d’art qui se sait traquée par 1’oubli et la mort, car une indifférence veille, prête à pétrifier les forces exubérantes et à déchaîner les cadavres paresseux, bien qu’amoureux de la répétition. L’art et l’artiste meurent comme les paysages et les natures. Un dessin, une tache de couleur ne renvoient plus à une passion, à un homme, à une époque déterminée mais à l’état neutre d’une certaine humanité dont la sensibilité, bien que stabilisée, se nourrit des nuances de cet équilibre indifférent, préfère en particulier ne pas se laisser entraîner dans les tourbillons de l’histoire, et vivre (mortellement, peut-être) une vie neuve et pourtant ancienne, différente mais aussi identique.
- Michelangelo Antonioni, Le Désert rouge
Michelangelo Antonioni est un peintre de l’indifférence dans Le Désert rouge. En sa méthodique exposition, les nuances du flou de l’indifférence convergent et nous enveloppent déjà de leur teneur trouble et dense ; le spectateur est invité, tenu à l’écart aussi, alors que les personnages du film traduisent à l’avance ce recul et cette belle fascination. La question fondamentale est posée : jusqu’à quel point est détaché de son œuvre, le réalisateur ? En effet, face à la systématique neutralité du spectateur et de l’acteur, la voix narratrice tend à s’effacer et plus exactement, dans le cadre cinématographique, une vision narrative s’impose – dont les caractères sont l’oubli, l’impersonnalité et la blancheur d’un silence.
Les natures mortes monochromes
Le gris du générique est une annonce inquiète, au travers des couches transparentes et indécises, des brumes entremêlant les machines industrieuses et les lancinants navires. Tel est le voile optique, filet jeté sur les choses et les gens ! Parce qu’il est possible d’avantager les premiers plans en confondant les arrière-mondes, d’enchaîner les fondus, de maintenir des écorces translucides et parfois de suggérer des espaces invisibles, les matières les plus apparentes reflètent l’univers équivoque de la surface et nous initient au jeu esthétique des plans infinis et recommencés. Le thème du voile dégagé, l’indifférence se colorie comme dans ces troublants jets de feu – crachats d’une haute cheminée – qui s’étiolent et se renouvellent sur le bleu uniforme du ciel. Viennent ensuite, dans un passage grisâtre, les capes de verre revêtues par des grévistes, imperméables de quatre sous posés en cloche – transparence et immanence des revêtements parallèles. En attente de pluie (élément suspendu, verticalité tranchante), Giuliana, axe de référence – du tournage aux détours du film –, pivot flottant comme un gyroscope, déséquilibre la notion d’héroïne, dès son apparition : le vert du manteau appelle l’impersonnel. Et lorsqu’elle se perd, aux abords des déchets d’artifice, du gris métallique du paysage, la terre et les feuillages disent le triste verdict, bientôt la monotone sentence : l’homme et la nature sont morts (Dieu étant bien loin derrière) ; parce que cela ne signifie ni l’anéantissement ni le noircissement des choses, mais le gris coloré de l’indifférence, une vie mortelle s’engage. En premier lieu, l’intrusion dans une usine signale le bleu, le vert plaqués sur d’immenses réservoirs, artifice poussé jusqu’au vernis : les tuyaux sont enduits d’une couche protectrice, et du coup l’esthétique enveloppante de la neutralité les touche ; du rouge jaune au gris-bleu, les monochromies s’installent en plans juxtaposés ou sédimentés. Que le rouge rouille émane d’une gigantesque cuve témoigne de l’imprégnation des couleurs, que l’on croyait plaquées : les structures d’extériorité deviennent vite naturelles. Si nous jetons un coup d’œil d’ensemble sur les bâtiments, aucun doute, le gris du béton domine. Un étrange spectacle s’offre à nous, de la fumée gagne peu à peu les tonneaux peints en rouge entreposés dans la cour, envahit démesurément le champ visuel, l’occupe entièrement : le flou de l’indifférence est entré en action jusqu’à ne plus former qu’un brouillard monochrome, en dissipant formes et contours grâce au gris de l’absence de vision (ou de la présence de toute vision possible) ; bref, la limite d’une esthétique de l’indifférence est atteinte : le flou, le voile, les reflets, les plans infinis se rejoignent en quelque sorte. Là, le ciel participe effectivement à cet évanouissement du paysage, à l’habile construction des masques, puisque, de la fumée au gris du ciel, une même couche s’interpose entre nous et le monde, et finit par constituer la seule réalité visible.
La boutique de Giuliana aux murs fraîchement peints est une interrogation sur la couleur : bleu ou vert ? En somme, une expérimentation des couches colorées accompagne l’expérience quotidienne de la coloration du réel. Et la rue où se trouve ce surprenant magasin, vide d’objets, avide de couleurs (comme s’il était destiné à ne jamais accueillir des formes étrangères à la géométrie plane et ascétique des murs, à ne jamais tolérer les tons provocants – débordant l’aquarelle enfantine) nous projette dans le lieu le plus monochrome qui soit, nous situe d’emblée dans la nature morte : les maisons, des deux côtés de l’étroite chaussée, semblent se rejoindre, tant est légère la mise en relief des surfaces ; un vert blanchâtre, témoin de l’écaillement des superficies (et de l’effritement plus intérieur), indique la pâle et douce monochromie de la rue déserte et fantomatique. Pourtant un élément bougé se manifeste : le vent tombe et avec lui une feuille de journal – épisode marqué d’abord par la force d’inertie du vent (autre souffle ou plan invisible), ensuite par l’insolite banalité du geste de Giuliana (plaquant le papier) : journal intime en même temps froissé et défroissé par le hasard, la distraite immobilité puis la marche capricieuse et impérative d’un homme et d’une femme qui s’échappent, glissent et volettent dans le vide absolu de la rue. La chaux a saisi au vif les murs, mais aussi l’étalage du marchand de quatre saisons, assis comme un peintre perdu dans le lointain d’un rêve et attentif à quelque tableau : une baguette à la main lui sert de pinceau. De toute évidence, les légumes ou les fruits (cela n’a déjà plus d’importance) qu’il vend représentent une belle nature morte, traitée à l’étincelante monochromie du blanchâtre ; inutile de faire appel à Cézanne ou à tel autre, il demeure qu’Antonioni a réservé dans cette fameuse rue un coin de nature morte où un autoportrait de peintre participe de cette vie immobile et silencieuse. Après la vision tranquille, les touches de l’indifférence se servent d’autres techniques. Ainsi, dans une scène de marché où le bruit brouille les significations, le procédé du voilement est employé : un simple flou enveloppe les passants, on évalue toutefois les différents niveaux d’importance (le poissonnier, Giuliana et Corrado, les autres : une stratification translucide). De même les zones homogènes d’un gazon vert pâle, les éclaboussures roses de fleurs en avant-plan, la porte en verre opaque posent progressivement les jalons d’un espace esthétique de l’indifférence. Faut-il s’en tenir à l’espace ? Nous le pensons ; pourtant les données d’une clinique de l’indifférence existent : Giuliana parle d’une femme qui voulait tout (nous reconnaissons là l’irrésolution dans le désir absolu), qui sentait le sol se dérober sous elle – de plus, impressions de glisser et de se noyer (le flottement et le glissement des plans psychologiques de l’indifférence entrent en jeu) –, et qui s’interrogeait quasi métaphysiquement sur son être (“qui suis-je ?” c’est un des symptômes du sentiment du vide) ; cette femme, c’est bien entendu Giuliana. Parce que l’indifférence signifie absence de sentiment, il est vain dans ce cas précis d’épiloguer sur la clinique. Et l’espace reprend ses droits, d’abord parce qu’il s’étale jusqu’à l’infini : nous sommes en pays de plaine et d’océan, la Nature est nivelée. Se dressent des constructions d’artifice, des grilles rouge minium et surtout des charpentes métalliques qui écoutent les étoiles – le ciel est un autre grand espace : la vision de ces charpentes chauffées à blanc sur le ciel gris blanchâtre est un signe unique d’une indifférence frappée dans le métal ; le terne éclat du métallique étend sa blancheur à la grisaille de la voûte céleste. Après cette apparition d’un décor à l’emporte-pièce et monochrome, la rase campagne nous accueille, avec ses eaux stagnantes : les résidus industriels amorcent une décomposition des éléments naturels ; le mari, la femme et le futur amant se promènent nonchalamment, comme s’ils ressentaient la lente dissolution de la nature, dont les espaces exigeraient alors une contemplation perpétuelle ; ils se tiennent parfois immobiles, leurs gestes sont ralentis : l’espace a un pouvoir de pétrification : c’est un des moments où ils se figent le plus aisément. Quand Corrado, questionné sur le thème de la politique, parle de sa croyance en le progrès (entre autres choses), une fois encore les données du langage ou de la psychologie des personnages nous paraissent vides : seul compte le spectacle esthétique des espaces indifférents.
Le vaisseau fantôme du vert paradis
L’apparition silencieuse et majestueuse d’un navire, à l’écran, nous plonge dans l’attente démesurée des indifférences : la brume recouvre l’alignement des arbres, un bateau glisse doucement en une forêt enchantée. Dans l’entrelacs du voilé et du glissement, bref dans ce flottement, se concentre l’indifférence, dont les plans parallèles sont déterminables (les arbres, la brume, le navire, et même les appels de sirène). Après les étangs glacés, nous rencontrons la baraque de Max, maquillée de peinture, comme environnée par la mer (guettée par l’océan, toute habitation semble une île). L’eau et la brume se rejoignent pour estomper et rendre incertaine la terre ferme. De plus, regardons de l’intérieur de la baraque la fenêtre : nous voyons passer, en un souple et souverain mouvement, un navire, sur la coque duquel luit un nom[40]. Ce tableau flou et huilé est complété par une fresque, cette fois contemplée de l’extérieur de la maison en bois : la tête de Giuliana s’imprime sur la fenêtre qui forme comme un cadre dans lequel est insérée une photographie (le visage de Giuliana semble tout de surface, coloré dans un grain flou de photo bougée ; en somme, le plan de son visage est réduit à une géométrie à deux dimensions, convenant parfaitement à la structure des carreaux de la fenêtre – plan parallèle et transparent) et qui fait partie du mur de planches extérieur ; la baraque, vue de dehors, s’étale comme une fresque dans laquelle Giuliana se masque et se démasque, en prêtant son visage et ses couleurs aux teintes d’artifice, déposées par l’homme et le temps sur cette cloison de bois : l’espace de l’indifférence a figé la figure humaine dans un beau voile aux tons monochromes. Mais, nous dira-t-on, pourquoi escamoter les scènes qui racontent la vie même des personnages ? C’est qu’il est dangereux de se fier à une contingence fragmentaire et superficielle : la parole et la conduite, en l’occurrence, manifestent un creux, que seules des élaborations inconscientes (comme les espaces indifférents que nous tentons de dévoiler) peuvent combler. Cependant il semble judicieux d’emprunter à la conversation entre Giuliana et Corrado la question sur laquelle nous butons continuellement : “regarder, quoi ?” Le regard glisse sur tout et ne s’attache à rien, comme si un écart absolu entre les couches de l’indifférence empêchait toute fixation. Dans le même ordre d’idée, le cri, signal du départ précipité, est à interpréter (une hypothèse : le cri rappelle celui poussé par le nouveau-né ; de ce fait, si on a crié – sinon le cri a été imaginé et nos explications s’orienteraient du côté des fantasmes –, c’est certainement à l’extérieur de la baraque ; cette dernière symbolisant le fœtus et l’océan, le milieu liquide – dans lequel il flotte –, le cri est ce qui, dehors, appelle à la vie, à une certaine angoisse, mais aussi accompagne notre indifférence, qui est cependant à mettre en relation avec l’atmosphère tiède et indifférenciée du milieu utérin. Une autre hypothèse : le cri ramasse le bruitage de notre civilisation ; il est notre bande sonore). Il est aussi essentiel que le cri de détresse poussé par l’homme supérieur et qui fait sortir de sa caverne Zarathoustra ; or, c’est le devin, prophète de la grande lassitude, c’est-à-dire de l’indifférence, qui fait écouter à Zarathoustra le cri ; qui crie ? L’homme supérieur (ou plutôt les hommes supérieurs) : il est de notre temps, il vit le nihilisme, il traduit éminemment les forces réactives. Le cri nietzschéen et le cri dans Le Désert rouge appartiennent à la même clameur qui dit le malheur et le déchirement, mais surtout nous désigne l’empire de l’indifférence : “le désert grandit : malheur à celui qui recèle un désert”[41]. L’indifférence totale ne crie plus, elle demeure muette : notre existence vogue entre le sentiment du vide et l’état de vide (qu’elle atteint rarement) ; encore en possession de la parole, traquée par le silence, Giuliana finit par se perdre dans le brouillard : premièrement les autres s’immobilisent devant elle, la brume efface leur image (Giuliana semble être à l’origine de ces disparitions, comme si son désir était tel) et deuxièmement elle s’enfuit dans l’espace illimité d’une terre ferme alliée à la mer, et dont le rivage ne doit pas constituer une coupure, mais un pont ou une jetée sur l’océan ; les êtres réduits par le regard angoissé de Giuliana à la fonction d’une image, d’un schème ou d’un support de l’indifférence (les couches parallèles) se diluent aussi dans le flottement et le flou de l’indifférence.
Que le fils de Giuliana remarque qu’une goutte ajoutée à une autre donne une espèce d’unité (1 + 1 = 2 ?), cela nous intéresse au plus haut point : la notion d’indifférencié n’est pas loin. C’est pourquoi nous nous contenterons d’élaguer les séquences et de retenir certains signes annonciateurs d’une sémiologie de l’indifférence (étape dans une typologie et une généalogie nietzschéennes). Qu’un des lieux privilégiés du Désert rouge soit une île flottante, voilà qui nous ramène dans le nulle part des espaces indifférents, dans ce bercement mythique d’une barque au milieu de l’océan ; si nous suivons Corrado dans son hangar désaffecté, nous sommes frappés par l’amoncellement de paniers vides : la répétition des objets est un symptôme de l’inerte, c’est-à-dire de l’infinie juxtaposition du même (et paradoxalement de la différence) ; l’inerte est alors un espace indifférent, ou, si l’on préfère, une objectivation, une réification. Les murs blancs sont à un certain endroit frappés d’une gouttière bleue – long rectangle de peinture qui se divise, après un panoramique, en deux branches : la peinture en bâtiment rejoint alors les placages optiques (agrandissement, uniformisation, trompe-l’œil) du pop art. Quand nous sortons du hangar, une répétition analogue (à la précédente) nous saisit : des cloches ou ballons de verre se succèdent ; l’espace de l’indifférence (ici, à travers la répétition) miroite dans de vertes enveloppes de verre. Jusque dans la maison de Giuliana, le glissement des couches parallèles est visible : les apparitions de navires à travers une fenêtre horizontalement oblongue, nous initient à un glissement de panorama ; la douceur de l’océan, la permanence des masses flottantes sont la garantie d’une présence fluide, propice à tous les frôlements des indifférences. Mais dans quel monde sommes-nous, sur cette plage rose où tout chante ? Le moderne a décollé, la Nature nous est restituée (si une telle Nature existe), bref nous sommes au paradis[42]. Une esthétique appropriée est alors utilisée ; la vie de la Nature, est-ce la mort de l’indifférence ? Nous ne le croyons pas, puisque, même dans la pureté cristalline du ciel, de la mer, des rochers adoucis, du sable de la plage, une certaine affirmation du contour et des zones monochromes parodie les techniques de l’esthétique indifférente. Les couleurs sont autrement naturelles dans ce paysage paradisiaque, mais la voix que l’on entend a déjà chanté durant le générique ; même lorsqu’on parle d’un au-delà de l’indifférence, un certain indifférencié demeure (à preuve, l’ultime image de cette séquence remplit de bleu l’écran, pendant que Giuliana parle du tout, du tout). Maintenant, pénétrons dans l’hôtel de Corrado, où fauteuils et murs sont d’un blanc phosphoreux et accablant, il y est dit : “on va, on vient, rien ne change, je suis pareil”. Délaissons cet aperçu clinique de l’indifférence, retenons deux détails : Giuliana s’enveloppe dans un drap, la chambre se métamorphose (envahie par un rose monochrome). Et jusqu’à la fin du film, en passant par l’épisode du délire devant un navire en cale sèche (Giuliana monologue, et devant un marin étranger qu’elle ne comprend pas, elle énonce une phrase douloureusement schizophrénique : “les corps sont séparés”), une indifférence des objets et des êtres, une réification, un déroulement des espaces nous remet en mémoire le monde des choses et des hommes ainsi que la trame cinématographique. En partie grâce à Bergson, nous savons que le processus filmique, objectivation et infinie répétition, bref pétrification dans l’espace de conduites vivantes, de langages animés, contient à un second degré l’indifférence (qui nous occupe). La forme cinématographique, telle une enveloppe ou un simulacre (cher à la théorie d’Épicure) est un voile transparent jeté sur les événements, sur l’histoire humaine, avant tout quand cette dernière tend à ressembler aux structures des choses, en inspirant une esthétique de l’indifférence, qui traduit en définitive et sans la moindre nuance dialectique une indifférence de l’esthétique. Nous avons dénombré çà et là les enveloppes, correspondant aux plans infinis et parallèles, aux couches de l’indifférence (avec la distance, l’écart absolu qui les sépare ; une violente ou une pâle monochromie les colore) ; nous avons distingué les natures mortes (l’indépendance laissée aux choses les constituait en monades) ; quant aux structures floues et transparentes, elles se diluaient, connaissaient le glissement et se résolvaient le plus souvent en flottement. Peut-être que cette esthétique de l’indifférence recoupe la vision de l’enfant, de sa naissance à un an environ : lumière diffuse et jeux d’ombre, absence de contraste due à un espace à deux dimensions ; en somme, le gris. Le Désert rouge rejoint les expériences psychologiques les plus ancrées en nous et reflète notre société, au sein de laquelle l’industrie cinématographique chérit deux notions essentielles : indifférence, esthétique.
C) ESTHÉTIQUE DE L’INDIFFÉRENCE, INDIFFÉRENCE DE L’ESTHÉTIQUE
Dans les paysages et la nature morte, on est sollicité au plus haut point par l’espace cosmique. Si l’on déplace légèrement le point de vue, en considérant le sujet qui contemple, on se situe dans une vision esthétique de l’indifférence, mais avec le caractère désintéressé de celui qu’il faut appeler un spectateur, bien qu’il prétende créer (Nietzsche critique violemment le désintéressement qui caractériserait l’état esthétique dans la théorie kantienne[43] ; il est indéniable que le désintéressé dans le jugement de goût semble davantage émaner d’un spectateur que d’un créateur ; mais peut-on l’éliminer ? De plus la position d’un Schiller ne permettrait-elle pas de concilier la passivité du spectateur et l’activité du créateur ?). Il est remarquable que ce soit à propos de la beauté, et dans une théorie des facultés de l’âme (et du sensus communis) que la notion de désintéressé se manifeste dans la Critique du jugement. Plus exactement le désintéressé concerne le jugement de goût alors que l’indétermination règne par le libre jeu des facultés de l’âme. Dans la représentation esthétique, on n’est nullement attaché à l’existence de l’objet – qui n’incite à aucune action à son égard –, on est inactif, on considère simplement, on contemple ; l’existence de l’objet laisse indifférent : “chacun doit avouer que le jugement sur la beauté où se mêle tant soit peu l’intérêt, est très partial et nullement un pur jugement de goût. Il ne faut pas tenir le moins du monde à l’existence de la chose, mais être sous ce rapport tout à fait indifférent pour pouvoir en matière de goût jouer le rôle de juge”[44]. Dans le jugement de goût il y a une satisfaction désintéressée et libre ; malgré cette apparence d’immobilité, une effervescence, une autoreproduction dans la contemplation tente de conserver l’état esthétique ; une activité est discernable au sein de cette passivité, le jeu harmonieux des facultés s’épuise pour maintenir l’indifférence esthétique ou satisfaction désintéressée : “nous nous arrêtons à la contemplation du beau, car cette contemplation se fortifie et se reproduit elle-même”[45]. Parallèlement à ce plaisir désintéressé existe un certain état d’esprit : un accord libre et indéterminé unit l’imagination comme libre et l’entendement comme indéterminé (cet accord définit un sens commun esthétique). L’importance du libre jeu des facultés, du sensus communis, du désintéressé repose sur la possibilité d’accord des trois Critiques kantiennes (ainsi, le jugement réfléchissant exprime un accord libre et indéterminé entre toutes les facultés) : “la dernière Critique découvre plus profondément un accord libre et indéterminé des facultés, comme condition de possibilité de tout rapport déterminé”[46]. Sans suivre Kant dans sa conception harmonieuse de l’âme, dans la mesure où elle implique une série de finalités, on peut reconnaître dans l’activité indéterminée de l’imagination et de l’entendement par exemple, ainsi que dans la satisfaction désintéressée déterminant le jugement de goût, une présence de l’indifférence et de l’esthétique. Il n’est déjà plus étonnant de voir l’indéterminé associé à la beauté (“tout ce qui est beau est indéterminé”, dit Joubert), la joie et la positivité au détachement et à une passivité certaine (néanmoins, pour Nietzsche, on ne serait pas dans une zone absolument affirmative ; on resterait dans le réactif). Si l’on désire approfondir cette indétermination de l’esprit, il faut faire appel à Schiller, pour qui existent deux états d’indétermination de l’âme ; l’un est primitif, l’autre final, actuel, réel (on n’envisagera pas la genèse ou l’histoire de cette âme). D’une part, il y a l’état passif d’indétermination ou de déterminabilité illimitée (l’empire du possible) ; c’est une virtualité illimitée, un infini vide de contenu ; en somme, il s’agit d’un état négatif, ne subissant aucune détermination – illimité parce que sans réalité. D’autre part, il y a l’état esthétique, indétermination positive ou déterminabilité infinie et réelle, force active et pourtant négation qui procède d’une plénitude intérieure infinie ; cette déterminabilité n’est pas limitée dans son pouvoir de se déterminer elle-même ; bref, l’état esthétique est sans limite parce qu’il réunit en lui toute réalité : “il s’agit maintenant de lier une égale indétermination et une égale déterminabilité infinie au contenu le plus considérable possible, puisque cet état doit engendrer immédiatement quelque chose de positif”[47]. Il est indispensable d’ajouter que l’état esthétique est obtenu grâce à la neutralisation des instincts sensible et formel, qui s’harmonisent, s’équilibrent et ouvrent la voie au libre jeu esthétique (les notions de limite et d’illimité ont aussi un rôle considérable). L’âme est alors dans une disposition intermédiaire : paradoxalement, sans être déterminée physiquement (instinct sensible) ou logiquement et moralement (instinct formel), elle est active dans ces deux domaines. Les deux déterminabilités évoquées ont une même caractéristique : “l’une et l’autre excluent toute existence définie”[48]. Ce caractère commun fait penser à la définition kantienne du désintéressé, comme indifférence à l’existence de l’objet. Dans ces conditions la mise entre parenthèses de certaines existences nous met dans un état d’indétermination proprement esthétique, et par conséquent l’indifférence et l’esthétique s’unissent fortement, comme s’il y avait une indifférence de l’esthétique (sans parler d’une esthétique de l’indifférence). En résumé, quand nous voulons opposer les deux états d’indétermination, nous disons que si “l’indétermination par absence de détermination a été représentée par nous comme un infini vide, la liberté esthétique de détermination, qui en est le pendant réel, doit être regardée comme un infini plein de contenu”[49]. La richesse de l’état esthétique ne doit pas faire oublier qu’à un certain égard l’homme devient un néant (vue l’absence de détermination spéciale) mais à un autre égard la richesse de l’indétermination, le rassemblement des forces actives lui procure un optimum de réalité ; le paradoxe de l’état esthétique réside dans l’heureuse confrontation des contraires (sans une résolution dialectique toutefois) ; a-t-il de bénéfiques ou d’indifférents effets sur la connaissance, par exemple ? Les deux sortes de conséquence existent, semble-t-il. Qui n’a pas rêvé à cet état esthétique ? “Si […] nous nous abandonnons à la jouissance de la vraie beauté, nous sommes en cet instant maîtres au même degré de nos forces passives et de nos forces actives, et nous nous donnerons avec la même aisance aux choses graves et au jeu, au repos et à l’activité, à la résistance et aux états de laisser aller, à la pensée abstraite et à l’intuition sensible”[50]. Quant à nous, écartons de cet état final ce qui rappelle la solution d’une âme harmonieuse ou une métaphysique de la liberté ; retenons l’association dynamique des forces actives et passives, le pluralisme insinué dans l’indifférencié, bref l’indifférence réelle (à distinguer d’une indifférence finale, synthèse dialectique des divers moments d’indétermination et de détermination) qui ne redoute pas l’oubli, la déformation interprétative ou l’exaltation abusive des idéalités, parce qu’elle se présente souvent sous l’image du magnifique couple : indifférence et esthétique.
Si l’on tente d’entrer dans le champ esthétique de l’indifférence, on est sollicité de maint côté ; le dandysme vestimentaire d’un Brummel est l’extériorisation esthétique d’une indifférence ; dans la peinture de Watteau se rencontrent les nombreux procédés de voilement, de glissement, d’immobilisation des couches transparentes de l’indifférence ; Marcel Duchamp est certainement parvenu à la beauté d’indifférence : il isole l’objet tout fait (pour que l’absence d’humanité soit patente dans l’œuvre d’art), il propose son ready-made. Il joue avec les notions d’écart, de coupure, de distance et surtout organise la plus érotique cinématique qui soit : le Grand Verre de La Mariée mise à nu par ses célibataires, même cristallise les émois d’une virginité (passage de la Vierge à la Mariée – intervalle essentiel et fugitif, équivoque et translucide, passionné et indifférent) figée et polie par la société. Duchamp a fixé cette structure – à pétrifier – dans les couches merveilleusement indifférentes du Grand Verre – hymen fragile, dont la fonction est de se briser tout en résistant à la violence. À la surface de ce Grand Œuvre s’étale une multitude d’espaces indéfinis et parallèles : l’esthétique et l’indifférence ont trouvé là leur plus géniale expression. Entre autres choses, la mécanique et la sexualité sont unies et tenues à distance. L’histoire de la Mariée mise à nu est infinie : on la voit, on la lit de multiples façons, mais toujours on sent qu’une indifférence souveraine l’habite ; Duchamp a démonté pour nous un de ses mécanismes : “en général, si ce moteur mariée doit apparaître comme une apothéose de virginité c’est-à-dire le désir ignorant, le désir blanc (avec une pointe de malice) et s’il (graphiquement) n’a pas besoin de satisfaire aux lois de l’équilibre pesant, néanmoins, une potence de métal brillant pourra simuler l’attache de la pucelle à ses amies et parents (ceux-ci et celles-là correspondant graphiquement à une base solide, sur terre ferme, comme la base de maçonnerie de la machine célibataire repose elle-même sur terre ferme)”[51]. On comprend qu’une esthétique de l’indifférence n’aspire pas forcément à l’univocité, mais qu’elle se complique en quelque sorte de termes méta-ironiques[52] ; technique et création sont remises en question, et pourtant leurs forces calmes se trouvent amplifiées chez l’artiste épris de neutralité : “un certain état de choses que je tiens beaucoup à élucider est que le choix de ces Ready-made n’était jamais dicté par une délectation esthétique. Ce choix était toujours basé sur une réaction d’indifférence visuelle, en même temps qu’une absence totale de bon ou mauvais goût […] En fin de compte une anesthésie complète”[53]. Si l’on veut comprendre l’intensité d’indifférence de l’œuvre d’art, il suffit d’examiner les procédés de Duchamp, qui finissent par désigner l’indifférence même de l’esthétique : une curieuse esthétique du gris géométrique n’empêche pas la prolifération des plans infinis, c’est-à-dire des dimensions démesurément parallèles de l’indifférence[54]. L’art d’aujourd’hui se reconnaît en la personne et l’œuvre de Duchamp ; sur des plans aussi divers que ceux du langage et de la peinture, Duchamp sait patiemment inventer les mécanismes mettant en jeu les mots et les espaces colorés, quitte à éprouver leur usure, à faire éclater leurs enveloppes. Sensible à l’étrangeté de la réification, il élève à une insoutenable lucidité les détours et les reflets de notre culture. Il entre dans le silence et l’embarras d’une création indifférente, il donne à contempler l’énigmatique retournement des choses sur elles-mêmes. Duchamp a dit, après bon nombre de sceptiques : “il n’y a pas de solution, parce qu’il n’y a pas de problème” ; c’est pourquoi en un sens, il lui a été relativement facile de coordonner l’indifférence, l’esthétique : indifférence et esthétique.
L’indifférence se fait esthétique et l’esthétique indifférence – sans progression dialectique ; mais avant le mariage du couple, on voit s’agiter une série de machines célibataires ; en d’autres termes, les unions et les divorces sont le lot de l’indifférence et de l’esthétique. Si l’on se reporte aux techniques des couches de l’indifférence on entrevoit collusions et ruptures : fusion, écart, glissement, flottement, flou. Si d’une part l’indifférence est représentable par un plan infini – abstrait et vide – dont la géométrie plane est semblable aux projections filmiques ou picturales, en somme à toute espèce d’images voire d’impressions sur les feuilles blanches d’un livre – le côté masque, simulacre, enveloppe, pellicule nous autoriserait à appeler ces plans parallèles (essentiellement inconscients, pratiquement peu visibles) des doublures[55] –, d’autre part elle laisse affleurer une vigueur affirmative et une beauté ironique. L’esthétique et l’indifférence ne s’éternisent pas dans des trouvailles, elles nous surprennent continuellement ; elles se dénudent parce qu’elles n’ont rien à montrer[56] ; elles sont nos complices, elles nous défient. Et c’est seulement en errant dans l’intervalle qui va du sentiment du vide à l’état de vide qu’on sait déjouer la limite ultime (qui plongerait dans le gouffre du silence) et l’illimité primitif (qui réclame une parole attentive et passionnée, traquée par le ressassement).
Mais l’existence de l’indifférence doit-elle être soupçonnée par l’esthéticien ? Jusqu’à présent la neutralité s’affirmait dans l’art avec innocence. Ignorer l’essence de l’indifférence c’est désormais se désintéresser de l’esthétique, c’est enfermer l’art dans un vide mortel, au lieu de le laisser vagabonder dans un vide multiple, attirant et déconcertant.
Georges Sebbag
Notes
[1]. Cioran, La Chute dans le temps, 1964, p. 19 et p. 20.
[2]. Grenier, “Inspirations méditerranéennes”, dans Les Îles, 1947, p. 140.
[3]. Musil, Les Désarrois de l’élève Törless, (trad. P. Jaccottet), 1960, p. 9.
[4]. Blanchot, Thomas l’obscur, 1941, p. 97.
[5]. Cayrol, Pour un romanesque lazaréen, 1964, p. 220.
[6]. Blanchot, L’Attente l’oubli, 1962, p. 17.
[7]. Musil, L’Homme sans qualités, (trad. P. Jaccottet), t. III, p. 91.
[8]. Jankélévitch, L’Austérité et la vie morale, 1956, p. 125.
[9]. Blanchot, Thomas l’obscur, p. 96-97.
[10]. Blanchot, L’Attente l’oubli, p. 162.
[11]. Blanchot, Thomas l’obscur, p. 11.
[12]. Ibid., p. 8.
[13]. Grenier, Les Îles (l’attrait du vide), p. 13.
[14]. Blanchot, Thomas l’obscur, p. 9.
[15]. Ibid., p. 9.
[16]. Ibid., p. 10.
[17]. Musil, L’Homme sans qualités, t. III, p. 110.
[18]. Blanchot, Thomas l’obscur, p. 10.
[19]. Musil, Les Désarrois de l’élève Törless, p. 22.
[20]. Cayrol, Pour un romanesque lazaréen, p. 226.
[21]. Musil, L’Homme sans qualités, t. I, p. 43.
[22]. Moravia, Les Indifférents, 1931, p. 314.
[23]. Musil, L’Homme sans qualités, t. IV, p. 458.
[24]. Grenier, Inspirations méditerranéennes, p. 181.
[25]. Cayrol, Pour un romanesque lazaréen, p. 217.
[26]. Musil, L’Homme sans qualités, t. IV, p. 124.
[27] Ibid., p. 124-125.
[28]. Blanchot, Thomas l’obscur, p. 132.
[29]. Musil, L’Homme sans qualités, t. IV, p. 125.
[30]. Ibid., p. 125.
[31]. Sterling, La Nature morte de l’antiquité à nos jours, 1959, p. 68.
[32]. Ibid., p. 49.
[33]. Ibid., p. 49.
[34]. Ibid., p. 49.
[35]. Musil, L’Homme sans qualités, t. IV, p. 608.
[36]. Sterling, La Nature morte de l’antiquité à nos jours, p. 49.
[37]. Blanchot, Thomas l’obscur, p. 185.
[38]. Klee, Théorie de l’art moderne, (trad. P.-H. Gonthier), 1964 p. 56.
[39]. Ibid., p. 56.
[40]. La vision flottante d’un bateau est redevable des régions indifférentes ; elle existe en particulier chez M. Blanchot : “et il lui semblait qu’il contemplait le vide dans l’intention absurde d’y trouver quelque secours. Pourtant un bateau sortit du brouillard, lentement d’abord puisqu’il disparaissait à intervalles réguliers dans des ténèbres qui ne consistaient que dans cette disparition, puis il surgit si près que Thomas aurait pu déchiffrer les inscriptions qui brillaient sur la coque s’il avait voulu s’en donner la peine. Était-ce parce que le bateau était vide ? Il le laissa s’éloigner avec autant d’indifférence que s’il avait distingué dans cette image une promesse illusoire et il continua de nager.” (Thomas l’obscur, Paris, 1941, p. 8.).
[41]. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, (trad. M. Betz), partie IV, “Parmi les filles du désert”.
[42]. Cf. Musil, L’Homme sans qualités, (trad. P. Jaccottet), Paris, 1958, t. IV, p. 458 : “le surhumain, c’est sans doute la grandeur de l’élan dans les contours, cette ample sûreté du trait ? Ou est-ce l’immense désert de cette couleur étrangère à la vie, le bleu sombre ? Ou le fait que nulle part la cloche du ciel n’est posée si directement au-dessus de la vie ? Ou est-ce l’air et l’eau, auxquels on ne pense jamais ? Ce sont de braves et ternes commissionnaires, d’habitude. Ici, chez eux, ils se dressaient soudain inapprochables, comme un couple royal.” Ce passage est tiré d’un paragraphe capital intitulé : le voyage au paradis. Bien qu’il y ait une esthétique propre au paradis, l’indifférence n’est pas forcément chassée de ce haut lieu. Au contraire, nous reconnaissons là certains procédés des espaces indifférents : monochromie, infinité, violence, recours aux éléments naturels.
[43]. Nietzsche, La Généalogie de la morale, (trad. Albert), III, 6.
[44]. Kant, Critique du jugement, (trad. Gibelin), t. I, p. 41.
[45]. Ibid., p. 55.
[46]. Deleuze, La Philosophie critique de Kant, 1963, p. 93.
[47]. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, (trad. R. Leroux), 20ème lettre, p. 253.
[48]. Ibid., 21ème lettre, p. 261.
[49]. Ibid., 21ème lettre, p. 261.
[50]. Ibid., 22ème lettre, p. 269-271.
[51]. Duchamp, Marchand du sel, 1958, p. 54.
[52]. Duchamp : “mon ironie est celle de l’indifférence : méta-ironie”.
[53]. Conférence de M. Duchamp au Museum of Modern Art de New York à l’occasion de l’exposition The Art of Assemblage dans Dossier 17 du “Collège de Pataphysique”, p. 87.
[54]. “À mesure qu’il y a moins différenciation de l’axe et de l’axe, c’est-à-dire à mesure que tous les axes disparaissent en gris de verticalité la face et le dos, le revers et l’avers prennent une signification circulaire : la droite et la gauche qui sont les 4 bras de la face et du dos se résorbent le long des verticales. L’intérieur et l’extérieur (pour étendue 4) peuvent recevoir une semblable identification, mais l’axe n’est plus vertical et n’a plus d’apparence unidimensionnelle (Marchand du sel, p. 39).
[55]. Un plan, une doublure, un écran : ces termes sont équivalents. Encore un texte où indifférence et esthétique cadrent : “lui au contraire, était sans profondeur : un écran blanc et plat ; les douleurs et les joies passaient sur son indifférence comme des ombres ; et, par contrecoup, comme s’il eût communiqué cette inconsistance à son monde extérieur, tout, autour de lui, était sans poids, sans valeur, sans durée, tel qu’un jeu d’ombres et de lumières” (A. Moravia, Les Indifférents, p. 289).
[56]. Cf. Richard, “Mallarmé et le rien”, in Revue d’histoire littéraire de la France, oct.-déc. 1964, p. 635 : “il est habituel pour Mallarmé de relier la nudité, la chasteté d’un corps féminin entr’aperçu, à la nullité, à l’éclat terrible de l’être”.
Références
Georges Sebbag, « Indifférence et esthétique » (tiré de son D. E. S. de philosophie, De l’indifférence, mai 1965, chapitre III) est publié dans Revue d’esthétique, nouvelle série, tome XIX, 3-4, « Les catégories esthétiques », juillet-décembre 1966 (à l’exception des deux exemples illustratifs, l’autoroute américaine d’Allan d’Arcangelo et Le Désert rouge de Michelangelo Antonioni).
« Indifférence et esthétique » est publié dans la Revue d’esthétique sous le titre « L’indifférence ».
« Indifférence et esthétique » paraît dans son intégralité en 2002, lors de la publication de Georges Sebbag, De l’indifférence, chez Sens & Tonka.