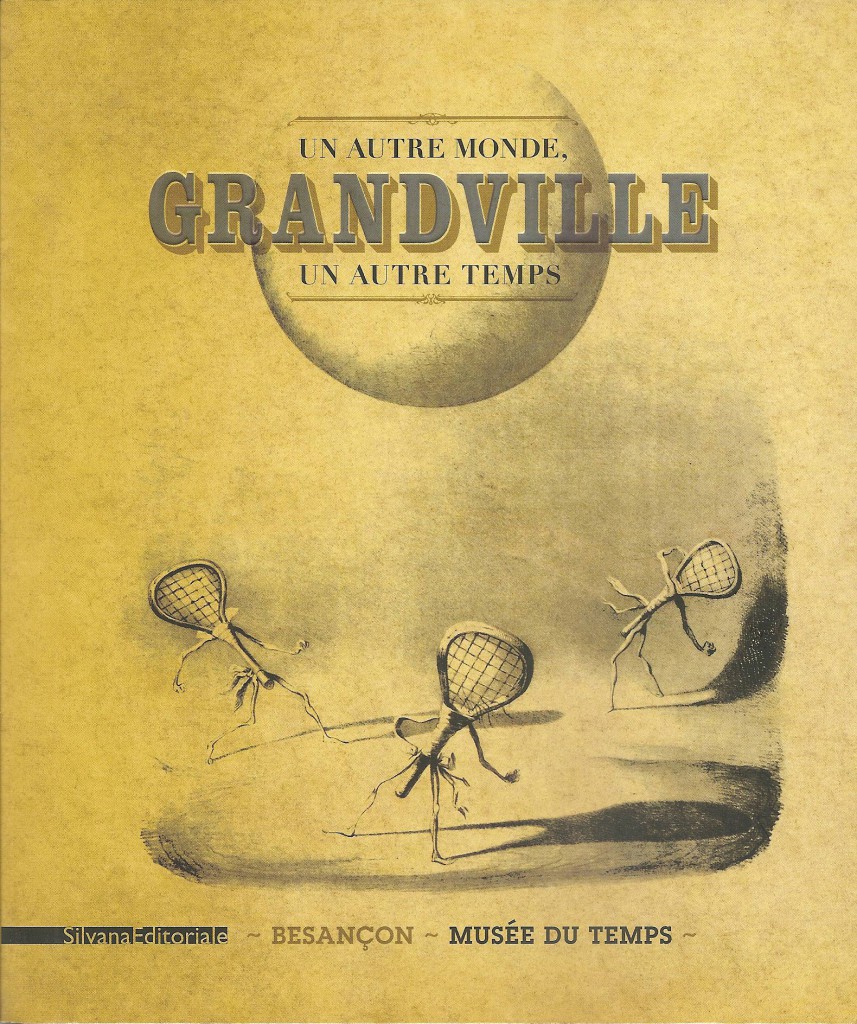
En juin 1920, dans Littérature n° 14, Philippe Soupault publie l’épitaphe d’Arthur Cravan, qui est bien mort, mais aussi les épitaphes de Georges Ribemont-Dessaignes, Francis Picabia, Théodore Fraenkel, Marie Laurencin, Louis Aragon, Paul Éluard, Tristan Tzara et André Breton, qui sont toujours vivants. C’est l’époque où on annonce ici et là la prochaine parution de L’Invitation au suicide, un ouvrage de Philippe Soupault agrémenté de sept préfaces. Il y a deux faits remarquables à propos des « Épitaphes » et de L’Invitation au suicide. D’abord, Littérature n° 14 porte à la connaissance du public « Épitaphes » ainsi que la préface de Paul Éluard à L’Invitation au suicide intitulée « Attestation » et curieusement dédiée à André Breton. Ensuite, Soupault ayant quasiment détruit l’édition à trente exemplaires de L’Invitation au suicide, il ne reste plus en fait que la préface de Paul Éluard pour se faire une idée de l’ouvrage.

Soupault acteur d’Un autre monde
À lire de près « Attestation », on a le sentiment que le témoignage de Paul Éluard a une valeur testamentaire. Il semble entendu que Philippe Soupault, qui appelle au suicide, va se suicider. Le procès-verbal d’Éluard s’achève sur un constat de décès sinon de suicide : « Ses cheveux sont déracinés, il ne porte plus ses mains à bout de bras et nous conservons son souvenir comme une montre toujours à l’heure. » Devant tant de gravité, on peut avancer l’hypothèse d’un jeu des épitaphes et des contre-épitaphes auquel Soupault et ses amis se seraient prêtés. D’un côté, Soupault allait publier les très aimables poèmes-épitaphes abrégeant la vie de Ribemont-Dessaignes, Picabia, Fraenkel, Aragon, Éluard, Tzara et Breton, d’un autre côté, les sept dada-surréalistes concernés n’auraient plus eu qu’à rédiger le faire-part de suicide de Philippe Soupault dans les sept préfaces à L’Invitation au suicide.
Éluard énumère dans « Attestation » les diverses façons qu’a Soupault d’inviter au suicide : « le jeu, la danse, la parole, la fusée-méditation, le langage des fleurs et du cœur, le cinéma, la vitesse, la lutte », certaines d’entre elles se situant dans le droit fil d’Apollinaire et de Marinetti. Pour caractériser le coauteur des Champs magnétiques, Éluard ajoute à ces diverses expressions pouvant toutefois conduire à l’abîme, une série de modalités du rire mêlant la douceur et le sang, la raison et la terreur, l’insouciance et l’affection, l’amour et le mensonge. Puis il en vient à dire que le joueur et l’acteur se concentraient spécialement sur un rôle en répétant sans cesse le titre à rallonge de J. J. Grandville : « Un autre monde / Transformations, visions, incarnations, ascensions, locomotions, explorations, pérégrinations, excursions, stations, cosmogonies, fantasmagories, rêveries, folâtreries, facéties, lubies. – Métamorphoses, métempsycoses, apothéoses et autres choses. » Tout en précisant que l’auteur du texte se nomme Taxile Delord, il ne manque pas de mentionner en note la date d’édition de l’ouvrage de Grandville : « Paris, Fournier, 1844 ».La liste des opérations convoquées dans le long sous-titre d’Un autre monde apparaît alors comme l’ambitieux programme accaparant l’attention de l’auteur de L’Invitation au suicide. On ne peut s’empêcher de penser que toute la dynamique, fût-elle suicidaire, du dada-surréaliste Soupault reprend à son compte les pérégrinations, les fantasmagories et autres métempsycoses du livre-phare de Grandville.
En octobre 1923, toujours dans la revue Littérature, s’étale sur une double page intitulée ERUTARRETIL (le titre Littérature pris à rebours) une composition graphique de soixante et onze noms d’ancêtres ou de précurseurs du surréalisme, parmi lesquels figure celui de Grandville. Cette constellation de noms n’est d’ailleurs pas sans ressemblance avec certaines nuits étoilées ou figurations cosmiques du dessinateur de Nancy.
Lise ou le lys des Fleurs animées
Le 11 octobre 1924, le Bureau de recherches surréalistes du 15 rue de Grenelle est ouvert au public. Le 15 décembre, Lise Meyer, née Hirtz, la future Lise Deharme, passe à la Centrale surréaliste. Ce jour-là, la permanence est tenue par Breton et Aragon. La visite de la dame au gant est rapportée dans Nadja : « Je me souviens aussi de la suggestion en manière de jeu faite un jour à une dame, devant moi, d’offrir à la “Centrale surréaliste”, un des étonnants gants bleu ciel qu’elle portait pour nous faire visite à cette “Centrale”, de ma panique quand je la vis sur le point d’y consentir, des supplications que je lui adressai pour qu’elle n’en fît rien. Je ne sais ce qu’alors il put y avoir pour moi de redoutablement, de merveilleusement décisif dans la pensée de ce gant quittant pour toujours cette main. Encore cela ne prit-il ses plus grandes, ses véritables proportions, je veux dire celles que cela a gardées, qu’à partir du moment où cette dame projeta de revenir poser sur la table, à l’endroit où j’avais tant espéré qu’elle ne laisserait pas le gant bleu, un gant de bronze qu’elle possédait et que depuis j’ai vu chez elle, gant de femme aussi, au poignet plié, aux doigts sans épaisseur, gant que je n’ai jamais pu m’empêcher de soulever, surpris toujours de son poids et ne tenant à rien tant, semble-t-il, qu’à mesurer la force exacte avec laquelle il appuie sur ce quoi l’autre n’eût pas appuyé. »
L’émoi de Breton est considérable. Depuis ce 15 décembre, il est fort épris de Lise Meyer, sans que son amour soit payé de retour. Son désespoir retentit alors dans des pages de l’Introduction au discours sur le peu de réalité qui campent une atmosphère de fin du monde et où le narrateur se retrouve seul avec la femme aimée : « Paris s’est écroulé hier ; nous sommes très bas, très bas, où nous n’avons guère de place. » Quelques échantillons de sa correspondance inédite avec la dame au gant témoignent de l’amour sublime ou plutôt de l’amour-folie ressenti par Breton : « Vous êtes pour moi, au sens propre du mot, une apparition. […] Pour moi c’est forcément oracle ce que vous dites » (11 février 1925) ; « Je me débats dans ces fils invisibles qui partent de votre maison » (19 ou 26 février 1925) ; « [Madame Sacco, la voyante] s’est montrée absolument affirmative sur le fait que je n’ai jamais aimé et que je n’aimerais jamais que vous » (16 septembre 1927) ; « Il y a Lise, puis plus rien, puis il y a les Poésies, puis plus rien, plus rien, plus rien à l’infini. […] C’est au musée Gustave Moreau, presque au milieu de la grande pièce, entre La Fleur mystique et Les Rois mages, que je vous vois, que je ne vous vois pas » (22 septembre 1927) ; « Lise, comment votre présence entière sans trace d’absence peut-elle ainsi se concilier avec votre absence ? » (24 septembre 1927) ; « Nous sommes dans la vieille maison dont aucune fenêtre, aucune porte n’est réellement condamnée, tout s’ouvrira un jour et il n’y aura plus de nuit et de jour » (24 septembre 1927). Mais l’amour dévorant pour Lise, alimenté entre autres par des invocations à Rimbaud, Ducasse, Gustave Moreau ou à Madame Putiphar de Pétrus Borel, après maints soubresauts, cette passion s’éteint le 24 octobre 1927, à l’issue d’un ultime incident.
Dans « Attestation », Éluard évoquait comme une des façons d’inviter au suicide, au même titre que « la fusée-méditation » ou « le cinéma », « le langage des fleurs et du cœur ». Cela semble indiquer que Soupault, Éluard et Breton avaient pu admirer à cette date Les Fleurs animées, l’ouvrage de J. J. Grandville publié en 1847 et comprenant deux bois et cinquante gravures sur métal. Le certain est que le livre illustré de Grandville occupe une place centrale dans l’importante lettre d’André Breton à Lise Meyer du 11 février 1925. Sur un papier à en-tête de Littérature, 6e année, on peut lire cette confidence mettant d’emblée à contribution les planches de Grandville : « Essayant hier à minuit de voir clair en moi, de m’expliquer quel cours mystérieux mes sentiments et mes idées peuvent bien suivre, à partir de l’instant où je cesse de vous voir, pour que je passe de l’éblouissement pur et simple au terme extrême de l’angoisse – et cela sans heurt appréciable, en une heure ou deux – je me suis arrêté, Madame, à cette solution : je croyais, l’autre jour, être à la merci d’une image et je voulais la glisser dans ce livre de Fleurs, mais cela ne suffisait pas à me rendre compte de mon trouble ; aujourd’hui j’ai trouvé mieux, vous êtes pour moi, au sens propre du mot, une apparition. » Ce mot apparition qui deviendra récurrent dans les amours et l’imaginaire d’André Breton, fait signe sans conteste à L’Apparition, le tableau de Gustave Moreau où la tête coupée de saint Jean-Baptiste apparaît à la danseuse Salomé, nue et parée, et à « Apparition », le poème de Mallarmé (« Et j’ai cru voir la fée au chapeau de clarté »).
Breton poursuit sa méditation sur l’apparition de Lise en soulignant que la première apparition n’est pas la dernière et que la dernière est toujours la première : « Une apparition ! Quelle émotion ne convient-il pas d’attacher à un tel phénomène ! Je n’ai jamais rien vu se produire de semblable devant moi et pourtant je n’ai jamais rien désiré d’autre. La poésie même, je n’y ai jamais attaché de prix qu’autant qu’elle me paraissait susceptible idéalement de provoquer un court miracle de cet ordre et, selon toutes probabilités, du reste, c’est lui demander trop. Mais que penser d’une apparition dont la première fois qu’elle a lieu n’est pas la dernière ? D’une apparition qui reste chaque fois aussi frappante ? Les livres, même ceux qui ne se refusent pas tout à fait au merveilleux, n’en fournissent pour ainsi dire pas d’exemple. » Cependant Breton hallucine non pas une Salomé nue mais une Lise travestie et transfigurée dans un tourbillon de robes : « Cette image de l’apparition […] ! Tout me paraît de nature à la fortifier, à commencer par ces robes toujours différentes que je vous vois : c’est bien ainsi qu’elle se comporterait et si je vous revois une de ces robes, c’est que son retour aura quelque divine nécessité, que vous jouerez encore sur le velours de l’inoubliable. »
Intervient alors le passage de la lettre où la découverte des Fleurs animées chez Lise Meyer est saluée comme un bel exemple de hasard objectif : « J’augure, malgré tout, de la découverte chez vous de ces planches de Grandville : elles eussent pu ne pas y être. Pour moi une coïncidence de cet ordre n’est rien moins que négligeable : que voulez-vous, elle me donne l’illusion d’une chance extraordinaire, je pouvais si bien tomber plus mal. » La tentation est grande de déceler à travers ces planches coloriées, à travers ces Fleurs – Pensée, Tabac, Tulipe, Narcisse, Violette, Nénuphar, Marguerite, Camélia, Belle-de-nuit, Lys, etc. – animées ou incarnées par autant de Dames gracieuses et sensuelles arborant des toilettes somptueuses, fraîches ou éclatantes, la présence unique et multiple de la mystérieuse Lise. Bien qu’il s’en défende, Breton ne peut s’empêcher d’associer Lise à la Botanique féminine, à la collection de haute-couture de Grandville, ne manquant d’ailleurs pas de rapprocher Lise de la majestueuse Fleur de lys : « Mais je me défends encore d’avoir pu vous comparer à telle ou telle de ces images. Même le Lys ne vous annonce pas. » Quoi qu’il en soit, le troubadour surréaliste est envoûté par la dame au gant bleu ciel et au gant de bronze, enivré par cette Fleur mystique ou cette apparition sortie des planches de Grandville comme des tableaux de Gustave Moreau.
Le crayon et la plume
Quel diablotin mène la danse ? Le dessinateur ou l’écrivain ? L’image ou le texte ? Le crayon ou la plume ? Grandville ou Taxile Delord ? Telle est la question posée dans le prologue d’Un autre monde intitulé « La clé des champs », un titre qui sera repris par Breton pour son troisième recueil de textes. Aux yeux de Grandville, la réponse ne fait pas de doute. L’image, le crayon et le dessinateur ouvrent le bal et donnent le signal à la valse ou à la ronde des mots. Ce qui ne manquera pas de semer le trouble dans les rayonnages des bibliothèques. Le dessinateur et le graveur n’apparaîtront plus comme de simples illustrateurs dévoués à une légende ou à un texte sacro-saint. Ce sont eux qui désormais prendront la main et imposeront leur marque. Par le biais de cartes, d’emblèmes, de figures, de symboles, d’énigmes, de rébus, d’enseignes, d’affiches, d’étiquettes, de portraits, de paysages et autres cadrages, ils dérouleront un nouveau fil conducteur, ils soutiendront un mode et un rythme de lecture différents. Telle était d’ailleurs la leçon du rêve où les paroles comptent assez peu au regard de la dramaturgie des images. Tel est le parti pris des cases de la bande dessinée qui sont légendées ou qui incluent des bulles réduites parfois à des onomatopées. Telle sera la perspective du montage cinématographique où la vue fait au moins jeu égal avec l’ouïe.
Délaissant son rôle de caricaturiste, Grandville part à l’aventure, voguant sur les ailes de la fantaisie. L’imagination guide l’entendement. Elle ouvre même la voie à d’intrigantes spéculations métaphysiques. Le plus captivant n’est pas tant le cours insolite ou parodique de ces voyages extravagants que les moyens utilisés et les déductions philosophiques sous-jacentes. Deux procédés formels retiennent l’attention : 1. les plongées sur terre à partir de l’atmosphère ou de la stratosphère ; 2. l’appariement vestimentaire du haut et du bas.
Depuis son ballon vagabond, le musicien et mathématicien Hahblle use d’une caméra plongeante qui relativise les échelles humaines et les dispositifs locaux, qui rabat le caquet des mœurs ambiantes des plus familières aux plus hautaines et qui écrasent les prétentions ou les allégations de cet animal politique doué de raison. Ces plongées roboratives exercent moins un droit de regard qu’une révision de la faculté de vision, un réexamen oculaire agrémenté d’une once de moquerie et de circonspection. Quant au capitaine Krackq, le deuxième des trois néo-dieux explorateurs d’Un autre monde, ce vaillant marin manchot et professeur de natation arborant un bras en écharpe et une brochette de décorations, c’est par la vertu d’un étourdissant plongeon au fond de l’océan qu’il va pouvoir filmer les us et coutumes des animaux sous-marins et expédier à son compère Puff resté sur terre le fruit de son reportage. Le mode d’expédition choisi du précieux manuscrit est apparemment imparable. Il s’agit d’une bouteille à la mer portant une étiquette ainsi libellée et reproduite en bonne place dans le volume : « Monsieur le Dr Puff, néo-dieu / Partout / Fragile / Port payé ». Il y aura un autre moyen encore plus expéditif tenté par Krackq : une dépêche sortie des eaux à l’extrémité d’une fusée élastique atteindra le bonhomme Puff se trouvant justement en pleine locomotion aérienne. Au vu de ces plongées, de ces plongeons et de ces modes rapides de transmission, le dessinateur Grandville apparaît comme un champion de la déstructuration des apparences, tantôt équarrissant ou rabotant les physiologies humaines, tantôt accordant au contraire plus de volume ou de relief aux créatures et objets extraplats peuplant la surface des tableaux d’un musée.
Le costumier hors de pair Grandville est passé maître dans l’appariement du haut et du bas révélateur d’une personnalité cachée. Comme le souligne l’axe horizontal sectionnant le corps des personnes, les effets du bas jettent un cinglant démenti aux vêtements du haut. Il en est ainsi de ce couple promenant sa dignité bras dessus bras dessous, un militaire à képi avec une épouse à la coiffe emplumée. Le mâle moustachu est accoutré d’une ample robe et d’un parapluie tandis que la dame chaussée de bottes à éperons est affublée d’un sabre. Il y a là entre le mari et la femme une interversion manifeste de vêtements et d’accessoires. Autre exemple où l’apparence du haut est contredite par celle du bas : un prélat à calotte méditatif et les bras croisés laisse voir des jambes et des cuisses moulés dans un collant d’Arlequin. Ce procédé de Grandville d’assemblage disparate du haut et du bas introduit tout un jeu des possibles dans la panoplie vestimentaire. On pourrait interpréter la phrase de présommeil fondatrice de l’écriture automatique, « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre », à l’aune du procédé de Grandville. Cette phrase entendue par Breton, représentant un homme « tronçonné à mi-hauteur par une fenêtre perpendiculaire à son corps », pointerait l’ambivalence, la bisexualité et le collagisme de toute image surréaliste.
La philosophie du déguisement
Grandville qui a emprunté ce chemin de la bipartition des apparences, de la duplicité des désirs et de la mascarade sociale en a explicité le sens et l’importance. Pour le dire d’un trait, le dessinateur s’est mis sur les rangs pour détrôner la philosophie de Hegel. Il a inventé la philosophie du déguisement « pour faire suite à la philosophie de l’histoire ». Les réflexions agitées par Puff sont à la fois métaphysiques, imaginatives et constructives : « L’homme se croit un et il est toujours deux ; sa physionomie et son caractère se livrent une guerre perpétuelle. Je veux me servir de cette lutte pour renouveler la face du carnaval. […] Avec mon système, on ne devinera pas seulement le domicile des individus, mais encore leur sexe, leur caractère ; l’intrigue s’élèvera à la hauteur de la psychologie. Plus l’homme sera déguisé, plus il se fera connaître. Mes déguisements sont doubles comme le cœur. » L’esprit mène le monde, selon la philosophie hégélienne de l’histoire. Il s’incarne dans l’esprit d’un peuple et s’exprime à travers des grands hommes qui assouvissent leurs passions et ignorent le but de l’histoire à laquelle ils contribuent. Car telle est la ruse de la raison.
L’auteur d’Un autre monde, qui ne cesse de dessiner toutes sortes de parades et de bals masqués, jette un regard différent sur la marche de l’histoire. Ce n’est pas tant l’esprit qui tirerait les ficelles que les individus eux-mêmes qui se griment, se travestissent, se déguisent, qui empruntent toutes les gammes du look et de l’exhibition, du mécanique à l’éthéré, du végétal à l’animal, de l’humain au divin. En fait, l’univers est un théâtre de marionnettes, une salle d’opéra, un vaste music-hall, où sur scène comme dans l’assistance l’animal parodie l’humain, l’humain singe le végétal, le végétal joue à l’immortel, l’immortel a un air de pantin, le pantin mime l’artiste, l’artiste se prend pour un instrument et ainsi de suite. Granville pressent que la philosophie de l’histoire et la lutte des classes cèdent du terrain en faveur d’une philosophie de l’imitation, d’une société du spectacle, d’une bataille féroce entre travestis et sosies, objets animés et inanimés, créatures vivantes et imaginaires. C’est pourquoi le dessinateur démonte les rouages de la mécanique humaine et dresse de nouveaux plans de la Comète qui en l’occurrence désigne une Dame de toute beauté promenant avec langueur sa scintillante traîne mais est aussi jalouse qu’une vraie grisette.
Dans cet autre monde propice aux transformations et hybridations, aux incarnations et réincarnations, les outils, les ustensiles ou les machines, sans qu’il puisse être ici question de métaphore ou de tour de passe-passe rhétorique, sont bel et bien des êtres de chair et de sang qui tiennent la dragée haute aux gestations et manifestations proprement humaines. Le Crayon est un dessinateur inspiré, la Plume un écrivain diligent, le Canif l’indispensable compagnon veillant sur ses deux confrères, affûtant leur pointe, aiguisant leur esprit. Le Crayon n’est pas le représentant ni le porte-enseigne de Grandville. Au même titre que les trois néo-dieux Puff, Krackq et Hahblle, il s’agit d’un personnage à part entière qui émarge au pays des songes comme au syndicat des Crayons. On sent bien que Grandville connaît par cœur ou sur le bout des doigts son Cyrano de Bergerac, son La Fontaine, son Swift. Qu’est-ce qu’il ajoute à ses illustres prédécesseurs ? Convaincu de l’existence d’un désir mimétique ou d’un mimétisme généralisé, il jette sur le papier les linéaments d’une philosophie du déguisement où l’on s’empresse de crier « Haut les masques ! » plutôt que « Bas les masques ! ». Il n’est pas encore loin le temps de Mesmer et du magnétisme animal, où l’on pratiquait le baquet, la suggestion et les passes magnétiques. Dorénavant, il est entendu, et l’on sent là une certaine connivence avec le romantisme de Novalis ou avec la philosophie de la nature de Schelling, que les dieux ne sont pas plus esseulés que les minéraux, les végétaux ou les animaux. Il y a une différence de degré et non de nature entre l’automatisme et le psychisme, entre l’intervention d’un deus ex machina et la machinerie d’un animal-machine, entre les esclandres de bons vivants et les pitreries de fantômes des morts. Plutôt que de s’enquérir de l’essence de l’âme humaine, il faut essayer de connaître le pantin humain à travers ses masques et ses oripeaux.
Le moi et le non-moi
On sent certes poindre une certaine angoisse face à une humanité de marionnettes ou à une animalité de robots. Pourtant la perspective d’innovations techniques peut avoir quelque chose d’excitant. Par exemple, pourquoi bouder ce « concert à la vapeur » mécanisé, automatisé et sans danger, dont « les musiciens sont garantis inexplosibles » ? Le public sera à l’unisson à l’écoute de L’Explosion, une mélodie pour 200 trombones, ou de La Locomotive, une symphonie à basse pression de la force de 300 chevaux. Il sera surtout conquis par les envolées métaphysiques de la symphonie philosophique Le Moi et le Non-Moi en hommage à Fichte, auteur de la Destination de l’homme et de la Doctrine de la science. D’ailleurs, le tête-à-tête d’un moi solipsiste et d’un non-moi révélé par le moi, la confrontation d’un moi hypertrophié et d’un non-moi qui enfle au fur et à mesure qu’il est perçu ou imaginé par le moi, le duel entre le conscient et l’inconscient, le prise de bec entre le moi humain et l’univers matériel et divin, tout cela est justement à l’œuvre dans Un autre monde.
Si le moi représente le Crayon ou le dessinateur Grandville, le non-moi c’est assurément l’Autre monde. Mais est-ce à dire que l’Autre monde n’est qu’une fantasmagorie, une pure rêverie, une lubie du seul moi dénommé Grandville ? En réalité, ce dernier suggère que pour fantasmer il vaut mieux être trois, le Crayon, la Plume et le Canif. Ou bien Puff, Krackq et Hahblle. La découverte de l’Autre monde exige la collaboration de trois néo-dieux ou génies, se répartissant l’espace extra-terrestre, les bas-fonds de la mer et du sous-sol, le monde à ras-de-terre, sans compter les voyages dans le passé, le présent et le futur. À ce propos, le passé et le présent nous projettent toujours en avant. Quand Krackq effectue une longue virée à Rheculanum (pour Herculanum), capitale de la contrée « l’Antiquité », il recule dans les coutumes et les cothurnes du passé pour mieux sauter dans les mœurs et les bisbilles poétiques du présent : « à chaque coin de rue, des individus couronnés de lierre récitaient des vers et vendaient de la poudre persane ; on lisait sur des enseignes Bureau d’esprit, et la foule s’y rendait pour acheter des odes, des madrigaux, des épîtres, qu’on lisait ensuite aux bains, aux repas, aux forums ». Outre des dessins topiques et suggestifs, Grandville parsème son récit de prospectus, d’affichettes reproduisant par exemple le tarif des « Bains Vigierus ouverts jusqu’à la septième heure ». Louis Aragon adoptera à son tour dans Le Paysan de Paris ce parti pris documentaire en publiant le tarif des consommations imprimés sur différents panonceaux du café Certa.
Tous les êtres naturels (minéraux, végétaux, animaux, humains, dieux), comme tous les objets artificiels (outils, instruments, ustensiles, machines), ont une individualité et sont jaloux de leur moi. Ils sont animés, dans les deux sens du mot, ayant une âme et se mettant en mouvement. Autrement dit, le non-moi est aussi animé que le moi. On ne sera donc pas surpris que les Fleurs aient un cœur et gambadent, les Paratonnerres fument la pipe, les Yeux s’écarquillent devant la Beauté, les Mains applaudissent un ballet, des Singes peignent des tableaux. Sont aussi amorcées des séquences de monde à l’envers, tels les Poissons pêchant à la ligne des humains tout frétillants. Ce parti pris, loin de dénoter un anthropomorphisme enfantin, un animisme sélectif ou un panthéisme vague, fait toujours la part belle aux individualités qui s’éveillent, quitte à personnifier une partie de la partie et non l’objet tout entier. On se croirait en terrain familier. Ne trouve-t-on pas là en germe la conception et les procédés du dessin animé qui mêlent allègrement objets artificiels et entités naturelles et accordent à chacun d’entre eux mille occasions d’apparaître et de se métamorphoser, d’imploser et de ressusciter ?
Puff épouse la Réclame
Le docteur Puff souffle des bulles, pontifie un peu et vend beaucoup de vent. Il finit logiquement par épouser mademoiselle la Réclame. C’est l’un des derniers épisodes d’Un autre monde. Grandville a conscience que la philosophie du déguisement étendue au grand nombre change la donne politique et historique. Quatre énoncés résument l’affaire : « la conscience est devenue une marchandise », « la pensée n’est plus qu’une machine », « les hommes ne sont plus que des automates », « les machines remplaceront les créatures ». On produit des marchandises et on artificialise la nature ; on fabrique de la pensée et on automatise le genre humain. Tout est copié et mis sur le marché. Le plagiat étouffe les rares créateurs : « c’est pour la foule qu’il faut écrire, c’est comme elle qu’il faut penser ». Le Réclame est ce pouvoir de persuasion et d’entraînement qui ravit et obnubile les contemporains de Grandville transformés en moutons de Panurge. Pour abonder ironiquement dans ce sens, l’auteur d’Un autre monde déclare avoir inventé « une pompe aspirante et refoulante qui devait en moins d’une seconde inonder de prospectus la capitale la plus étendue ». Que seraient en effet devenus le capitalisme marchand et la technologie triomphante sans la publicité ?
Grandville a bien vu qu’en renforçant le message des prospectus ou des affiches par des dessins et des symboles, et à plus forte raison en électrisant et en colorisant la Réclame, on était en passe d’instaurer un nouveau credo, une nouvelle religion. Avec ses audaces et ses insolences, ses grossissements et ses raccourcis, la publicité ne fait d’ailleurs qu’accompagner la philosophie du déguisement. L’empire de la mode, de la réclame et du creux qui s’annonce à l’horizon démode à jamais la politique de Machiavel et la philosophie de l’histoire de Hegel. Cependant, Grandville ne perd pas tout à fait l’espoir d’en remontrer aux animateurs de la grande braderie publicitaire. Il a une botte secrète qui s’appelle Charles Fourier. « L’essor des passions aboutit à l’attraction. L’attraction aboutit au bonheur des hommes. » Puis donnant une description saugrenue de l’archibras de Fourier, il explique que le « bonheur fait pousser une queue à tous les hommes », une queue en forme de trompe surmontée d’un œil. Cet attribut ne sera pas le seul puisque chaque individu disposera des trois passions, la papillonne (Don Juan), la composite (Salomon) et la cabaliste (Talleyrand). Autres conséquences du système de Fourier : « les estomacs se perfectionneront au point de faire douze repas par jour. […] Une aurore boréale entraînera un beau jour les glaces du pôle dans l’océan, qui cessera subitement d’être salé, et se métamorphosera en sorbet au citron. »
Fourier et Grandville sont de la même trempe. Même si le premier tient la plume et le second le crayon, tous deux animent la pensée et fertilisent l’imagination. Avec les moyens de locomotion du capitaine Krackq, dignes de ceux du baron de Münchhausen ou du baron de Crac, Besançon n’est plus qu’à un jet de pierre ou de boulet de Nancy. Les deux inventeurs possèdent cette étrange faculté de s’extraire de leur temps et de se déporter dans le pays de la postérité. Métamorphoses et métempsycoses. Délaissant l’attirail finaliste des moralistes et les tables prévisionnelles des positivistes, ils se transforment en autre chose sachant que d’autres après eux se mettront dans cette nouvelle peau. En un sens, la philosophie du déguisement n’est que la caricature de cette stupéfiante mutation.
Masques de matière
En 1930, dans Documents n° 6, Roger Vitrac met un dessin de Grandville en tête de son article « L’enlèvement des Sabines » qui a l’ambition d’appliquer aux arts plastiques les figures ou tropes de la rhétorique. Il use à cet effet de deux divisions, les masques de pensée et les masques de matière, eux-mêmes subdivisés en masques de destruction ou de construction et en masques mobiles ou immobiles. Il en vient à proposer une classification pour les masques de destruction ou de construction : 1. l’ellipse (portrait sans visage de Matisse) ; 2. le pléonasme (pâte de Van Gogh) ; 3. l’hyperbate ou inversion (époque rouge de Derain) ; 4. la syllepse (Soutine) ; 5. la régression (Max Ernst) ; 6. la répétition (Klee) ; 7. l’apposition (reliefs lunaires de Van Gogh). À quoi s’ajoutent les six tropes des masques mobiles ou immobiles : 1. la métaphore (Grandville) ; 2. la catachrèse (collages de Picasso, Masson, Picabia, Ernst) ; 3. l’antonomase (Chirico) ; 4. l’allégorie (Roy) ; 5. la métonymie (Chirico, Ernst, Miró, Klee, Derain) ; 6. la synecdoque (Chagall, Man Ray).
La métaphore, figure rhétorique centrale en poésie et dans le surréalisme, échoit donc à Grandville. Vitrac définit ainsi la métaphore plastique : « La métaphore est un masque qui découle d’un rapprochement dans la nature mais dont les termes sont supprimés dans l’œuvre d’art. » Il précise aussi que le dessin de Grandville reproduit dans Documents, qui conjugue habilement « un front d’ivoire, des cheveux et des sourcils d’ébène, l’arc des lèvres, un cou de cygne, des dents de perles, etc. », est la traduction plastique d’un groupe de métaphores littéraires. Vitrac aurait pu ajouter que les yeux ardents de cette beauté surchargée à force de perfection dardent des flèches et des épées briseuses de cœurs. En tout cas, le projet de Vitrac d’établir sous le nom de masques un équivalent des figures rhétoriques dans le domaine des arts plastiques rejoint à n’en pas douter la philosophie du déguisement de Grandville basée sur l’animation de pantins, de marionnettes ou d’automates, sur le collage d’hybrides et de parties du corps, bref comme le dit Vitrac sur des masques mobiles ou immobiles, en voie de construction ou de destruction.
Quand il publie son dessin dans le Magasin pittoresque n° 42 de 1842, Grandville relève un défi à la demande du directeur de l’hebdomadaire, le saint-simonien Édouard Charton. Avant lui, un peintre à qui on avait proposé d’illustrer la description métaphorique d’une femme (« Elle avait un front d’ivoire, des yeux de saphir, des sourcils et des cheveux d’ébène, des joues de rose, une bouche de corail, des dents de perle, et un cou de cygne. ») en avait fait un « portrait bien littéral », « une assez plaisante caricature, un monceau de pierres fines, de bois des îles ». L’expérience est tentée cette fois-ci avec « la ligne noire et tranchante » du dessin de Grandville qui à partir d’un abus de « comparaisons fades » parvient à faire sentir qu’un monstre de beauté, ou qu’une beauté monstrueuse, a quelque chose d’ensorcelant et non de repoussant[1]. Cette tentative de synthétiser les plus beaux traits du visage féminin aura une descendance. Le 31 août 1962, France-soir publiera un photomontage de la « femme idéale » à partir de dix fragments de visage supposés les plus beaux du monde. L’Internationale situationniste n° 8 reproduira ce portrait-robot en ironisant sur la « sociologie de la beauté » et la « beauté de la sociologie » et en opposant la « dictature totalitaire du fragment » au « jeu dialectique du visage ».
En passant le test de la beauté synthétique féminine, Grandville n’est pas tombé pas dans le piège de la beauté compassée car il a eu l’idée de dessiner des yeux animés, séducteurs et assassins. D’ailleurs, en 1840, il avait déjà fait sensation avec sa « Musique animée ». Le lecteur du Magasin pittoresque avait pu voir et entendre, lire et suivre des partitions dessinées et composées par le Nancéen, où des notes incarnant divers personnages traversaient diverses situations allant du burlesque au mélancolique. Voici un échantillon de la musique animée de Grandville : « Quatre cavaliers, en grande tenue de bal, invitent des dames pour la valse… Une dame tombe, au grand effroi de son valseur… Une mouche énorme (dièse), attirée par les lumières, s’est introduite dans la salle ; une dame veut la chasser avec son mouchoir… » (Valse) / « Un chef entraîne ses soldats vers un pont… Un des chefs et son jeune fils sont noyés au pied du pont… » (Marche héroïque) / « Une jeune fille veut quitter son hameau pour se mettre en service à la ville… » (Pastorale en ré majeur). Pour cette dernière partition, un rêve sera même requis pour évoquer cette interrogation morale, sociale et existentielle.
Grandville transformiste
Peu avant sa mort, survenue le 17 mars 1847, Grandville envoie à Édouard Charton deux dessins, qu’on peut appeler animés, puisqu’il faut les regarder en suivant une ligne dynamique descendante[2]. Le premier, Visions et transformations nocturnes ou Crime et expiation, s’apparente à un cauchemar – un œil énorme et terrible poursuit un assassin. Le second, Promenade dans le ciel, proche de la rêverie, décrit une cascade de transformations en plein ciel – quartier de lune, humble cryptogame, plante ombellifère, ombrelle, chauve-souris, volatile-soufflet, soufflet, bobine avec écheveau de fil, char à quatre roues entraîné par trois coursiers fougueux, voûte étoilée.
Dans Documents de septembre 1929, Desnos, Bataille et Griaule contribuent à l’entrée « Œil » du dictionnaire en cours. Georges Bataille, outre l’œil tranché du film Un chien andalou de Buñuel et Dalí et la couverture de l’hebdomadaire illustré L’Œil de la police, accorde une place de choix au dessin de Grandville qui voit un œil animé poursuivant un criminel. L’auteur d’Histoire de l’œil ne manque pas d’insister sur l’« œil vivant et affreusement rêvé par Grandville au cours d’un cauchemar qui précéda de peu sa mort ». Il cite notamment les passages du dessinateur ayant trait à la cruauté et au supplice : « Le sang humain a été répandu et, suivant une expression [d’argot] qui présente à l’esprit une féroce image, il a fait suer un chêne ! En effet, ce n’est pas un homme mais un tronc d’arbre… sanglant… qui s’agite et se débat… sous l’arme meurtrière. […] Seraient-ce les mille yeux de la foule attirée par le spectacle du supplice qui s’apprête ? » Le directeur de Documents semble croire que Grandville a illustré son propre cauchemar. Or rien n’est moins sûr.
Le dessin Promenade dans le ciel est clairement basé sur l’animation, la transformation d’un objet initial. Il en va de même pour Crime et expiation. Ainsi, la croix du chemin se transforme en fontaine, qui se métamorphose en toque de juge et en balance de la justice. Il est curieux de noter qu’André Breton, trois semaines avant sa mort, a réalisé une série de dessins animés ou automatiques observant le même principe de la transformation d’un objet initial, à cette différence que le surréaliste souligne la continuité du trait de la ligne serpentine. Dans le jeu marabout-bout de ficelle-selle de cheval …, l’euphonie guide les associations. Ici c’est l’analogie de la forme qui est inductrice. Prenons le dessin que Breton a légendé par le mot-serpent Cerisesmanègetourellelangoustepiège : 1. le triangle de deux cerises liées par la queue donne naissance au cône d’un manège ; 2. la rotation du manège se métamorphose en tourelle de char ; 3. la tourelle à canon engendre une langouste aux deux longues antennes ; 4. tout l’arc avant de la langouste se transforme en piège avec mâchoires.
Comme s’il avait été un naturaliste transformiste, Grandville s’est évertué à dessiner la genèse des espèces et la mutation des formes. Il n’a pas dessiné ce qu’il avait rêvé. Il s’est laissé aller à transformer les formes qu’il dessinait au fil de son imagination et non au gré de la réalité. Promenade dans le ciel hallucine un humble cryptogame. Bien qu’il soit un farouche partisan de l’image, il a pu aussi entendre le mot cryptogramme. Pour le philosophe du déguisement, comme pour l’auteur de Nadja, les images, les écrits, et pour tout dire la vie, demandent à être déchiffrés comme un cryptogramme.
Georges Sebbag
Notes
[1] Le dessin de Granville du Magasin pittoresque n° 42 de 1842 s’insère dans « Fadeurs », un article non signé relatant les demandes faites à un peintre puis à Grandville d’illustrer la description métaphorique d’une femme. Une comparaison est ensuite amorcée entre la poésie et la peinture, avec la citation de la phrase d’Horace, Ut pictura poesis. Enfin, « Fadeurs » est complété d’une véritable anthologie des métaphores poétiques relatives à la beauté des parties du visage féminin. Grandville a pu puiser, pour dessiner des yeux ensorceleurs et assassins, dans Voiture (« Mille rayons ensorcelés / Sortent de vos yeux étoilés » / « Ses beaux yeux causent cent trépas »), Desportes (« Ô beaux yeux, qui pleuvez tant de feux et de traits ! »), Bensérade (« Belles dont les regards vont dépeupler l’État ») ou Scarron (« On y redoute les œillades / Autant que les carabinades »). On peut avancer que le dessin de Grandville et le contenu de « Fadeurs » ont beaucoup inspiré Vitrac, dont l’article, remarquons-le, démarre sur la phrase d’Horace.
[2] Les deux dessins commentés par Grandville (lettres du 26 février et du 5 mars 1847) sont publiés dans le Magasin pittoresque n° 27 de 1847, sous le titre « Deux rêves, par J. J. Grandville ». Le dessin Crime et expiation sera repris dans Documents n° 4 de septembre 1929.
Références
« Grandville philosophe du déguisement » publié dans le catalogue Un autre monde Grandville Un autre temps, Silvana Editariole, Musée du temps Besançon, 2011.
Ce texte est repris pour l’essentiel dans Foucault Deleuze. Nouvelles Impressions du Surréalisme, Hermann, 2015. (Voir p. 43-48 et p. 131-150).
Extraits de catalogue
Pour acheter Grandville Un autre monde, un autre temps : Silvana Editoriale














